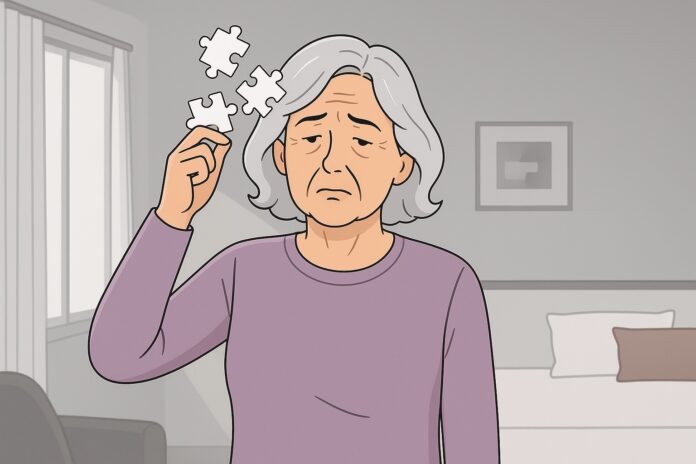Et si une infection virale très répandue contribuait à l’apparition d’une forme particulière de la maladie d’Alzheimer ? C’est la piste explorée par une équipe de chercheurs de l’Université d’État de l’Arizona, dont les travaux viennent d’être publiés dans la revue Alzheimer’s and Dementia. Leur étude identifie un lien entre le cytomégalovirus (CMV) — un virus latent présent chez une grande majorité des personnes âgées — et un sous-type spécifique de la maladie d’Alzheimer, marqué par une réponse immunitaire inhabituelle.
Un virus très discret, mais potentiellement influent
Le CMV est loin d’être un inconnu : ce virus de la famille des herpèsvirus infecte silencieusement une grande partie de la population. On estime qu’environ 80 % des adultes de plus de 80 ans en sont porteurs. Le plus souvent, il reste dormant dans l’organisme, sans provoquer de symptômes apparents. Mais chez certaines personnes, il pourrait interagir avec le système immunitaire de manière délétère, notamment en vieillissant.
C’est ce que suggèrent les chercheurs américains : ils ont constaté que chez près de la moitié des patients atteints d’Alzheimer (47 %), on retrouvait des cellules immunitaires spécifiques du CMV dans différents tissus corporels. À titre de comparaison, ces cellules n’étaient présentes que chez 25 % des personnes non atteintes de la maladie.
Le rôle-clé d’un anticorps : l’IgG4
Mais le virus ne fait pas tout seul : l’étude pointe aussi la responsabilité d’un anticorps particulier, l’immunoglobuline G4 (IgG4). En cas d’infection persistante au CMV, les chercheurs ont observé des niveaux anormalement élevés d’IgG4, notamment dans le côlon, le nerf vague et le cerveau.
Pourquoi ces lieux ? Parce qu’ils forment ce qu’on appelle l’axe intestin-cerveau, une voie de communication essentielle entre le système digestif et le système nerveux central, via le nerf vague, une sorte de “câble” biologique qui relie les deux. C’est en étudiant conjointement ces trois zones que les scientifiques ont mis en lumière des corrélations biologiques inédites : présence du CMV, réponse immunitaire IgG4 et signes classiques de la maladie d’Alzheimer (notamment les fameuses plaques amyloïdes et les protéines tau).
Une maladie aux multiples visages
L’une des conclusions majeures de cette recherche est que la maladie d’Alzheimer n’est sans doute pas une maladie unique, mais une constellation de sous-types, avec des causes et des mécanismes différents. Le sous-type impliquant le CMV pourrait concerner entre 25 % et 45 % des malades, affirment les auteurs de l’étude. Il serait donc loin d’être marginal.
Cette hypothèse ouvre des perspectives importantes : si ce sous-type peut être identifié précocement, il deviendrait envisageable de concevoir des traitements ciblés — antiviraux ou immunomodulateurs — et d’adapter les stratégies de prévention.
Une piste prometteuse, mais encore exploratoire
Bien sûr, ces résultats devront être confirmés par des études complémentaires, sur des échantillons plus larges. On ne peut pas encore affirmer avec certitude que le CMV “cause” Alzheimer chez certains patients — mais la corrélation observée est suffisamment forte pour justifier un changement de regard sur cette pathologie.
En intégrant plusieurs systèmes du corps humain — l’intestin, le système immunitaire, le cerveau —, cette recherche s’inscrit dans un nouveau paradigme de la médecine : celui qui refuse les cloisonnements entre organes et disciplines, et qui envisage les maladies chroniques comme le fruit d’interactions complexes, souvent silencieuses, entre notre environnement, nos microbes et notre propre physiologie.