Dans Le Cabaret des mémoires, paru chez Grasset en août 2022, le romancier Joachim Schnerf fait du devoir de mémoire le nerf de son écriture. À une époque où révisionnisme et négationnisme ont pignon sur rue, profitant d’un fouillis médiatique généralisé, la question de la transmission se fait de plus en plus vitale.
Peut-on jamais tourner la page de l’histoire ? Peu à peu, ses acteurs, inexorablement, quittent la scène, disparaissent. Tombent-ils pour autant dans l’oubli ? Et leur histoire, notre histoire, est-elle vouée aux sables du désert ? On rappellera le célèbre aphorisme du penseur hispano-américain Jorge Santayana qui revendique et impose le devoir de mémoire : « Ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter » (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it). Le jeune écrivain français Joachim Schnerf fait du souvenir la pierre de touche de son dernier roman : Le Cabaret des mémoires. Alors qu’autour de nous, nous voyons constamment le passé voler en éclats, et la vérité des choses passer sous les fourches négationnistes, dans un monde médiatique où le flot ininterrompu et à tout-va des nouvelles aboutit trop souvent aux fake news/infox, le romancier, ici, au cours d’une longue et angoissante nuit de veille, harcelé de souvenirs et d’images, revendique l’impératif catégorique de la transmission mémorieuse.

L’oubli du passé est dans toutes les têtes. On rappellera le percutant documentaire de Bertrand Blier, en 1963, Hitler, connais pas ! auquel fait écho, en 2014, le film allemand de Giulio Ricciarelli, Le Labyrinthe du silence, au titre éloquent, où la jeune étudiante que l’on interroge sur le récent passé de l’Allemagne répond qu’Auschwitz, elle n’en a jamais entendu parler. De là que l’écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina, en farouche Européen, écrive dans son texte « Un enthousiasme européen » : « L’on oublie que notre monde actuel, pour beaucoup marqué surtout par le désœuvrement, le cas échéant par des plaintes, s’élève sur un champ de ruines, sur une fosse commune de dizaines de millions de morts » (Le Monde, 4 mai 2019). Comment, alors, ne pas être touché par l’urgence de Joachim Schnerf, et son angoisse, à mettre la mémoire de la Shoah et de l’apocalypse des nazis au centre de son écriture ?
Samuel vient d’être père. Ou du moins espère-t-il être à la hauteur de ce que doit être un père. Son épouse, à la maternité, vient de mettre au monde leur premier enfant, et mère et fils doivent rentrer le lendemain matin. Lui, cette nuit qui précède leur retour, resté au logis, taraudé d’inquiétude et d’angoisse, ne fait que revivre son histoire, celle des siens, celle de son, grand-père qui fut un enfant caché et de la sœur aînée de celui-ci qui fut déportée à l’âge de douze ans. Inquiet des promesses d’une vie nouvelle, il est anxieux de cet héritage qu’il devra transmettre à son fils, car chacun hérite, en même temps que des gènes de ses parents, de leur histoire, dont on dit qu’elle colle à la peau, autant que le tatouage infamant qui marquait les reclus de l’enfer nazi (et dont Simone Veil fit graver le numéro sur son épée d’Académicienne).

Au milieu des images qui se bousculent dans sa tête enfiévrée, voilà sa grand-tante Rosa, la sœur de son grand-père, qui est la dernière survivante de la Shoah. Rescapée des camps, elle a vomi cette France qui l’avait fait partir à Auschwitz sur la foi d’un héritage prétendument coupable (même un Raymond Barre en a convenu, en estimant que trois des quatre victimes de l’attentat en 1980 contre la synagogue de la rue Copernic, et qui n’étaient pas juives, étaient pour cela même « des Français innocents ») et d’un ADN honni. Comme si William Shakespeare, en écrivant le fameux monologue de Shylock, son Marchand de Venise, n’avait pas déjà dénoncé l’absurdité du racisme :
« Un Juif n’a-t-il pas, comme un chrétien, des mains, des organes, des dimensions, des sens, des affections, des passions ? N’est-il pas nourri de la même nourriture, blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé et glacé par le même été et le même hiver ? Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Si vous nous empoisonnez, ne mourons-nous pas ? Et si vous nous faites du mal, ne nous vengerons-nous pas ? Si nous sommes semblables à vous en tout le reste, nous vous ressemblerons aussi en cela. »
Et donc, cette Rosa, regagnant la France ─ « le pays qui avait accueilli sa famille. Qui l’avait dénoncée » ─ au sortir de la « petite prairie aux bouleaux » (Birkenau), a fui définitivement la détestable Europe pour faire son gîte aux États-Unis, mieux encore, au désert du Texas, dans quelque coin perdu qui fait irrésistiblement penser au décor du film Bagdad Café (Percy Adlon, 1987). Et là, « la dernière rescapée du camp encore en vie » décide de clamer le souvenir de la Shoah en montant un show dans un coin américain que l’auteur, qui trempe sa plume dans « l’encre de douleur », nomme Shtetl City ; une revue dramatique intitulée Camp Camp où, comme dans l’inénarrable Danse de Gengis Cohn (Gallimard, 1967) de Romain Gary, le comique le dispute au tragique dans cette espèce qu’on nomme le grotesque.
« … la façon la plus juste de prononcer l’imprononçable. Chanter la Shoah, la danser, la mimer, la fictionnaliser, en rire… Chaque soir, elle enchaîne les anecdotes sur un ton hilare, comme autant de portées sur lesquelles la tragédie posera ses notes. »
Avec pour lever de rideau la phrase emblématique : « Je suis née dans un petit shtetl près de Cracovie, en 1930… ». Et Birkenau, comme l’on sait, n’est que la lointaine banlieue de Cracovie. Après quoi vient la description d’Auschwitz, la moins personnelle et la plus clinique possible, avec ses mots clés :
« la rafle, les wagons, la sélection, sa mère à l’entrée des douches. Et l’odeur. Incapable de détailler, abandonnant sa gouaille incroyable, elle se contente d’une longue énumération morbide. Chaque soir dans une tenue différente, Rosa aux identités infinies liste sans raconter, elle nomme, martèle, pour qu’on ne puisse jamais nier. »
Ce rappel mémorieux, dans le délire d’une veille angoissée, qui imagine la dernière représentation dramatique de la dernière survivante de la Shoah, alterne avec les expériences de scoutisme du jeune auteur, en compagnie de sa sœur aînée et de son cousin. Nous voilà dans un tout autre camp. Mais quel est le jeu de pistes de ces scouts ? Aller à la recherche de Shtetl City, revivre le show Camp Camp, en l’imaginant, en franchissant les obstacles fantasmés au milieu des Indiens, et retrouver la grand-tante et son témoignage. En scandant et reprenant, « pour que jamais l’espoir ne les quitte », cet authentique chant des Éclaireurs Israélites de France entrés en Résistance dans les années de peste brune en France :
Quand la nuit descend sur la terre
Quand le soir s’étend dans les bois…
Quand demain reviendra la lumière.
Voilà ce que le père racontera à son fils nouveau-né, là « où commence la vie et où cesse la mort », selon la belle phrase de l’écrivain islandais Jón Kalman Stefánsson, cité en exergue de ce livre admirable et par l’esprit qui l’anime et par le style, tout de retenue et de justesse. Joachim Schnerf ouvre là son cœur et délivre son angoisse devant un monde où s’effritent les valeurs de morale et de justice, où l’antisémitisme en France va galopant, où l’on assassine l’Histoire et, au passage, quelques relais ou témoins ─ d’Ilan Halimi à Sarah Halimi ─, sans état d’âme, où la négation et la haine impriment de jour en jour une tache de sang sur le drapeau de la révolutionnaire Liberté-Égalité-Fraternité dont un illustre juriste juif, René Cassin, avait fait renouveler la vocation dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948 aux Nations Unies. Un beau livre, qu’on lira dans le temps même de sa fictive écriture, en une seule nuit. Une nuit de veille passionnée, pour que « les cendres légères jouent avec les étoiles ».
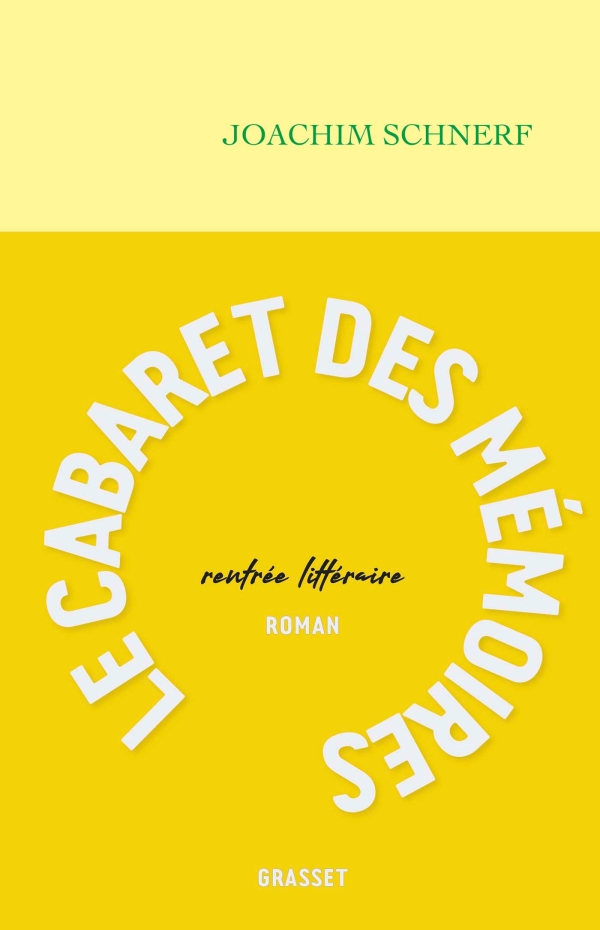
Joachim Schnerf, Le Cabaret des mémoires, Grasset, août 2022. 140 pages. 16 €
