Dans le dernier carré des livres « goncourables » en 2020 figurait le roman de Djaïli Amadou Amal, romancière camerounaise publiée pour la première fois en France, dans une modeste maison d’édition, infiniment moins en vue que le fameux trio GalliGrasSeuil, gagnant quasi exclusif des prix littéraires de chaque automne. Tous ces handicaps de notoriété n’ont pas empêché l’attribution du Goncourt des lycéens à cette courageuse et talentueuse narratrice qui nous parle de la cruelle condition des jeunes filles dans le carcan social et religieux de l’Afrique subsaharienne.
Grâces donc soient rendues à nos jeunes lecteurs, sensibilisés par un livre qui dénonce la violence des mariages forcés, des viols conjugaux répétés, des injustices et inégalités d’un sexe sur l’autre, assumées par des hommes sans ni honte ni scrupules, toujours empressés d’appliquer à leur seul bénéfice une polygamie autorisée par certains dogmes religieux et adossée à d’immémoriales traditions sociales du continent africain. Les Impatientes, sous-titré « roman », est la version française de l’édition originale africaine joliment intitulée Munyal, les larmes de la patience. Djaïdi Amadou Amal précise d’entrée que « cet ouvrage est inspiré de faits réels ». La romancière en effet fut elle aussi témoin et surtout victime des pratiques religieuses et sociologiques ancestrales quand elle fut mariée à l’âge de 17 ans de force à un homme qu’elle n’aimait pas, dans le Nord-Cameroun, à Maroua. Elle eut la force et le courage de le quitter pour se remarier avec l’homme de sa vie.

Son récit s’articule autour de trois femmes, Ramla, sa sœur Hindou et Safira leur belle-mère. La première, jeune fille instruite et déterminée à devenir pharmacienne, près de se marier avec l’homme qu’elle aime, Aminou, futur ingénieur, se voit contrainte d’abandonner cette union et de s’unir à un riche homme d’affaires, époux de Safira, « deuxième » et inattendu choix de son père Alhadji Boubakari.
Un père qui impose pareillement à Hindou de se marier à son cousin, le riche Moubarak. Non sans leur servir d’entrée une multitude d’injonctions, d’interdits et de commandements : « Craignez votre Dieu, soyez pour lui une esclave et il vous sera captif, soyez pour lui la terre et il sera votre ciel […]. À partir de maintenant vous appartenez chacune à votre époux et lui devez une soumission totale, instaurée par Allah. Sans sa permission, vous n’avez pas le droit de sortir ni même d’accourir à mon chevet ! Ainsi et à cette seule condition, vous serez des épouses accomplies ! […] Le paradis d’une femme se trouve aux pieds de son époux. […] Soyez soumises ! »
Bienvenue donc dans un monde où « l’amour n’existe pas avant le mariage, […] ici on n’est pas chez les Blancs », où « la polygamie est indispensable pour le bon équilibre du foyer conjugal », où « une femme heureuse se reconnaît à ses voyages à La Mecque et à Dubai, à ses nombreux enfants et à sa belle décoration intérieure ». Bienvenue dans un monde où les hommes s’appuient sur le Coran quand les préceptes du Livre sacré servent leurs intérêts. Bienvenue enfin dans un monde de concurrence et de jalousie féroces, un monde où « il n’y a pas pire ennemie pour une femme qu’une autre femme. […] Munyal ! Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes. Intégrez-la dans votre vie future. Inscrivez-la dans votre cœur, répétez-la dans votre esprit ! Munyal, vous ne devez jamais l’oublier ! »
Munyal signifie « patience » dans la langue des Peuls, population du Cameroun et pays limitrophes, litanie des chefs de famille et maris omnipotents. Munyal, les larmes de la patience, titre éclairant qui dit tout du sort et calvaire des deux jeunes filles contraintes de prendre époux sur ordre du tout-puissant maître de maison, marié à une première femme, elle-même mère de Ramla et Hindou, puis à trois autres « coépouses » qui l’ont fait géniteur, à elles quatre, d’une trentaine d’enfants.
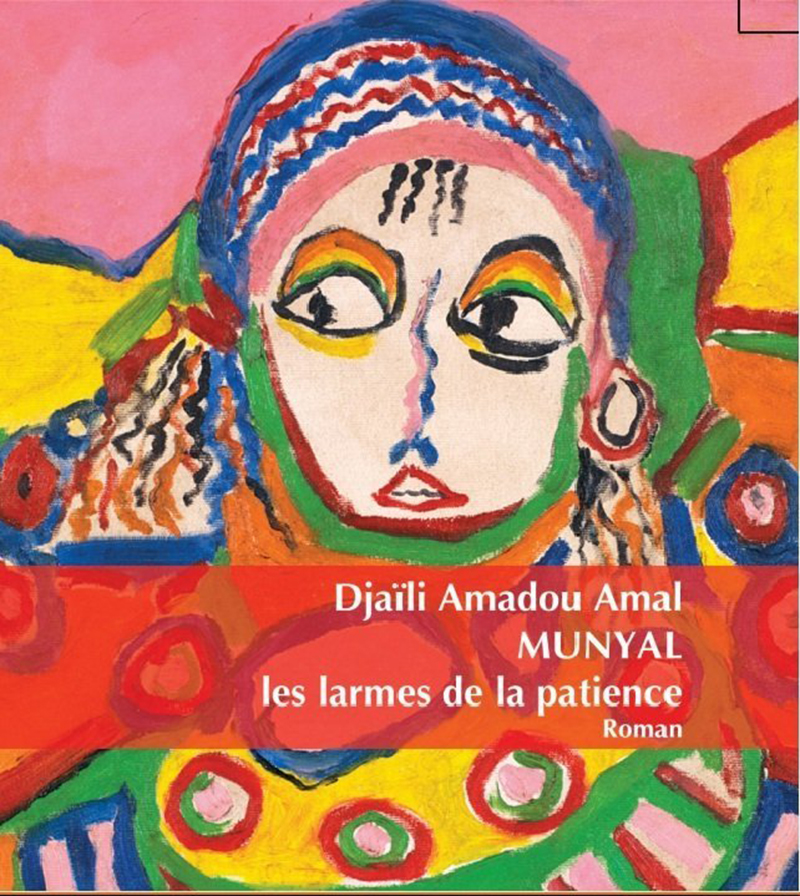
Tout ce beau monde vit enfermé à l’intérieur des hauts murs de ce qu’il est convenu d’appeler au Cameroun une concession (belle ambivalence du mot !), lieu unique qui rassemble les demeures des femmes épousées et de leur progéniture au grand complet. Les enfants, et les filles en particulier, sont les instruments des patriarches tout-puissants qui marient à leur gré filles et garçons de leurs épouses, elles-mêmes contraintes « de tout accepter, de tout supporter et surtout de tout oublier… ou de faire semblant ! » D’autant qu’elles n’ont « aucune envie de finir répudiée. Protection oblige ! »
Les deux mariées vivront les honneurs d’épousailles brillantes et sonores : Mercedes rutilantes, klaxons hurlants, youyous incessants le long du parcours de la noce, claquement des sabots de dizaines de chevaux de l’escorte et « banquet gargantuesque ». Au milieu du tintamarre, deux épouses, à peine visibles sous leurs voiles immenses et les ors de leur vaste pagne et parure mariale, vivent la cérémonie comme un calvaire. La fin du jour et de la fête trouvera deux femmes anéanties par l’heure et le malheur de s’unir à jamais à un homme qu’elles n’aiment pas.
Ramla sera priée de rentrer dans le rang et se soumettre aux lois rigoristes de la religion et de la famille tenues par un père inflexible, emblème lui-même d’une société figée. La résignation et la patience – munyal, encore et toujours, mot répété à l’envi – devront donc être les seules règles de vie de la jeune épouse. Et puis « jamais ton père n’aurait permis que tu ailles à l’université » lui assènera sa mère, fataliste depuis le premier jour de son mariage, elle aussi.
Le sort d’Hindou est pire encore. Moubarak, l’époux, est homme violent, érotomane et infidèle, dépendant de l’alcool et des drogues. La malheureuse plie sous les coups de la brute, qui régulièrement lui assène d’épouvantables coups et claques et la viole dès le soir de la nuit de noces. L’horreur est absolue, que l’entourage n’ose dénoncer. « Personne ne fut scandalisé par mon état. Ce n’était pas un crime ! Moubarak avait tous les droits sur moi […] Le médecin ne s’en formalisa pas non plus. […] Ma belle-mère vint me reprocher discrètement mon insoumission face à mon époux. » Hindou tentera de fuir le foyer conjugal. En vain. D’insidieux familiers du couple la rattraperont bien vite. Et la malheureuse en deviendra folle.
Pire, et le portrait de Safira, troisième chapitre de ce terrible livre, le confirme, la femme elle-même peut être le bourreau de ses coépouses. Après le mariage de Hindou, Safira s’installe dans le statut de « daada-saaré », première femme épousée, et à ce titre « pilier de la maison et de toute la famille » qui a le pouvoir de réguler les relations entre les femmes au sein du foyer. Cette fois-ci, le récit va mesurer les dommages d’une polygamie instituée : Safira, l’aînée et quarantenaire, déjà vieille à côtés de ses toutes jeunes coépouses, est prête à toute forme de stratagème, sombre calcul et secrète intervention – griots, sorcières, herbes et potions de pouvoir magique – pour tromper et se débarrasser d’encombrantes et fâcheuses nouvelles rivales susceptibles de la défaire de sa position. Jusqu’à se désolidariser et provoquer plus encore le malheur de ces femmes qui l’entourent et se faire exécutrice de basses manœuvres. Le remord final la sauvera du naufrage humain qui la guettait.
Ces tableaux effrayants et successifs nous montrent tour à tour la passivité de femmes contraintes et résignées, la brutalité épouvantable sur les coépouses, enfin l’acceptation, hommes et femmes ensemble ou presque, de toute une société patriarcale qui fait fi des volontés féminines avec la complicité même d’autres femmes attachées aux traditions et à un statut censé les protéger. Le fatalisme est la voie permanente d’un terrible attentat à la dignité humaine quotidiennement commis au nom de traditions multiséculaires, constate et dénonce Djaïli Amadou Amal.

Ce texte terrible est de belle écriture. Et cette talentueuse romancière, Peule et musulmane, s’est engagée dans un combat féministe. Selon elle, « il est impossible de développer la société camerounaise en ignorant la moitié de sa population. C’est pourquoi je me bats pour que les filles aient le droit d’aller à l’école et d’apprendre un métier ». Son association « Femmes du Sahel » se veut révolutionnaire. Djaïli Amadou Amal parcourt le Cameroun pour faire évoluer les mentalités. Elle s’active aussi pour promouvoir ses motos-livres, ralliant les lieux les plus reculés du Sahel pour faire découvrir la lecture. Une passion qu’elle partage avec son mari, un auteur camerounais comme elle. « Il n’y a que par l’éducation des filles que l’on changera le monde. Le prix Goncourt des lycéens m’aidera à représenter cette voix. Les jeunes symbolisent l’avenir, alors les savoir sensibles à la violence faite aux femmes nous promet de beaux lendemains. » Djaïli Amadou Amal est la magnifique voix de ces femmes humiliées, celle des sans-voix précisément.
