Pressenti pour le prix Nobel de littérature 2015, Don DeLillo n’a pas été couronné. L’Académie suédoise lui a préféré Svetlana Aleksievitch. Reste que l’auteur new-yorkais sera à l’honneur en 2016. Récemment lauréat du National Book Award pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution aux lettres américaines, Don DeLillo assistera en février à Paris à un colloque organisé par les éditions Actes Sud qui publie en français ses romans, nouvelles et pièces de théâtre.
Son prochain roman, très attendu par les admirateurs de l’écrivain, paraîtra en mai 2016 aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il s’appelle Zero K. Si l’on en croit les médias anglo-saxons, l’histoire tournerait autour de Ross Lockhart, millionnaire, et sa femme, plus jeune mais malade, Artis Martineau, une histoire sur la mort et l’immortalité, la technologie et la biomédecine. Retour sur l’œuvre d’un écrivain contemporain incomparable.
Réception, americana et contemporanéité
 S’il peut paraître laborieux, au départ, de pénétrer l’univers romanesque de Don DeLillo, c’est peut-être qu’il confère au lecteur un rôle herméneutique capital dans l’expérience littéraire. L’obscurité de l’œuvre, en rien, n’est gratuite. Si l’on doit considérer DeLillo comme un auteur postmoderniste – nous y reviendrons –, il est nécessaire de dissocier son travail de l’obscurité kabbalistique et paranoïaque d’un Thomas Pynchon, ou du délire ludique et intertextualisant d’un Percival Everett. L’écriture delillienne, laquelle culmine dans Point Omega, confine à une clarté profonde, une complexion minimaliste, qui n’est ni étrangère à l’évidence de l’image cinématographique, ni à l’humilité qu’il semble éprouver, comme écrivain, face au mystère de l’expression.
S’il peut paraître laborieux, au départ, de pénétrer l’univers romanesque de Don DeLillo, c’est peut-être qu’il confère au lecteur un rôle herméneutique capital dans l’expérience littéraire. L’obscurité de l’œuvre, en rien, n’est gratuite. Si l’on doit considérer DeLillo comme un auteur postmoderniste – nous y reviendrons –, il est nécessaire de dissocier son travail de l’obscurité kabbalistique et paranoïaque d’un Thomas Pynchon, ou du délire ludique et intertextualisant d’un Percival Everett. L’écriture delillienne, laquelle culmine dans Point Omega, confine à une clarté profonde, une complexion minimaliste, qui n’est ni étrangère à l’évidence de l’image cinématographique, ni à l’humilité qu’il semble éprouver, comme écrivain, face au mystère de l’expression.
En 1971, Don DeLillo a trente-cinq ans et vient de publier son premier roman, Americana. Clairement, c’est un texte programmatique, si l’on considère la suite de son œuvre. Non seulement nous y trouvons en germe les motifs qui reviendront – le commerce conflictuel en même temps que nécessaire entre le texte et les images, l’opposition entre la surexpression de la mégalopole et le minimalisme du désert, le cinéma, la récupération de la culture ou de la mémoire historique par le marché, etc. – mais la référence générique du titre nous apprend aussi deux choses sur l’œuvre romanesque de Don DeLillo. Si elle projette de traiter la culture d’un pays, elle entend surtout prendre la mesure des structures, par exemple narratives, dans laquelle cette culture s’élabore et se répand. On retrouve par ailleurs ce décalage parodique, toujours avec subtilité, dans un roman comme End Zone, paru en en 1972, qui emprunte délibérément à la structure du campus ou du sports novel. L’Americana est le nom donnée à une partie de la culture américaine, musicale autant que cinématographique, laquelle s’attache à transcrire une Amérique populaire, rurale et à en transmettre les valeurs prédominantes, notamment le concept capital de border, de frontière. 
Libra, underworld. dietrologia et counternarrative.

DeLillo, particulièrement dans son roman Outremonde – chef d’œuvre de la littérature de la fin du XXe siècle – parvient à donner un tour littéraire impressionnant à son projet d’écriture de l’histoire. Face aux fictions étatiques, il construit un roman-fleuve qui court de 1951 jusqu’à 1992 et traverse la guerre froide. Les motifs du souterrain, de l’outre-monde ou du déchet sous-tendent le courant idéologique qui traverse l’histoire officielle, institutionnalisée, et dont l’écriture romanesque écrit le verso, les vies infimes. Plus tard, dans Mao II mais aussi dans L’homme qui tombe, DeLillo réussit le pari littéraire de situer l’entre-deux d’une réflexion sur le terrorisme qui échapperait et au complot – ersatz simplifié du plot romanesque, dont il est en quelque sorte le frère ennemi – et à la fiction de l’État. Ce ne sont plus les tours, les tours du World Trade Center, qui tombent, mais bien l’homme. L’incipit du roman le prouve : DeLillo choisit d’éloigner son personnage des Tours, dont il sort, pour le conduire en périphérie de l’événement.
Dans son dernier roman, Point Omega, la réflexion sur l’événement et l’histoire prend un tour autrement plus philosophique. Cet universitaire à la retraire, Richard Elster, qui a participé à la conceptualisation de l’intervention américaine en Irak, discourt à propos du point Oméga, la théorie de Teilhard de Chardin qui désignerait un stade ultime de la conscience. À l’avènement succède l’événement, la disparition tragique et inexpliquée de sa fille. L’histoire, dans son œuvre, est essentiellement déceptive, parce qu’elle demeure une chose inexpliquée, incontrôlable. En cela, DeLillo est un auteur dit postmoderniste, non au sens d’une lucidité ou d’une réflexivité permanente de l’écriture envers elle-même, mais dans la mesure où il se situe dans ce que Lyotard appelle « une anamnèse du projet moderne », s’entend, une réflexion sur les raisons de sa chute ou de son dévoiement.

Don DeLillo a connu avec l’adaptation cinématographique de son roman Cosmopolis par David Cronenberg une reconnaissance plus ample auprès du lectorat français. Si le film possède des qualités indéniables, la retranscription fidèle des dialogues peut l’avoir rendu un peu bavard. Roman sur la crise, sur le capitalisme financier – roman, surtout, sur le temps – Cosmopolis donne à voir toute une galerie de personnages experts – Florian Tréguer parle à raison de « fictions d’experts ». Si leurs discours sont parfois géniaux – voir notre sélection de citations, en fin d’article – il serait erroné de les considérer comme des vérités directement issus de la plume de leur auteur. L’ironie sous-jacente de l’écriture sait encore une fois créer un entre-deux dans lequel le discours de ces personnages se tient sans cesse entre vérité et grandiloquence.
Des romans sur le temps

Il serait presque possible de considérer les trois derniers romans, Cosmopolis sur une crise financière, une révolte contre le capitalisme, L’Homme qui tombe sur le 11-septembre et Point Oméga, historiquement, sur la guerre en Irak, comme une sorte de trilogie sur les relations de notre extrême-contemporain au temps et à la temporalité. Eric Packer, le golden boy richissime de Cosmopolis, a tout de l’avant-gardiste visionnaire et figure, par métonymie, le dévoiement ou la sécularisation du capitalisme financier en tant qu’il agit en éclaireur. Technologiquement, il est en avance sur son temps.

Si donc les problématiques liées à la temporalité, à la modernité et la postmodernité comme au présentisme, ont été largement traitées dans Cosmopolis ou L’Homme qui tombe, le roman Point Omega semble pousser la réflexion plus loin encore en étendant la problématique à des questions d’ordre ontologique. En somme, DeLillo aborde la question de savoir ce qu’est le temps, comme nous pouvons le lire dans son entrevue avec Kapriélan :
« Est-ce que le temps relève d’une construction humaine, est-ce nous qui construisons l’idée du temps qui existe dans notre conscience et tout autour de nous, ou est-ce possible d’imaginer un monde où le temps serait différent […] ? »
La question est méditative, voire philosophique, et n’est pas sans nous rappeler les interrogations de Saint Augustin lui-même – que Benno Levin cite, par ailleurs, dans le roman Cosmopolis. Le fait est que DeLillo est publié, en décembre 2001, un essai intitulé In the ruins of the future qui conditionnait et anticipait les trois romans à venir, à savoir Cosmopolis, L’Homme qui tombe et Point Omega, doit nous alerter quant au commerce qui se fait, dans son œuvre, entre le littéraire et le philosophique. D’autant plus que, dans son entrevue avec Kapriélan, il confesse :
« Je n’arrêtais pas d’aller la voir au musée d’Art Moderne [la vidéo de Douglas Gordon]. À ma quatrième visite, j’ai su que j’allais écrire dessus – pour faire un essai, il aurait fallu que je sois philosophe, donc j’ai bifurqué vers le roman. Je vois cette vidéo comme une étude sur le temps et mon livre est devenu un travail autour du temps et de la perte ».
Le choix générique du roman est le produit d’une bifurcation par rapport à la philosophie, à l’essai philosophique. Si anodine parait-elle, cette remarque nous montre la primauté de la philosophie en ce qui concerne une étude ou un travail sur le temps. Inversement, l’élection du roman est elle-même significative. Rappelons la thèse de Paul Ricœur comme quoi « la spéculation sur le temps est une rumination inconclusive à laquelle seule réplique l’activité narrative ». Ricœur commence en premier lieu par Saint Augustin et son aporétique du temps, qu’il confronte à Aristote et la mimesis. Pour Ricœur, l’activité mimétique est « une imitation créatrice de l’expérience temporelle vive par le détour de l’intrigue ». Or, cette intrigue, qu’il traduit par muthos – et non pas par histoire, pour des raisons terminologiques – correspond à « l’agencement des faits en système ». Ainsi le muthos parvient à faire concorder ce qui est discordant, en l’occurrence l’expérience temporelle.
Le texte et les images. La littérature en creux.

Dans les années cinquante, Jean-Luc Godard, alors critique aux Cahiers du cinéma, tente de légitimer le cinématographe par et contre la littérature. La critique du fait littéraire, en vérité, passe par une déhiérarchisation des arts : l’utilisation, même critique, même problématique, de l’écriture comme premier moyen d’expression, puis comme références intermédiales dans son œuvre filmique, le prouve. Néanmoins, le soupçon envers la littérature, et plus généralement le texte, ne cessait pas de planer. Il serait aisé, dans cette perspective transmédiale, de voir dans l’œuvre de DeLillo un mouvement inverse à celui de Godard : non plus de la littérature vers le cinéma, mais du cinéma vers la littérature, qui ferait de facto un emprunt à son cadet. L’écriture delillienne emprunterait au cinéma, notamment à celui de la Nouvelle Vague ou du Néoréalisme, des techniques autant que des thématiques. La question d’une relégitimation du littéraire par le cinématographique pose certes plusieurs questions, entre autres, celle de savoir si ce phénomène procède d’un essoufflement (du modernisme et du haut-modernisme), et donc, constitue le symptôme d’un postmodernisme. De même, il s’agirait de comprendre si ce renversement se trouve être conjoncturel, pris dans un contexte culturel et intellectuel précis, ou s’il recoupe l’idée plus vaste d’une hiérarchie des arts.
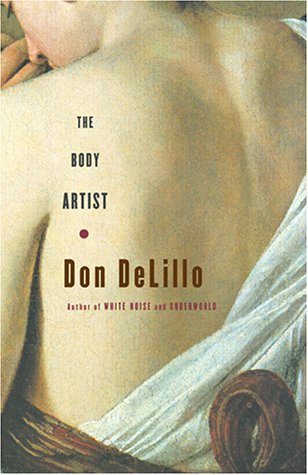
Ses romans, mais aussi ses nouvelles et ses pièces de théâtre, sont riches en réflexion littéraire, philosophique ou encore sociologique. Nous n’avons parlé ici que de l’histoire, de l’événement, du terrorisme, du temps et des images. Son œuvre demeure inépuisable et offre, rappelons-le, un incroyable plaisir de lecture. Nous attendons Zero K ainsi que le reste de ses nouvelles encore non traduites avec impatience.
Bibliographie sélective
– DeLillo Don, L’Ange Esmeralda, Paris, Actes Sud, (Babel), 2013, (traduction Marianne Véron).
– DeLillo Don, Point Omega, Paris, Actes Sud, (Babel), 2010, (traduction Marianne Véron).
– DeLillo Don, Cosmopolis, Paris, Actes Sud, (Babel), 2003, (traduction Marianne Véron).
– DeLillo Don, L’Homme qui tombe, Paris, Actes Sud, (Babel), 2008, (traduction Marianne Véron).
– DeLillo Don, Outremonde, Paris, Actes Sud, (Babel), 1999, (traduction Marianne Véron).
– DeLillo Don, Mao II, Paris, Actes Sud, (Babel), 1992, (traduction Marianne Véron).
– DeLillo Don, Bruits de fond, Paris, Actes Sud, (Babel), 1985, (traduction Michel Courtois-Fourcy).
– DeLillo Don, Les Noms, Paris, Actes Sud, (Babel noir), 2008, (traduction Marianne Véron).
– DeLillo Don, Libra, Paris, Actes Sud, (Babel), 1988, (traduction Michel Courtois-Fourcy).
– DeLillo Don, Americana, Paris, Actes Sud, (Babel), 2000, (traduction Marianne Véron).
Une sélection de citations exemplaires et passablement croustillantes :
« Je voulais une guerre haïku, dit-il. Une guerre en trois vers. Aucun rapport avec l’état des forces en présence ou de la logistique. Ce que je voulais, c’était un assemblage d’idées ayant à voir avec des objets éphémères. Telle est l’âme du haïku. Tout dénuder, tout rendre visible. Voir ce qui est là. À la guerre, les choses sont éphémères. Voir ce qui est là et puis se tenir prêt à le voir disparaître ».
Point Oméga.
« La porte s’entrouvrit et un lointain bruit d’activité à l’autre bout de l’étage se fit entendre, des gens qui prenaient l’escalator, un caissier qui passait une carte de crédit, un employé qui enfouissait des achats dans d’élégants sacs de musée. Lumière et son, tonalité sans paroles, la suggestion d’une vie au-delà du film, l’étrange réalité criante qui respire et mange là-bas, cette chose qui n’est pas du cinéma ».
Point Oméga.
« La question, c’est le temps, un temps imbécile, un temps inférieur. Quand on déblaie toutes les surfaces, quand on regarde ce qui reste, c’est la terreur. C’est la chose que la littérature était censée guérir. Le poème épique, l’histoire qu’on lit avant de dormir ».
Point Oméga.
« Il y a des années, je croyais qu’un romancier pouvait modifier la vie intérieure de la culture. Maintenant les fabricants de bombes et les tueurs se sont emparés de ce territoire. Ils mènent des raids sur la conscience humaine. Ce que faisaient les écrivains avant d’être tous annexés ».
Mao II.
« Nous sommes tous jeunes et intelligents et nous avons été élevés par les loups. Mais le phénomène de la réputation est une affaire délicate. L’ascension sur un mot et la chute sur une syllabe ».
Cosmopolis.
« Ma société s’occupait de déchet. Nous faisions du traitement de déchets, du commerce de déchets, de la cosmologie de déchets. J’allais dans les terres basses de la côté texane et je regardais des hommes en combinaison lunaire enterrer des barils de déchets dangereux dans des strates souterraines de sel vieilles de millions et de millions d’années, résidus desséchés d’un océan mésozoïque. C’était une conviction religieuse dans notre profession que ces dépôts de roche saline ne laisseraient pas fuir de radiations. Le déchet est une chose religieuse. Nous ensevelissons des déchets contaminés avec un sentiment de révérence et d’effroi. Il est nécessaire de respecter ce que nous jetons ».
Outremonde
« Il y a quelque chose dans la nature de ce film, le grain de l’image, les tons noirs et blancs crachotants, la rigidité – on a l’impression que c’est plus vrai que nature, plus réel que tout ce qui vous entoure. Les choses autour de vous ont un air mis au point, stratifié, retouché. Le film est surréel, ou peut-être est-ce sous-réel qu’on voudrait plutôt dire. C’est ce qui gît tout au fond, par-dessous toutes les strates qu’on a accumulées. Et c’est une autre raison pour laquelle on continue à regarder. Le film est d’une réalité brûlante ».
Outremonde.
Crédit photo : Thousand Robots
