Le Livre d’Ebenezer Le Page est le seul ouvrage écrit de la plume de Gerald Basil Edwards, publié en 1981 et réédité en octobre 2022 aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. L’auteur dresse ici le portrait romancé d’un homme qui ne quitta jamais son île natale, Guernesey, amoureux d’une seule femme toute sa vie durant, témoin des changements qu’a connus son rocher de la fin du XIXe aux années 60.

Gerald Basil Edwards, né à Guernesey en 1899 et mort en 1976 à Weymouth, en Angleterre, est un écrivain britannique à qui l’on doit un seul ouvrage, Le Livre d’Ebenezer Le Page, publié en 1981 en Angleterre cinq ans après sa mort, et publié pour la première fois en français l’année suivante, sous le titre de Sarnia, aux Lettres Nouvelles sous la houlette d’un de nos plus grands éditeurs, Maurice Nadeau, pour être repris aujourd’hui dans l’excellente traduction, revue et corrigée, de Janine Hérisson. À sa parution en Angleterre, ce livre fut salué par William Golding comme « une œuvre de génie » et Maurice Nadeau, quant à lui, parle d’une « exceptionnelle réussite » et dit de ce livre « subtil, complexe et magique, composé d’espace, de temps, de souffrances et de joies humaines » qu’il « se tient ainsi entre terre et ciel pour une éternité de lectures. » G.B. Edwards, totalement identifié à son île anglo-normande, au large de Saint-Malo ou de Granville, campe le portrait d’un pur Guernesiais, qui n’a jamais quitté son île, mais qui sait tout du monde et des hommes, tout en prétendant, à l’instar de Socrate, qu’il ne sait rien : un sage, donc, qui se nomme Le Page :
« Guernesey, Guernsey, Garnsai, Sarnia, qu’ils disent. Enfin, moi, je ne sais pas trop. Plus je vieillis et plus j’apprends, plus je sais que je ne sais rien, moi. »
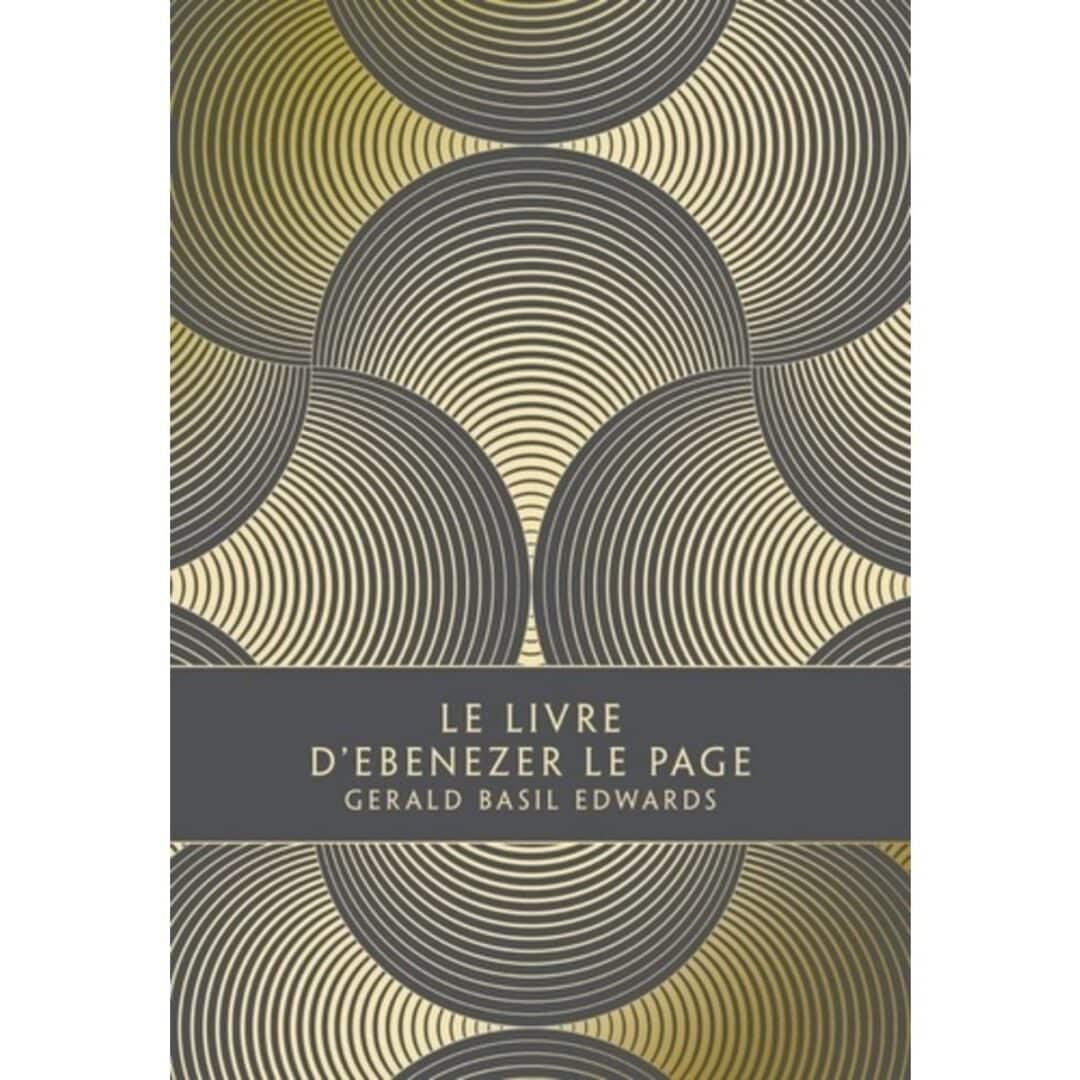
Après avoir soutenu que « la vie en ce bas monde, c’est l’enfer sur terre la plupart du temps pour la plupart d’entre nous », le narrateur de cette autobiographie fictive précise son propos :
« Je voudrais pouvoir écrire l’histoire de cette île telle que je l’ai connue et vécue pendant près d’un siècle. Je ne pense pas avoir beaucoup changé ; mais, à mon avis, tous les autres, eux, ont changé. Les jeunes d’aujourd’hui ne savent pas et ne peuvent même pas imaginer à quel point la vie à Guernesey autrefois était différente de ce qu’elle est maintenant. Un grand fossé s’est creusé entre la génération actuelle et la mienne. Je voudrais pouvoir le combler ; mais c’est trop espérer. Les seuls qui pourraient partager ma façon de voir sont morts, ou alors ce sont des vieux comme moi, qui n’ont plus les idées très claires ni une mémoire très sûre. »
Or il nous donne là le portrait le plus exact et fort attachant de cette île, si différente de Jersey la souriante, par sa géographie tourmentée, son côté agreste, rustique, en un mot : sauvage.

Et dans ce cadre-là, vit depuis près d’un siècle un homme immuable et sédentaire, qui n’a jamais quitté la maison de ses pères, contenant des pierres préhistoriques dont il assure l’entretien, ce qui lui donne quelques subsides, auxquels s’ajoute la culture de tomates dans la serre qu’il a aménagée sur son petit lopin. Le récit de ce grand vieillard parcourt le temps de l’Histoire, la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, l’occupation allemande et la Libération par les Britanniques : « Wharro, Georges ! », lance-t-il sur le passage du roi qui, certes, ne le voit même pas. Et c’est toute la chronique de l’île qui nous est ici donnée, et de ses habitants : la famille du narrateur et ses amis, en tout quelques dizaines de personnages dont on suit minutieusement et passionnément l’existence. Une phrase étonnante — ou étonnée — résume son itinéraire :
« Qu’il était étrange de naître tout-petit, puis de grandir peu à peu, uniquement pour finir vieux et ratatiné. »
Et voilà que sur le tard, cet homme qui a tant vécu, cet « Achille immobile à grands pas », comme l’aurait qualifié Paul Valéry, s’en va acheter un gros cahier, tout en en contestant les 18 shillings excessifs car, n’est-ce pas ? « c‘est cher pour un cahier qui n’a que des pages blanches » ! Humour typiquement britannique, ou mieux guernesiais, dont le texte est truffé, d’où l’immense agrément de sa lecture. Car cet Ebenezer est un homme malicieux, comme le sont parfois les vieux sages qui ont tout connu et prennent de la distance avec les avatars de l’existence.
Qui a dit qu’il n’y a pas de roman sans amour ? Stendhal qui promenait son miroir amoureux, de Fabrice à Julien ? Cervantès qui inventait l’idéal féminin et c’était Dulcinée l’inaccessible ? Edwards s’en souvient peut-être, car tous les Anglais ont lu Don quichotte. Notre Ebenezer sera, sa longue vie durant, amoureux d’une seule femme, Liza, mais elle ne voulait pas gâcher leur amitié sublime en s’abaissant jusqu’à la couche : leurs rencontres périodiques, aux deux bouts de l’île, seront de merveilleuses promesses, mais ce n’est qu’à la toute fin, quand, après tant de misères et de drames, Neville, le petit-fils des amours adultérines de Liza, rencontrera, et sans doute épousera, lui, la petite-fille oubliée d’Ebenezer, que les vieux amis/amants se donneront enfin un baiser sur la bouche. En ce sens, ce roman choisit, par quelque recours au deus ex machina, une fin tout à fait sublime et terriblement émouvante : rien ne sera perdu de cette vie ordinaire.
Entre temps, que de morts et de tragédies : Le père d’Ebenezer s’en va mourir à la guerre de Boers — ce qui fait toucher du doigt l’absurde de l’existence, car enfin quel besoin d’aller se battre pour le compte des Anglais, qui n’ont jamais le beau rôle dans ce roman ? —, et meurt aussi sa mère tant aimée, qui fut, tant qu’elle vécut, l’amour de son fils Ebenezer, ce qui explique qu’il n’ait jamais voulu la quitter, après la mort du père, et ait renoncé à tout destin hors de Guernesey. Et le fils vivra aux côtés de sa petite sœur Tabitha, après que le mari de cette dernière est tué à la guerre de 14, mais elle finira par mourir. Et puis Jim, l’ami d’enfance tant aimé, tué lui aussi pendant la Première Guerre mondiale. Et tant d’autres qui disparaissent au fil des jours et de la vieillesse d’Ebenezer qui, lui, est un roc, fidèle à son île qui est tout son univers et dont le romancier fait un microcosme du monde, tant il y a d’échanges humains, de conflits de toute sorte, de joies et de peines. Le tout servi par un style d’une rare fluidité qui fait qu’on ne s’ennuie jamais au milieu de cette foule de personnages et d’histoires ; bien au contraire, l’auteur sait ménager des suspens et des surprises qui font de ce long récit une magnifique saga.
Mais au fait, on peut s’étonner chez nous de ce prénom surprenant, peut-être pas si rare en milieu anglican ou méthodiste, tant pétri de Bible. Eh bien ! Ebenezer est le prénom qui, dans le livre de Samuel, désigne le nom d’une pierre — Ebène Ézer —, ainsi nommée par le prophète qui la dépose et la sanctifie, après que les Hébreux ont triomphé des Philistins par le secours du Seigneur (Ebène signifiant pierre, et Ézer, verbe hébraïque signifiant secourir), comme l’on marque d’une pierre blanche un événement remarquable ou une chose positive. Et donc le personnage d’Edwards s’appelle, en quelque sorte, « Pierre du bon secours » ; ce qu’il sera finalement, lui qui, en toute fin, va laisser son héritage au jeune peintre, qui fut aussi ce voyou qui naguère, avait détruit sa serre. Mais quel regard jette-t-il sur ce jeune homme qui le prolongera et lui assurera l’éternité, ce pourquoi le livre est précédé de ce curieux en-tête : « propriété de neville falla » ?
« Pendant une seconde, je l’ai détesté parce qu’il était jeune et beau, et que je n’étais qu’un vieux crabe. Il avait toute la vie devant lui, alors que moi, je n’avais plus rien à en attendre ; mais mon aversion n’a pas duré. Il était bien plus beau que je n’avais jamais été et je me réjouissais à l’idée qu’il serait sur terre lorsque j’aurais disparu. »
Tout est dit, dans cette phrase, du caractère du bonhomme. C’est un être profondément bon, humain, détaché de toutes ces contingences matérielles qui affectent tant le monde et l’humanité : antimilitariste et anti-police (« Je ne comprends pas comment un policier peut être chrétien. Il ne sert clairement pas le même maître »), une sorte de Diogène méprisant les vaines richesses et ce fameux progrès qui, selon lui, ne constitue pas une avancée — « Le progrès, c’est la carotte pendue devant l’âne pour le faire tourner en rond » — , pas très tendre pour la religion, ou du moins l’idée qu’on s’en fait — « Le Christ que je soutiens, dit le personnage si attachant et tragique de Raymond, son cousin, endure toutes les souffrances du monde et se fout pas mal du péché » —, étant toujours plein d’indulgence et de générosité, avec dans la bonté et le désabusement quelque chose qui peut rappeler aussi l’Alexis Zorba de Kazantzakis, son contemporain. Un même regard désabusé de vieil homme qui a tout vu et tout vécu, indulgent ou compatissant face à la faiblesse humaine, et un cœur broyé de tendresse, n’hésitant pas à nous asséner cet aphorisme si insolite : « La vie est un enfer quand on est heureux ! » Mais lui, Ebenezer, en reste à la leçon de sagesse de sa mère, pétrie de Bible, et lisant devant lui l’Apocalypse et sa liste si terrifiante des damnés de la terre — « les exécrables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs » — à qui Jean promet « l’étang ardent de feu et de soufre », sa pieuse mère dont il nous laisse cette émouvante notation :
« Elle s’est arrêtée de lire, a posé sa loupe et m’a regardé d’une drôle de façon. ‘’C’est dommage, a-t-elle dit, vraiment dommage !’’ et ses yeux usés se sont emplis de larmes qui ont éclaboussé les pages devant elle. »
Comment s’étonner que ce mécréant, qui aimait tellement sa mère, ait ajouté en dictant au notaire son testament, une phrase des plus admirables de ce récit ?
« Je lègue mon âme à mon Créateur. Quant à mon corps souillé de péchés, il devra être enterré avec ceux de mes pères et de mes ancêtres dans l’église du Vale, où carillonnent les cloches et où souffle le vent. »
Pour ceux d’entre nous qui vont, en voisins, à Guernesey admirer Hauteville House, la maison, sublimement baroque, de Victor Hugo, on recommandera, de surcroît, la lecture de ce stupéfiant et admirable Livre d’Ebenezer Le Page. Il n’est pas de meilleur guide pour apprécier et sentir en profondeur l’île de Guernesey. Ajoutons que le roman de G.B. Edwards a pu sans peine être tenu pour l’un des plus grands romans du XXe siècle.
Et si l’on demandait à Ebenezer — et donc à l’auteur— pourquoi il avait rédigé ces cahiers mémorieux, il répondait avec cette étonnante modestie tout en définissant bien la visée de son livre :
« J’écris pour me tenir compagnie, en réalité. Je ne pense pas que quelqu’un ait jamais envie de lire ça. C’est l’histoire de ma vie, mais il y a aussi beaucoup de choses sur ma famille, mes amis et des gens qui ont vécu à Guernesey ces soixante ou soixante-dix dernières années. »
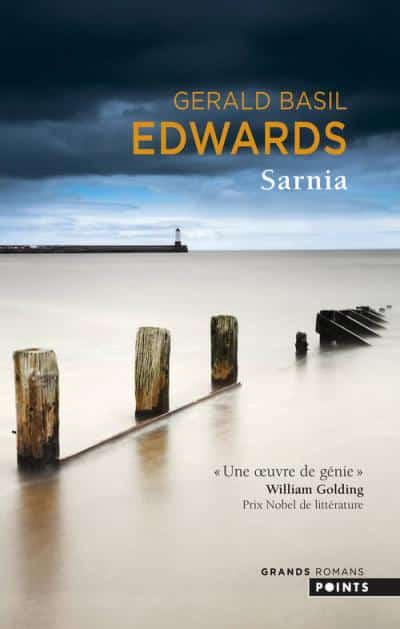

Très émouvant portrait d’un monsieur qui a bien connu la vie et en même temps, chose rare, sut bien écrire.