Eric Vuillard s’est installé à Rennes il y a six mois. Il a reçu le Prix Franz-Hessel 2012 et le Prix Larbaud 2013 pour « Congo » et « La bataille d’Occident » parus en 2012 chez Actes Sud. Son très beau récit « La bataille d’Occident » sortira en poche début mars, chez Babel. En même temps paraîtra la traduction allemande de « La Bataille » sous le titre Ballade vom Abendland, chez Matthes & Seitz Berlin.
La Bataille d’Occident raconte un épisode de la Première Guerre mondiale. Votre récit est paru en 2012. Il résonne avec l’actualité en cette année 2014 et sort en poche. Ce n’est pas non plus un hasard si la version allemande sort cette année…

La Bataille n’est absolument pas un livre commémoratif. Comme vous le rappelez, le livre est d’ailleurs paru en mars 2012, en même temps que Congo. Il ne s’agit pas seulement d’un récit de douleur, le livre possède un versant satirique assez étranger à l’aspect solennel ou compassionnel des commémorations.
Alors pourquoi 1914 ?
La guerre de 14-18 (ou 14-19 pour les Allemands) est à la fois obscure dans ses causes, brutale dans son déclenchement et terrible dans ses effets. Ce qui m’intéresse est le lien avec notre temps. Nous vivons aussi une époque incertaine ; nous sommes dans l’impossibilité de savoir ce qui nous arrivera, du coup la brutalité du déclenchement de cette guerre nous fascine. Et puis, le dispositif diplomatique complexe à la veille de la Première Guerre peut évoquer la structure apparemment savante et durable de nos institutions supranationales. Tout cela semble garantir la paix. Pourtant, quelques coups de revolver à Sarajevo ont suffi pour tout faire voler en éclat…
Justement, parlons de cette articulation, de la manière dont la littérature s’empare de l’Histoire.
La très grande opacité de cette guerre invite à écrire pour comprendre. C’est déjà une guerre moderne, mécanisée, très rationnelle, et en même temps elle porte en elle quelque chose d’insaisissable. Sa violence, qui est en partie la conséquence de son rationalisme, nous effare. Il me semble que l’écriture peut faire apparaître des vérités qui ne sont pas données au départ. C’est qu’en écrivant, on tâtonne, on bifurque, on se confie aux puissances du langage. Parfois, on ne parvient à rien, il faut s’arrêter, le récit ne prend pas… et puis d’autres fois, on est emporté et l’écriture nous révèle quelque chose.
À la recherche de la vérité de l’Histoire, par l’écriture, vous forgez un nouveau genre littéraire…
 Ce qui me plaît dans un livre, c’est une combinaison de forces, lorsque les images, les pensées et la narration se mêlent étroitement. Je suis venu à la littérature par la poésie, par Villon, Rimbaud, Whitman, dont on peut dire qu’ils étaient en rupture de ban. Ils peuvent être à la fois lyriques et débraillés, altiers et inconvenants.
Ce qui me plaît dans un livre, c’est une combinaison de forces, lorsque les images, les pensées et la narration se mêlent étroitement. Je suis venu à la littérature par la poésie, par Villon, Rimbaud, Whitman, dont on peut dire qu’ils étaient en rupture de ban. Ils peuvent être à la fois lyriques et débraillés, altiers et inconvenants.
Pour la prose, c’est pareil, je l’aime riche et négligée. Il faut mêler les registres. Par exemple, décrire les manières des puissants en fourrant un peu d’argot dans ses phrases, comme si on leur mettait des pellicules sur le col, c’est une façon de désacraliser.
Le roman, la prose, a pour projet de nous dégriser ; pour dire un peu brutalement les choses, Balzac nous dégrise du pouvoir et de l’argent, Joyce du lyrisme et de l’épopée. Le premier fait grimacer notre portrait, le second nous rend à la vie ordinaire.
La littérature travaille à défaire le mythe. À ce titre, je crois que le roman a en quelque sorte travaillé contre lui-même, il a ruiné ses propres forces. Il nous a, en partie, délivrés de l’héroïsme, des valeurs morales, des mobiles prétendus de nos actions. Et le personnage de roman a perdu toute aura, il s’est comme dissout dans l’écriture.
Du coup l’Histoire remplace les protagonistes littéraires classiques…
En tout cas, l’Histoire a encore sur nous ce pouvoir ensorcelant. La seule évocation du « Kaiser » ressuscite tout un monde ! En tant qu’écrivain, je suis comme aimanté par l’aura de l’Histoire. Pourtant, je la maltraite sans cesse, je ne travaille qu’à m’y soustraire. C’est une contradiction indépassable mais fructueuse, l’aura active l’écriture, et l’écriture ne vise qu’à la dissiper, la détruire. Au fond, la fiction, ce n’est pas tant d’inventer des histoires, ce n’est peut-être rien d’autre que cette tension entre l’aura des noms propres, qu’il s’agisse de Rastignac ou du Kaiser, et une sorte de répugnance à la grandeur, de défi au simulacre, une libido qui ne se satisfait pas des mythes, mais exige davantage de réalité.
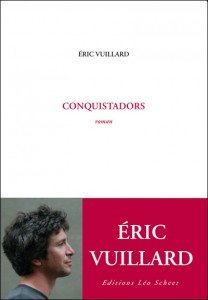
Et puis l’Histoire, c’est une aventure collective extraordinaire, elle nous emporte tous, même l’Histoire ancienne nous concerne et nous touche. Ses protagonistes n’ont rien à envier aux personnages de roman. Prenons l’exemple de Schlieffen qui occupe une place importante dans La Bataille d’Occident, voilà un homme qui a passé toute sa vie à planifier une guerre en dehors de toute raison politique, sans que son pays ait subi la moindre agression. D’ailleurs, il invente une sorte de fiction, lui aussi, il passe toute sa vie à rêver une guerre, à la prévoir, à la désirer, à l’imaginer…
Quelle œuvre littéraire affectionnez-vous particulièrement ?
Les Misérables sont écrits dans une tension formidable, on y trouve deux registres : la narration et la description. Ce sont deux écritures. On a tendance à négliger la description, on la dit même ennuyeuse. Je crois l’inverse. Les descriptions chez Hugo sont d’une densité incroyable, elles marquent son rapport au monde, à la réalité et à l’Histoire.
Et le processus de l’écriture en lui-même, le passage de l’Histoire à la littérature, comment se déroule-t-il ?
Dans un élan ! Je me charge comme une pile, et un beau jour, je me lance. Parfois, le courant m’entraîne, ça avance, le rythme prend. D’autres fois, c’est un bide, je m’ensable… Je range alors tout ça dans un tiroir. Le temps passe, je me jette dans d’autres textes, et puis je reviens parfois à mes tentatives avortées. Je tente à nouveau le coup. Et parfois, ça marche ; il arrive même que je m’aperçoive alors que le livre était presque là, presque fini, et je ne l’avais pas vu.

Ainsi, Congo est né d’un seul coup, mais La Bataille est venue en deux-trois fois, après deux ans de purgatoire.
Vos livres semblent aussi liés entre eux. Le court récit Congo par exemple a paru conjointement avec La Bataille d’Occident en 2012. Est-ce une sorte de préambule au cataclysme de 14 ?
En effet, Congo décrit cette réunion hallucinante entre les puissances européennes à Berlin, en 1884, qui se conclut par un partage de l’Afrique, avec, en prime, le Congo, un État qui est, en fait, la propriété privée du roi des Belges et de ses commettants. Le livre fait le portrait de cet étrange et fragile équilibre européen, où le colonialisme est un élément parmi d’autres de marchandage. Bien sûr, cela prépare le terrain d’où surgira la Première Guerre.
C’est avec Conquistadors que j’ai commencé à raconter par fragment cette séquence de notre Histoire. Je ne l’avais pas prévu. Il y a cinq cents ans, l’Occident s’est lancé à la conquête du monde. Chacun de mes récits aborde un épisode de ce grand feuilleton, le nôtre, qui est par sa portée universel. Je cherche de livre en livre des éclaircissements. C’est comme si une vérité fuyante se livrait par morceaux, renouvelant mon désir et rectifiant mon dessein.
Justement, qu’en est-il de votre nouveau livre qui paraîtra à la rentrée de septembre chez Actes Sud ?
C’est un livre sur la naissance du spectacle de masse aux États-Unis. Cette histoire a lieu en même temps que les derniers massacres d’Indiens. Ce livre raconte donc deux histoires, la vraie et la fausse, en quelque sorte. C’était d’ailleurs là une des principales difficultés ; et j’ai mis quatre ans à le terminer. C’est à la fois un livre sur le grand spectacle, la Wild West Show de Buffalo Bill, et sur les dernières guerres indiennes.
Il était très difficile d’adopter un ton juste – les Indiens ont été folklorisés, toute cette Histoire est associée au Western, rabattue sur lui. C’est qu’entre les derniers rescapés indiens et le monde américain, il n’y a pas de communauté de destin possible. Les Indiens sont falsifiés, défigurés par la grande fable américaine. Or, il ne fallait pas que le spectacle l’emporte, que la parodie corrompe le livre, que les mises en scène de Buffalo Bill édulcorent les malheurs survenus et les changent en fables.
Est-ce donc toujours ainsi : deux récits, la vraie et la fausse Histoire ?

Il n’y a pas une vraie et une fausse histoire, c’est une facilité de langage pour me faire comprendre, mais ça ne peut pas se poser en ces termes. Il y a cependant toujours deux récits. C’est une lutte entre des intérêts humains, des points de vue si l’on veut.
Parfois aussi, l’Histoire est muette, il n’y a pas de témoignages, et la littérature s’engouffre dans cette brèche. La littérature donne voix à une souffrance sans archives.
Un dernier mot : vous réjouissez-vous de la sortie en poche de La Bataille ?
L’essentiel de la littérature, je l’ai découvert en poche, cela coûte moins cher. La sortie du livre en poche est donc une joie.
Propos recueillis par Nicola Denis
traductrice allemande d’Éric Vuillard et Mayennaise d’adoption depuis 1995
