L’Usine d’Hiroko Oyamada, paru aux éditions Christian Bourgois, est une ville dans la ville, un immense complexe à la réputation prestigieuse. À travers l’histoire de trois nouvelles recrues, l’autrice pointe du doigt ces grandes entreprises qui promeuvent faussement le bien-être, tout en dénonçant la précarité sociale.
« L’usine est grise, et lorsque j’ai ouvert la porte du premier sous-sol, une odeur d’oiseau m’a envahi les narines », ainsi commence ce récit d’une vie à l’usine, incipit des plus remarquables qui dit tout en si peu de mots : la noirceur du jour, le monde d’en bas et le remugle animal. Nous savons minimaliste l’écriture nippone, et là, Hiroko Oyamada, jeune romancière quadragénaire, dans le jeu de masques de ses trois protagonistes, plus quelques figurants sans visage, nous renvoie au dépouillement stylisé du théâtre Nô, à son atmosphère simplifiée et à ses allégories existentielles, dans une stupéfiante économie de moyens. Phrases simples dans un alignement monotone, gestes et attitudes ritualisées, au service d’une intrigue qui tient tout entière dans la vie des ouvriers d’une usine et leur vain affairement.

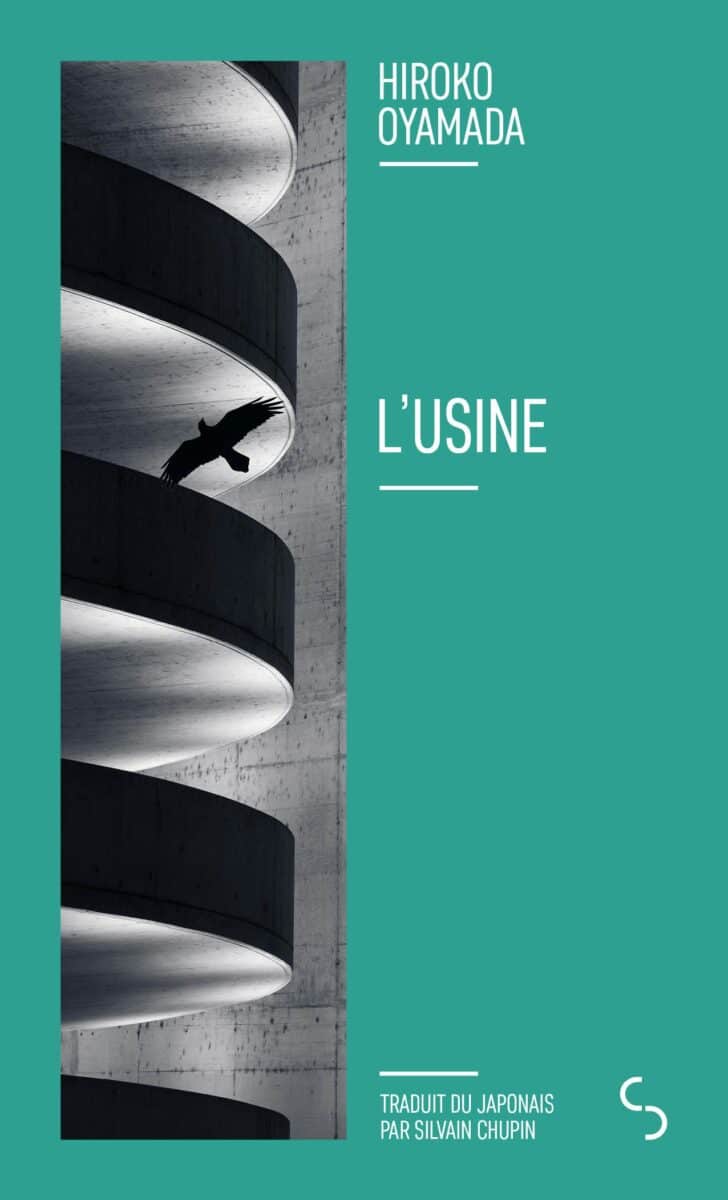
Et quelle immense usine ! Plus qu’un bâtiment ou un ensemble d’îlots laborieux, c’est toute une ville qui la compose, avec ses rues, ses commerces, son fleuve, son pont, un corps entier de béton et de grisaille, envahi de mousse pourrissante et de nuisibles, où s’agite une faune d’ouvriers et de bureaucrates, mêlée à celle, plus subtile ou souterraine, de ragondins, de lézards et d’oiseaux noirs. Une femme et deux hommes sont sur le devant de la scène, employés à n’importe quoi, la jeune Yoshiko Ushiyama, diplômée de lettres et de linguistique, se voit affectée au service de reprographie comme vacataire, vouée désormais, des heures durant, à la répétition de mêmes gestes peu exaltants ; le frère de celle-ci, ingénieur de formation et chômeur intermittent, est engagé comme intérimaire à la correction de textes divers auxquels il ne comprend goutte et passe son temps dans une hébétude permanente ; l’étudiant-chercheur en biologie Furufué, contracté, lui, à plein temps comme bryologiste, spécialiste donc des mousses, est affecté à la végétalisation des toits de l’immense complexe, mais l’étude des sporanges se prête-t-elle à la poésie et à quelque enthousiasme ? Chacun a le nez fourré dans la nullité de sa tâche, car le premier personnage est vissé toute la journée à la déchiqueteuse qu’on alimente, feuille par feuille, de milliers de documents secrets avec interdiction de les lire ; le deuxième use sans fin du crayon rouge sur d’abscons documents, dans un ordre des plus disparates, où tout lui échappe ; et le troisième a l’impression d’être payé pour bailler aux corneilles – oiseaux noirs grillageant le ciel – en expliquant aux visiteurs, lui qu’on affuble du sobriquet de « Docteur Mousses », la nature stérile d’humides mousses. Les seuls vocables qui qualifieraient leur tâche respective sont inanité, monotonie, ennui. Le directeur des ressources humaines, Gotô-san, n’est pas plus avancé qu’eux, tout dans son discours est évasif et foireux, et nul ne sait à quoi il sert au juste dans l’immense toile d’araignée du travail en usine. Au demeurant, une usine dont aucun ne sait vraiment ce qu’elle fabrique ni n’en voit la couleur.
« Je passe mes journées à actionner des machines dans l’ « espace déchiquetage » situé tout au fond du sous-sol, et rempli de déchiqueteuses faites pour détruire de grandes quantités de feuilles de papier. »
Tout est dit sur l’objectif de cette usine, la portée et la valeur du travail qu’on y fait. Ce n’est pas une usine de production, mais de destruction, et la vie de l’employée soumise à son contrat d’engagement n’est au bout du compte rien d’autre qu’une machine à produire le rien, un néant, un acte non d’utilité mais de futilité. Revient-on à la parole du sage prédicateur : « Vanité des vanités, tout est vanité » ? La perspective est tout autre, qui embrasse de cet œil froid de l’autrice, la société industrielle, régie par le taylorisme, et sa vocation. Qui est, ici, exemple à la clé, la destruction de l’humain.
On se demande ce que viennent faire tous ces animaux mêlés aux hommes : ces innombrables ragondins qu’on avait importés au Japon pour leur fourrure et qui, mis au rebut, se multiplient à l’infini autour des canalisations ; et puis ceux qu’on appelle les « lézards des lave-linge » qui, contrairement à leur vocation d’insectivores, ne se nourrissent que des déchets déposés autour des machines ; et enfin et surtout, ces oiseaux noirs qui tournoient dans le ciel – si l’on a la chance de mettre le nez dehors – et au-dessus du pont qui semble être la seule évasion possible. Ces corbeaux noirs sont une espèce de cormorans appelés « cormorans de l’Usine », car produits, entretenus et proliférant par elle. Ce volatile ressemble, en fait, à un pélican et il est noir jusqu’au bout des ongles :
« Il est entièrement noir. Les ailes bien sûr, mais aussi le bec, les yeux et jusqu’aux pattes. Si on le plume, on voit que sa peau aussi est noire, et seul le blanc de ses yeux ne l’est pas. »
En fait, ces curieux volatiles qui ne vivent qu’à l’Usine sont le résultat de la transformation progressive des ouvriers. Ainsi qu’on l’apprend au dernier chapitre, quand chacun a satisfait à sa tâche, la métamorphose – terme kafkaïen s’il en est – s’opère. Ainsi du spécialiste des mousses qui, en fin de course et de récit, constate sa transformation physique (avec un zeste d’humour de la romancière) : « Sentant une petite démangeaison autour des lèvres, j’y porte la main et me rends compte que ma barbe a beaucoup poussé. Les doigts me picotent. Je ne sais pas ce que c’est mais ça fait plusieurs centimètres de long. J’ai à peine le temps de frémir d’horreur, c’est déjà trop tard. Mes mains et mon corps sont entièrement couverts de plumes. »
Tandis que le relecteur d’épreuves, toujours aussi déconcerté par son absurde tâche, plonge dans un sommeil végétal, sa sœur, la protagoniste première du récit, connaît à son tour l’étrange métamorphose : « À l’instant où je glisse dans la déchiqueteuse les dernières feuilles du conteneur posé à mes pieds, je suis devenue un oiseau noir. Je vois les jambes des gens, leurs bras. Je vois une masse grise, je vois aussi du vert. Une odeur de marée m’envahit les narines »
Et le livre se referme comme il avait commencé, quand « une odeur d’oiseau » pénétrait ses narines. Promesse du travail au sein de ces chômeurs heureux, au départ, d’avoir décroché un emploi, pour précaire qu’il soit, et accomplissement de la promesse d’une société – lâchons le mot – capitaliste : la déshumanisation. Cependant nous sommes loin du roman prolétarien, du type 325.000 francs (Corrêa, 1955, réédité chez Buchet-Chastel en 2003), de Roger Vailland, montrant la machine mutilant et détruisant l’homme, ou des Damnés de la terre (Grasset, 1935, réédité par Les Bons Caractères, 2007 ), du romancier populiste Henry Poulaille, voire du Sang noir, au message humaniste, de Louis Guilloux. Nous sommes là dans un Japon, fort présent par sa cuisine – ramen, kimchi, thé vert, tempura, miso, mochi aux haricots rouges… –, ses plaisirs – dont ce jeu de pierre-feuille-ciseaux (shisa) appelé ici chifoumi et qui, inventé par les Japonais, émigra ensuite en Occident (et on le pratiquait même à Alger) –, et la courtoisie ritualisée en d’infinies courbettes. Ce récit, loin de tout message et de tout didactisme – car l’organisation du travail au Japon n’est ici qu’un prétexte –, est une fable, fortement inspirée par Kafka pour l’allégorie, et par Vargas Llosa, pour un style mêlant, dans les chapitres dialoguées, le je et le il dans une tentative réussie d’indétermination ou d’impersonnalisation, ces deux influences littéraires étant, par ailleurs, revendiquées par Hiroko Oyamada ; et l’on se souviendra de l’ombre de l’écrivain pragois projetée par le grand aîné de la romancière, Haruki Muramaki dans son roman Kafka sur le rivage –海辺のカフカ Umibe no Kafuka – (Belfond, 2006), chef d’œuvre d’analyse psychologique (dans le sillage, certes, du génial Yukio Mishima) au cœur d’une réalité marquée par l’absurde où l’on croise un vieillard analphabète qui sait parler aux chats à un garçon nommé Corbeau – mais nous savons justement que « corbeau » se dit kafka en tchèque –, et nous avons là la mention initiale de ces drôles d’oiseaux noirs qui ouvrent et referment le stupéfiant et attachant récit d’Hiroko Oyamada. Un petit livre qu’on lira d’une traite, surpris et séduits, bercés par le flot monotone de phrases volontairement neutres, jamais emphatiques ni excessives, dans un dénuement voulu qui est à l’image même de ces grands Tchèques que furent Kafka et Kundera, et qui sert admirablement les gestes mesurés des comparses de ce grand théâtre du Japon.
Hiroko Oyamada, L’usine, Traduit du japonais par Sylvain Chupin, éditions Christian Bourgois, 2024, 210 p., 9,50 €

C’est un fait, le travail dénué de sens déshumanise, abrutit l’homme au point de le rendre proche de l’animal, même si les bêtes elles-mêmes, à l’état naturel, ignorent tout du travail, à moins d’être asservies par l’homme. Une prouesse du traducteur que dêtre parvernu á restituer la musique de la langue japonaise!