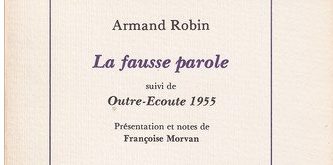«Une coagulation de tout le réel en des grottes mortelles, une gélification de toute la vie en féeries glaciales, en stalagtites et stalagmites [sic] aux effrangements desquels bouge en un va-et-vient de halos inquiétant on ne sait quelle matière extra-humaine, voilà ce qui, à travers ces gigantesques épandaisons de mots, me semblait universellement tenté.»
«Inlassablement, jour et nuit, l’appareil jette contre le cerveau un gigantesque chaos de nouvelles; or on dirait que jamais rien n’est dit et que ce qui est dit n’est jamais rien; il n’y a plus d’événement; l’auditeur se trouve devant une universelle absence de véritables nouvelles, devant une mondiale “ananguélie”; tout se passe comme si une muetteté encore inentendue s’allongeait peu à peu sur tout pays, masquée jour et nuit, sans une seule seconde d’interruption, par un tumulte orgueilleux.»
Tous ces petits blogueurs insignifiants, tous ces journalistes laborieux, tous ces auteurs qui font leur livre comme on fait d’autres choses nous poissent les oreilles et les yeux de leurs textes si peu virils et malodorants.
Renaud Camus, Gabriel Matzneff, tant d’autres d’un âge moins vénérable mais tout aussi bavards, qu’ils se taisent, qu’ils cessent de se contempler dans le miroir pitoyablement ridicule que leur tendent quelques polichinelles faits femmes, hommes, lecteurs de si basse extraction qu’ils en oublient de protéger leurs auteurs contre leurs propres démons infantiles.
Qu’ils se taisent, afin que, s’oubliant, ils puissent accéder à cette «non-langue de toutes les langues», afin que, laissant de côté quelques minutes leur langue gonflée d’eux-mêmes, leur écriture poissée à force d’éjaculer l’éternelle ritournelle de leur petite personne, ils puissent goûter aux «merveilleuses bamboches où plus rien [d’eux] ne [les] espionne» qui fut l’unique but du poète et écrivain Armand Robin.
C’est mon troisième songe, lequel ne concerne pas directement la littérature (le premier, le deuxième), dans lequel je me suis enfoncé très profondément. Je ne vois presque plus rien de la lumière qui, là-haut, très loin au-dessus de ma tête, n’est plus qu’une minuscule lueur, presque plus faible que les étranges scintillements qui éclairent, comme des fantômes recouverts de pierreries lumineuses, les profondeurs noires et glacées, cependant pas vides de monstres qui jamais ne recevront de nom.
Suis-je assez profondément enfoui pour m’oublier ? Suis-je assez fort pour retenir ma respiration et, après, paraître dans les premières lueurs en «danseur titubant, en sobre ivrogne exécutant les figures du non-moi» ?
Sans doute peut-on mesurer la déchéance intellectuelle profonde qui caractérise notre époque au fait que ses élites semblent avoir oublié (si tant est qu’elles l’aient jamais connu, je songe à quelques-uns de mes professeurs de journalisme) un ouvrage aussi profondément juste et impressionnant, sur le sort du langage en temps hyper-médiatiques, que La Fausse Parole (1), publié en 1953, près de vingt ans après le retour, pour le moins profondément désenchanté, de son auteur d’URSS.
Il est vrai que cet ouvrage déroutant, fulgurant même, poétique au sens où ses analyses ne sont pas d’ordre linguistique comme celles que Klemperer rendit familières dans son étude magistrale sur la langue du Troisième Reich rebaptisée LTI, avait de quoi indisposer la majorité des intellectuels qui, dans les années 50, n’avaient de cesse de haler leurs figures pâles au soleil rouge qui, pour des dizaines de millions de Russes et d’autres nationalités, signifia une mort assurément plus rapide que celle que provoque un cancer de la peau.
Une raison, plus profonde, explique aussi cet oubli de l’ouvrage d’Armand Robin et, plus largement, de l’ensemble de l’œuvre inégale mais passionnante de ce prodigieux polyglotte. Cette raison tient à la volonté de l’auteur de disparaître en tant qu’écrivain, comme il ne cesse de le répéter dans La Fausse Parole : «Sans parole, je suis toute parole; sans langue, je suis chaque langue. D’incessants déferlements de rumeurs tantôt m’humectent et me font onde, tantôt m’affleurent comme d’un destin de calme promenade et me font sable, tantôt me choquent et me font roc. Je m’allonge en très immense et très docile plage où de vastes êtres collectifs, nerveux et tumultueux, abordent en gémissant élémentairement» (p. 35).
C’est probablement cette condition anarchiste au sens le plus noble du terme, prodigieusement apatride (2), se voulant entièrement dépersonnalisée, exposée dans des recueils poétiques aux titres évocateurs comme Ma Vie sans moi, qui explique le fait qu’Armand Robin, dans une sorte d’état second, a pu pénétrer très profondément dans ce qu’il appelle la monotone ondée du sous-langage (p. 91) : «je saute le mur de l’existence individuelle; par la parole d’autrui, je goûte à de merveilleuses bamboches nocturnes où plus rien de moi ne m’espionne» (p. 36) et encore : «Si je tiens encore quelques instants dans la vie d’autrui, je pourrai paraître dans les premières lueurs en danseur titubant, en sobre ivrogne exécutant les figures du non-moi» (p. 37).
Cette dépersonnalisation aura, nous allons le voir, une dimension beaucoup plus dangereuse et obscure.
La première caractéristique du sous-langage qu’est la fausse parole réside, selon Armand Robin, dans son irréalité ou plutôt, sa puissance de décréation, parfaitement capable d’ériger un univers-reflet, simulacre remarquable du nôtre : «Ils ont troqué, en calculateurs étourdis, toute substance contre seulement sa semblance; puis, ne disposant plus que de l’irréalité, réduits à jouter l’un contre l’autre dans l’épiphénomène, ils ne peuvent que se livrer des combats inexpiables, avec inédits massacres, pour maintenir à tout prix leur situation dans le monde spectral des “puissances nationales”, des “régimes sociaux”, des “forces politiques”, pour sauver leur place très exiguë sur la très mince pellicule des apparences» (p. 39). L’irréalité que décrit Robin au travers de termes évoquant le monde des spectres et de la semblance, comme celle que décrivit le juge Pierre de Lancre confronté à une épidémie de sorcellerie dans le pays du Labourd, est inconstance évoquée par cette image d’une giration incontrôlée qui sera plusieurs fois employée par l’auteur et que l’on retrouvera, mais appliquée à la noria de livres devenus pures marchandises, dans l’essai d’Alain Nadaud intitulé Malaise dans la littérature : «Des univers géants de mots tournaient en rond, s’emballaient, s’affolaient, sans jamais embrayer sur quoi que ce fût de réel» (p. 54).
Étonnamment, nous croyons lire dans les phrases suivantes, avec quelques années d’avance, la trame d’une de ces histoires inquiétantes inventées par Philip K. Dick telles qu’Ubik ou Le Maître du Haut Château, où la réalité semble non seulement dédoublée par une profondeur maléfique mais encore contaminée par l’existence même du simulacre. Le mensonge, s’il ne peut rien contre la vérité sinon la salir durablement, peut toutefois, surtout lorsqu’il est proféré à des doses massives par la propagande moderne, la rendre malade ou même aller jusqu’à la pervertir (3), parfois provoquer le désespoir, conscient chez les plus chanceux ou intelligents, de millions d’êtres : «le fait que des millions d’hommes sont tués dans les conditions les plus sottes et les plus ironiques, que des millions encore plus nombreux sont tués d’une mort qu’ils ne connaissent même pas, d’une mort qui les laisse apparemment vivants, automates de la personne spontanée qu’ils furent, décapités et désensibilisés, le fait qu’on ne dit pas aux hommes que la mort en pleine vie à eux destinée en ces temps est une mort qui ne paraîtra pas la mort, mais qui plus mortellement les cadavérise, ce fait est le seul fait» (p. 44).
On comprend dès lors qu’Armand Robin puisse, tout proche, peut-être, du découragement, déclarer que le «pouvoir d’expression vient d’être ôté de la surface du globe; aucun mot pour nommer la situation réelle où nous sommes tous. L’homme continue à remuer les lèvres, mais tout usage de sa parole vient de lui être enlevé» (Ibid.).
Pourtant, le salut n’est point une vaine chimère qui se révélerait incapable d’annihiler la puissance de la fausse parole. Ce sont mêmes les toutes premières pages de l’ouvrage de Robin, où celui-ci prétend abolir sa propre identité, qui nous en indiquent la voie périlleuse : l’écrivain véritable est celui qui, s’étant fondu, comme le Virgile de Broch, dans l’océan primordial du Verbe, peut en rapporter quelques bribes qu’il singularisera et universalisera, dans le même mouvement de création, dans ses propres textes. Le salut ne réside que dans la vraie parole, qui elle-même est et ne peut être que poétique : «Au moment où l’être de propagande vous investit le plus fortement et déjà vous voit proie, il est de parfaite vertu conjuratoire de dresser devant lui une parole aussi chargée de vérité que : “Le lion mit à sécher son burnous dans la rivière”. L’innocence du Verbe est là» (p. 31).
C’est ainsi que, «En l’ère de l’Assassinat du Verbe, la liberté consiste à faire n’importe quoi pour opérer le salut du sens des mots» (p. 92). N’importe quoi ou plutôt, absolument tout.
Une telle phrase, cependant, nous fait suspecter, chez celui qui l’a écrite, la tentation du désespoir. Je crois que le mot n’est pas trop fort, même s’il est bien évidemment difficile de soupçonner, sous la plume de Robin, une complexion catholique par trop visible. Pourtant, nous devons remarquer que Robin ne fait pas seulement, de la fausse parole, une puissance chimérique de néantisation. Ce serait trop simple bien sûr car, dans ce cas, nous aurions quelque mal à comprendre en quoi réside la puissance d’un contre-verbe qui serait simple puissance de fausseté. Le danger est plus redoutable, comme nous l’indique, d’ailleurs, Robin; il réside dans la facilité avec laquelle la fausse parole, point complètement désamarrée de la rive de l’être, sert de passerelle commode au non-être : «Cependant, il ne peut être inutile d’étudier les bas-fonds du langage : il est toujours salutaire de décrire correctement les enfers. On découvre ceci : La fausse parole ne peut être tout à fait aussi fausse qu’elle le prétend; et même la non-parole ne saurait devenir tout à fait non-parole; en effet un néant réclamant sa qualité de néant cesse d’être du néant; le négatif-à-l’extrême (et c’est précisément le cas des êtres de propagande) est par définition non-possible, pour la très simple raison que la nature du négatif-à-l’extrême est de tendre à l’inexistence et que tendre à l’inexistence suffit à empêcher d’inexister» (p. 67).
Ainsi, parce qu’elle se tient à la plus ténue jointure entre ce qui est et ce qui n’est pas, parce qu’elle vise à tuer, en l’homme, son âme, la fausse parole se révèle d’essence diabolique. Armand Robin ne peut toutefois nous conduire jusqu’aux abîmes les plus profonds de son analyse, où il nous laissera, cicérone impuissant, nous aventurer seuls, de même que, cette fois-ci comme le Virgile de Dante, il nous laissera découvrir la lumière par nos propres soins : simple image poétique ? Volonté, au contraire, de désigner clairement, une fois pour toutes, l’Esprit qui se tient au centre de l’immense ronde des phrases perfides et mensongères ? Peu importe, le maître de la fausse parole, le dictateur absolu, en somme, c’est-à-dire angélique (4), est nommé sans hésitation par l’écrivain, et l’on se doute qu’une si claire identification du démoniaque n’a point dû peu compter dans le silence prudent ou méprisant qui a entouré son texte : «Une telle entreprise [de propagande], bien qu’elle soit tentée avec cette suprême habileté pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, porte cependant un nom depuis des siècles et des siècles : c’est l’assaut de Lucifer contre l’homme» (p. 81).
De même, il n’est sans doute pas inintéressant de constater que ce dernier extrait provient d’un texte intitulé Au-delà du mensonge et de la vérité où abondent les analyses qui rapprochent la propagande soviétique d’une véritable messe noire (cf. p. 86) (5) : «Le bolchevisme n’est pas athée, il n’est pas matérialiste : il est divin à l’envers. Il faudrait être aussi mécréant qu’un homme d’église pour ne pas voir que ce qui est partout si clairement perpétré est le chantage contre le Vivre-en-Dieu» (p. 89).
Certes, quelques pages auparavant, le Verbe était lui-même considéré comme un être vivant (une personne ?) que l’on aurait assassiné ou plutôt, que la fausse parole serait en train de tuer, comme elle aura tué, métaphoriquement ou pas, des milliers de personnes (6) : «Oreilles closes, j’entends au-delà du déferlement des mots la muette mise à mort du Verbe» (p. 45). Robin répète, quelques pages plus loin, cette formule, écrivant : «Il est donc possible, l’écoute des émissions radiophoniques conduit à le penser, qu’une bonne partie de l’humanité actuelle ne désire plus du tout de vraie parole, qu’elle aspire à être entourée quotidiennement des bruissements des oiseaux de proie psychiques; il se peut qu’elle aide de tout son pouvoir à la mise à mort du Verbe» (p. 52).
Ainsi, quelle que soit la prudence herméneutique avec laquelle on étudie le ou plutôt les textes qui composent La Fausse Parole, nous devons admettre que la plupart des métaphores, en tout cas les plus saisissantes, évoquent non seulement le démon chrétien auquel s’apparente in fine le dictateur mais aussi l’enfer, spectralement silencieux (7) : «Le processus qui mène au langage obsessionnel, c’est-à-dire en fin de compte à la suppression du sens des mots, a quelque chose de fascinant, d’ensorcelant : dans ce surgissement d’un non-langage, il y a comme la promesse d’une nouvelle façon d’être, laquelle, tel le vide, attire et fait chuter; si affreux que cela puisse paraître, nous irions jusqu’à dire qu’à des millions et des millions d’hommes, cette biblique extermination du langage peut apparaître comme un repos inespéré, comme la Terre Promise; le silence totalitaire, parfaitement réalisé sous forme de fausse parole imposée à toutes les lèvres, a ses chances de réussir à hypnotiser une humanité harassée […]» (pp. 51-52).
Sans doute avons-nous, fasciné comme Armand Robin a déclaré l’être à l’écoute du sous-langage, sous-estimé la force de destruction de la fausse parole, sa capacité à nous faire endurer et même aimer notre propre servitude (8) à laquelle ne peut en fin de compte s’opposer que l’innocence (9), moins, donc, telle ou telle œuvre, moins encore celle du verbe poétique (cf. plus haut) ou la matrice même d’une langue rédimée, ressuscitée (10), selon le génial mouvement qu’Hermann Broch décrit dans La Mort de Virgile, que le Christ, réel absent de ce livre que Robin, dans un ultime geste de pudeur et pour respecter tel impératif catégorique et silencieux, a peut-être préféré effacer.
Juan Asensio (lire sur Stalker)
Notes
(1) Nous nous servons de l’édition de La Fausse Parole parue en 1985 au Temps qu’il fait, accompagnée d’une introduction, d’une postface et de notes de Françoise Morvan. En 1995 a paru, aux Éditions Ubacs, une Expertise de la fausse parole regroupant plusieurs textes de Robin présentés par Dominique Radufe. Les deux extraits cités en exergue proviennent respectivement des pages 55-6 et 48-9 de notre ouvrage.
(2) «Je mendiai en tout lieu non-lieu. Je me traduisis. Trente poètes en langues de tous les pays prirent ma tête pour auberge. Je m’embuissonnai de chinois pour mieux m’interdire tout retour vers moi» (p. 33).
(3) «Dans le cas de l’esprit totalitaire, c’est-à-dire (dit de façon très simple) dans le cas de la folie, le contraire absorbe son contraire, de la sorte le principe d’identité est métaphysiquement perverti; le signe de diversité le plus évident est mué en son contraire» (p. 25). Aussi : «D’où, en permanence, chaque jour recommencée, avec un incroyable acharnement, la construction d’un monde purement mythique superposé par tous les moyens au monde réel» (p. 76). Signalons encore ce passage, si étrangement dickien dans son hypothèse : «Peut-être le processus de mutation de l’espèce humaine en une sorte de chose ayant vitalement besoin de non-parole est-il plus avancé que les esprits les plus vigilants ne le soupçonnent; peut-être quotidiennement côtoyons-nous déjà toute une catégorie d’objets, gardant provisoirement le nom d’hommes mais n’ayant de commun avec l’humanité que les formes extérieures irréductibles d’un tout petit nombre de comportements élémentaires» […] (p. 53).
(4) Voyez l’image, remarquable dans ce qu’elle ose tenter de nous faire voir, qui clôt cet étonnant passage : «Si le dictateur possédait selon son rêve l’univers entier inconditionnellement, il établirait un gigantesque bavardage permanent où en réalité nul n’entendrait plus qu’un effrayant silence; sur la planète règnerait un langage annihilé en toute langue. Et cet envoûteur suprême, isolé parfaitement dans l’atonie, loquacement aphasique, tumultueusement assourdi, serait le premier à être annulé par les paroles nées de lui et devenues puissance hors de lui; il tournerait indéfiniment en rond, avec toujours sur les lèvres et dans les oreilles les mêmes mots obsessionnels, dans un camp de concentration verbal» (p. 51).
(5) «Par une rencontre singulière il se trouve que les radios russes parodient à chaque instant le langage religieux, voire liturgique» (p. 86). Ailleurs, c’est le terme de «possession qui est utilisé : “L’enjeu de la partie engagée, c’est le triomphe inconditionnel de l’irréel, donc la capitulation inconditionnelle de toute intelligence et sa descente de cercle en cercle jusqu’à ce dernier degré des abîmes, dans lequel sont répétées sans fin, avec grincements de rouages, les formules à jamais inchangeables de la possession”» (p. 60).
(6) «Seul notre assassinat mental peut les rassasier; ayant besoin pour leur démente faim de ce qui par définition n’est point mangeable, c’est-à-dire de l’esprit, ils rêvent d’établir sur tout ce siècle la dictature de la psychophagie» (p. 42).
(7) Enfer qui est aussi réminiscence éminemment littéraire, dantesque : «En toute langue, le langage séparé du Verbe est mis en circulation autour de la planète en une inlassable ronde où les très brefs arrêts sont de haines adverses qui, pareillement, hébergent, réchauffent, nourrissent, remettent en route ce vagabond dérisoire» (p. 66).
(8) «Mais comment éviter, prostré sous l’appareil à recouvrir la planète de fantômes verbaux rapaces, de songer que des millions et des millions d’esprits pillés sont devenus fanatiquement amoureux de leur épervier pilleur et se sentent en un péril mortel, selon les lois d’un règne métaphysique inversé, sitôt qu’ils ne sont plus mangés ?» (p. 53).
(9) «Seule une pureté de qualité métaphysique, inconnue des codes, des lois, des usages, les décourage définitivement, les dégoûte, leur fait perdre l’appétit» (p. 42).
(10) Le mot figure explicitement dans le texte de Robin : «Alexandre Blok [que l’écrivain a traduit en français] ne pouvait pas savoir de quoi serait fait le langage-qui-suit-la-mise-à-mort-du-Verbe. Une fois assassiné le langage, que peut-on dire encore ? Et de quelle façon ? Et comment rejoindre un Verbe ressuscité ? Du curieux caillou, qui s’est mis en travers de route, que faire ? Que peut bien signifier un langage qui se veut signifiant rien ?» (p. 72, l’auteur souligne).