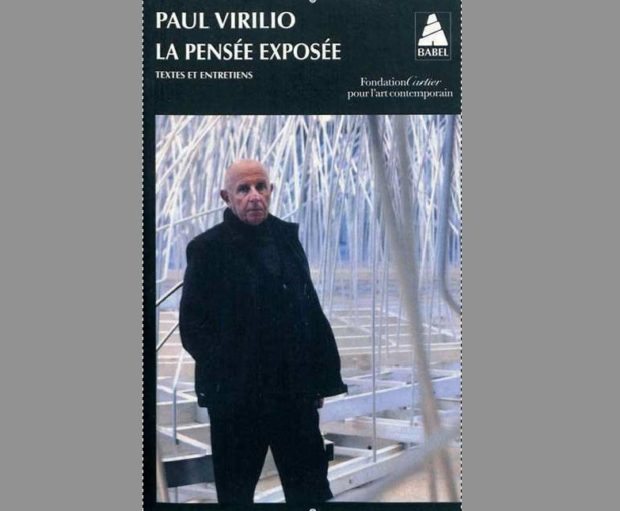La pensée exposée est un recueil de textes écrits par l’urbaniste Paul Virilio, né en 1932. Le volume, paru au format poche chez Babel, est coédité par la Fondation Cartier pour l’art contemporain et contient également une série d’entretiens entre Virilio et différentes personnalités qui sont ou ont été associées à des expositions proposées par la Fondation : le photographe Raymond Depardon, l’écrivaine et journaliste Svetlana Alexievitch, le dessinateur Möbius (Jean Giraud), les critiques d’art Jean de Loisy et Patrick Javault.
Ces textes qui s’échelonnent sur une période de vingt ans, de 1988 à 2008, ne sont pas distribués selon un ordre chronologique. En pratique, cela ne gêne pas le lecteur dans sa découverte d’une réflexion centrée sur des notions-clefs telles que la vitesse et le pouvoir. Paul Virilio observe l’architecture, les villes depuis son enfance marquée par le bombardement de Nantes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un de ses premiers travaux est d’ailleurs une étude du Mur de l’Atlantique, il l’a fait paraître en 1975 sous le titre Bunker archéologie.
Virilio, au fil de sa recherche, développe la notion de dromologie (du grec dromos, vitesse), c’est-à-dire la science ou le discours sur la vitesse. Il analyse en particulier les développements techniques des siècles passés qui ont modifié notre façon de voyager. Cela va de la puissance musculaire, humaine ou animale remontant au peuplement indo-européen jusqu’aux trains d’ondes de la fin du XXe siècle. Les conséquences de ces développements, selon lui, n’ont pas fini de se faire sentir ; elles affectent l’ensemble de notre rapport au monde et même au cosmos. Il est important de comprendre que Virilio, derrière sa qualité d’urbaniste, n’est absolument pas un bétonneur, mais un homme préoccupé par une écologie qui n’est pas encore parvenue à devenir une éthologie, c’est-à-dire une réflexion sur nos attitudes et perceptions en milieu technologiquement saturé.

« …une société planétaire trouve-t-elle toujours le stade de carcéralisation de son environnement, et cette limite est-elle fatale, ou bien des créations d’espaces pliés, dépliés plutôt, des espaces intérieurs autres que des espaces spatiaux, c’est-à-dire des espaces conceptuels, des espaces de conscience, sont-ils possibles ? »
Devant cette interrogation, Virilio ne fait pas montre d’un optimisme béat :
« …la contemplation de l’écran ne remplace plus seulement celle de l’écrit, l’écriture de l’histoire, mais aussi celle des étoiles, au point que le continuum audiovisuel vient succéder à celui, substantiel, de l’astronomie. » (p.135)
L’invention de la perspective, du point de fuite à la Renaissance, a créé une sorte de plaquage horizontal de notre intellectualité après des siècles, des millénaires d’un usage axial de la pensée orientée vers les hauteurs, le ciel. Mais l’accélération de la vitesse et le développement technologique ne permettent même pas de voir l’immensité de l’espace extra-atmosphérique comme autre chose qu’un temps sans espace :
« Si la nature a horreur du vide, la grandeur-nature également. Sans poids et mesures, il n’y a plus de »nature ». Sans horizon lointain, il n’y a plus de possibilité d’entrevoir la réalité, nous tombons dans le temps d’une chute qui s’apparente à celle des anges déchus. » (p.239)
Dans ce monde de mouvance désormais clos sur lui-même, dans ce crépuscule des lieux, les villes, qui jadis possédaient leur centre, image de l’axe du monde (axis mundi), ne sont plus que des hubs, des zones de transit, des interfaces pour individus déterritorialisés : gares, aéroports. Et terminaux cybernétiques. L’horizon humain se limite désormais à l’écran, ce quadrilatère dans lequel un pouvoir prométhéen façonne nos existences :
« Aujourd’hui, on perd le temps de l’écriture, de la lecture, de l’écoute, qui est le propre de l’homme, au profit d’une sorte de perception totale, d’une perception ubiquitaire et panoptique qui est de l’ordre du divin, et non pas de l’humain. Le divin, c’est l’ubiquité, l’immédiateté, l’instantanéité, la simultanéité. Dans nos sociétés modernes, qui sont pourtant des sociétés athées, laïques, nous sommes en train de développer les attributs du divin tout en le niant. » (p.52)
La dromosphère gère l’hypnose mondiale, se fait arbitre des émotions. À l’adhésion ou au rejet que suscitaient autrefois les scissions politiques partisanes succèdent des événements médiatiques dont on va contrôler le dosage :
« D’où cette alternance non plus tellement entre la gauche et la droite classiques, mais entre le politique et le médiatique, autrement dit, cette puissance de gestion (de suggestion) de l’information qui s’apprête à envahir l’imaginaire de populations subjuguées par la multiplication des écrans qui caractérise si bien la mondialisation des »affects » : cette soudaine synchronisation des émotions collectives qui favorise grandement l’administration de la peur. » (pp.90-91)
Corollaire du progrès, la catastrophe devient l’emblème du XXe siècle : Paul Virilio évoque le naufrage du Titanic, l’embrasement du dirigeable Hindenburg, l’explosion de Tchernobyl (dont il parle plus en détail dans son entretien avec Svetlana Alexievitch), l’effondrement des Twin Towers et l’explosion de Toulouse. Il insiste bien sur l’ambiguïté croissante de la nature même de ces phénomènes : accidents ou attentats ? Mais de même que le contrôle télématique planétaire s’exerce sur les affects, ce doute sur la réalité est sciemment entretenu :
« La soudaine mise en relief stéréoscopique de l’événement, accident ou attentat, est donc bien la naissance d’un dernier type de tragédie, non seulement audiovisuelle, mais binoculaire et stéréophonique, où la perspective du temps réel des émotions synchronisées provoque la soumission des consciences à ce »terrorisme de l’évidence » de visu qui redouble encore l’autorité des médias. Accident ou attentat ? Désormais, l’incertitude est de règle, le masque de la Méduse s’impose à tous grâce au casque de Minerve, ou plutôt, à ce visiocasque qui donne à voir sans cesse la répétition (en miroir) d’un effroi qui nous fascine totalement. » (pp.95-96)
Devant la tournure qu’ont prise les choses, mais sans se livrer à un quelconque prophétisme, au sens millénariste du terme, Paul Virilio s’attend à ce que se produise un jour l’accident intégral de notre humanité ; il appelle de ses vœux l’émergence d’une conscience qui ne serait pas seulement écologique, mais pleinement eschatologique. Ce recueil de trois cents pages (assorti d’un cahier hors-texte consacré à des expositions réalisées par la Fondation Cartier) est une fort intéressante introduction à la pensée d’un homme qui a su ne pas tomber dans le piège des sidérations postmodernes. Sa lecture, pour qui souhaiterait échapper à la fatalité du non-événement de la rentrée littéraire, s’avère urgente. Et comme s’il voulait d’entrée de jeu nous aider à lever de nouveau les yeux vers un ciel sans écran, tout le texte est imprimé en lettres bleues. Ce qui est de fait bien agréable.