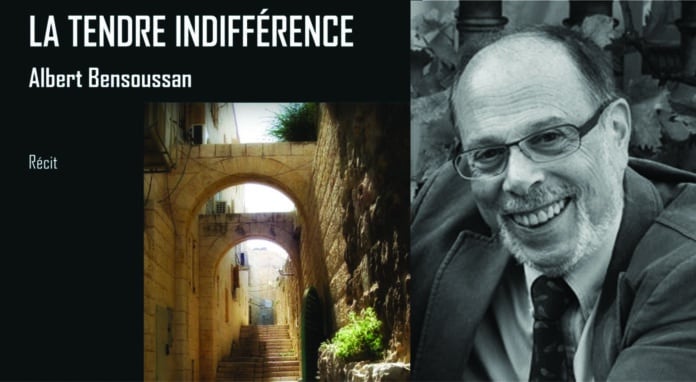« Comme Marcel Proust je pense qu’on écrit toujours le même livre, parce qu’on est hanté par quelques obsessions » C’est la romancière Camille Laurens qui le dit. Albert Bensoussan aurait pu l’affirmer pareillement, tant ses livres depuis Les Bagnoulis en 1965 jusqu’au Vertige des étreintes en 2017 nous amènent et nous ramènent à cette Algérie natale, vitale et nourricière et à ces hommes et plus encore à ces femmes qui l’ont constitué, construit et forgé. Son dernier ouvrage en date, La tendre indifférence, ne fait pas exception. La mère n’est pas au centre du texte comme elle a pu l’être dans L’Anneau. Cette fois, ce sont trois femmes qui tourmentent et taraudent autant qu’elles délivrent et enchantent la mémoire d’Albert, trois femmes qui ne sont plus, Mariska, Amarie, Gemma.
Mariska dort sous une dalle de la nécropole Saint-Pierre à Marseille, « vaste océan tumulaire de cent-soixante-dix-sept mille sépultures. » Albert s’y rend, abandonnant pour quelques jours Leah, son ultime épouse bretonne. « Il faut laisser les morts enterrer les morts ! », lui assène-t-elle pourtant. Mais elle le laisse partir en un dernier pèlerinage du souvenir. « Leah a compris la nécessité de rembobiner les fils à l’heure où se défait la trame, avant le grand départ. »
Mariska, enterrée à Marseille, n’est pas seule à dormir dans la terre phocéenne. Son fils, Dionys, est là, lui aussi, qui repose sous la pierre à quelques allées de la tombe maternelle « cernée de magnolias qui lui font la révérence », à deux pas de la tombe d’Antonin Artaud, pas loin de celle d’Edmond Rostand. Albert se perd quelque peu dans cette « mégalopole du dernier repos », dédalesques chemins de mémoire d’entre-tombes. Dionys, l’inoubliable ami de jeunesse de notre récitant, fut l’enfant unique de Mariska Vetö, « drôle de patronyme, déformation accommodante de Weiss, un nom de ghetto ». Et « comment cette belle hongroise avait-elle pu aboutir à Bône ? » Jeune veuve d’un Grec dénommé Niarkos disparu avant même la naissance de leur fils Dionys, épouse d’un second mari, le dévoué Solomidès – peut-être plus aimant qu’amant – « qui la dépassait d’une génération », Mariska a été « une mère pour moi », avoue le jeune ami de Dionys. Dans la chaleur de leurs échanges, elle finissait par l’appeler « Bobèche et baratom de son fils » retrouvant les mots de sa Hongrie natale.
Comme deux frères éloignés, « toi au pied des Aurès, moi au djebel oranais », réunis un beau matin sur les bancs de la fac d’Alger, enfin inséparables « au sortir des concours et triomphants, [nous] avons poursuivi notre dialogue, jusqu’à ce que la mort nous sépare. » Dionys, l’ami intime, avait aussi des élans amoureux pour son frère d’âme, « comme ce jour de grand soleil où il me prit la main pour traverser, rue Michelet, en pleine foule, et tous nous regardant », Dionys que le sida emporta. Dionys enfin, trait de tendre union entre Mariska et « Bobèche », jaloux sans doute – mais qui des deux l’était plus encore que l’autre ? – de voir la maman danser avec ivresse dans les bras de l’ami si cher, Mariska « jeune femme très désirable », retrouvant la vigueur d’une poitrine pourtant « affectée d’asthme […]. Plus je tournais, plus son souffle était sur ma bouche, haletant, brûlant, étourdissant, et nous faisions tous deux la nique au vertige en tournoyant jusqu’aux plus extrêmes tours et détours, jusqu’à l’affaissement : tous deux déployés, fléchissant, embrassés, écroulés, moi la serrant plus fort, elle crachant l’air sur mes lèvres […]. Et toi, Mariska, laisse-moi te le redire puisque [Dionys] ne peut plus nous entendre : je t’aimais. »
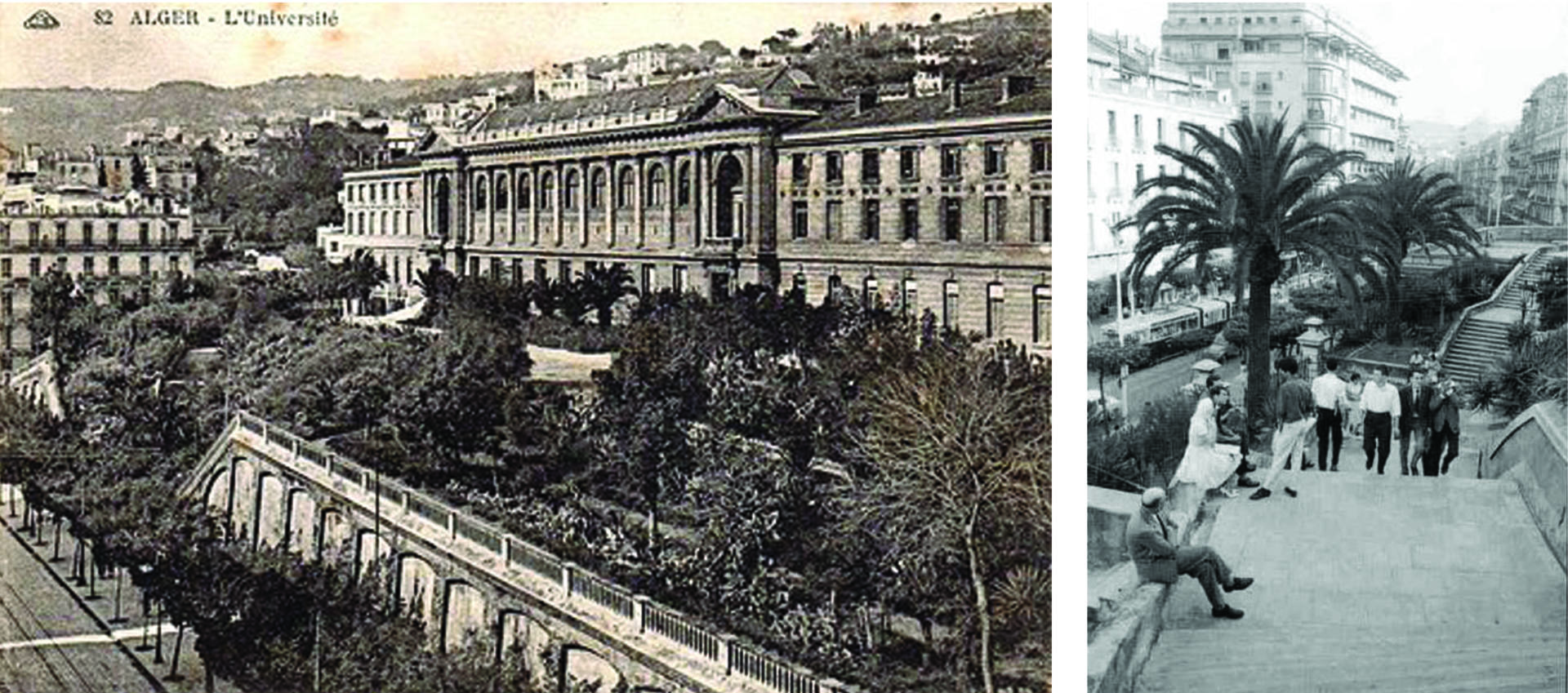
Dionys, encore – décidément plus qu’un frère sans cesse ainsi « à jouer les entre-deux » – se fit trait d’union aussi avec Amarie latinisant comme eux sur les bancs de la fac d’Alger où officiait le grand André Mandouze, étudiante entre deux amis, deux feux, deux cœurs et deux ardeurs, dans une manière de « Jules et Jim » rejouée sur les rives méditerranéennes. Amarie, près de sombrer un jour d’imprudente baignade et de prompte noyade sans les bras et jambes secourables de son nouvel ami, sauveteur qui la pressa fort sur son corps que « la haute mer et le courant emporte en droit fil. […] Le flot est partout, nous encerclant et nous submergeant. Amarie met sa bouche dans ma bouche comme pour pomper mon souffle. J’ai ses cuisses serrées autour des reins. Je suis au-delà de toute fatigue, dérivant dans l’affolement et Amarie qui pèse lourdement sur moi. Or à cet instant, je sais que je bénis ce poids, heureux parce que nous sommes pour la première fois un seul corps porté vers l’absolu, ou le grand vide. Et qu’importe la mort par-delà les vagues ! A vingt ans, le plus bel âge…»

Amarie, sauvée des eaux, trahit l’ami pour un Gwen de Breton qu’elle épousera sans crier gare. Elle retrouvera bien des années plus tard, peu avant son trépas, celui qui fut son jeune sauveur de Méditerranée. Les années n’auront pas éteint la passion de la belle étudiante pour son jeune soupirant. Aveu épistolaire à la veille du grand saut : « Il m’aura fallu quarante ans pour rejoindre mon adolescent ! ». Mais point de pierre tombale que l’amoureux d’alors – et de toujours ? – aurait pu tendrement caresser dans les larmes et l’image de son amour disparu. Seul « un tas de cendres dispersées sous la brise » achèvera de renvoyer plus tristement encore son Amarie aimée amarrée à la mémoire lointaine « de sa jeunesse solaire. »
Dionys, Dieu merci, – « malgré lui et pourtant grâce à lui, j’ai goûté au bonheur et connu l’harmonie » – fut aussi le frère qui lui présenta, un jour de Noël 1960, à Marseille, Gemma « espagnole, bien mieux, catalane » qui devint l’épouse première de notre narrateur. Gemma, précieuse comme la pierre, Gemma que j’ai aimée, nous dit l’époux, le veuf, l’inconsolé, Gemma comme née de deux syllabes à se suivre – j’aime Ma-thilde. Car les femmes et les noms de ce lancinant et « sombre parcours des morts », avancent masqués sous la plume du récitant et compositeur d’une pavane pour trois amours défuntes.

Gemma-Mathilde, la Catalane, pour qui l’aura reconnue, et connue, aura été la femme à la « belle voix grave sur fond de gorge », aux mots et aux regards de feu, à l’accent « très particulier, qui était à la fois espagnol, catalan, voire roussillonnais qui lui était resté des ignominieux camps de réfugiés de Saint, de Gurs ou d’Argelès où l’on avait parqué l’Espagne républicaine en déroute ». Elle fut la compagne d’une longue vie de couple – un demi-siècle sans doute – aux côtés d’Albert, l’ami de Dionys, l’entremetteur d’amoureuses rencontres. Le fils la présentera aussi à sa mère, Mariska, qui sut « reconnaître en elle une sœur et une complice. L’une et l’autre aimaient séduire. Et à l’une et à l’autre, si semblables de stature, si presque pareilles d’âge, j’ai succombé », confesse Albert.
Dans la lente déchéance motrice et aphasique – « rupture des cordes, effritement des vocables, effacement des paroles » -, et l’horrible glissement parkinsonien de Gemma dont peu à peu « le corps agonique se couvrit de marbrures », Albert fut quotidiennement présent pour soulager douleurs et paralysies de l’épouse aidée d’équipes et machines médicales. Et puis un jour, pressant la main de son aimée devenue inerte, Albert s’effondra, tout était fini : « Tu me meurs !… Et j’ai arrosé son visage de mes larmes. Gemma s’en était allée. »
« Trois femmes ont compté dans ma vie et m’ont fait homme […] Mariska, Amarie, Gemma, toutes mes âmes mortes ! »
Ainsi s’ouvre et se ferme cet inoubliable récit testamentaire « soufflant les flammes de ma vie alors qu’elle touche à son terme. » Une apaisante et « tendre indifférence du monde » avait gagné Meursault, l’Étranger de Camus, en son destin final : « J’ai senti que j’étais heureux et que je l’étais encore. » Albert Bensoussan ne dit-il pas autre chose ?
Comment ne pas penser, en refermant ce beau livre, aux Carnets 1978, dernier texte d’Albert Cohen, dernière promenade sur le chemin de sa vie : « Vite me redire stupidement souriant, me redire le temps de mon enfance, vite avant la fin de moi et de mes souvenirs. » Cohen s’attache alors à la mémoire et la tendre figure de sa mère – « [Le livre de ma mère], c’est ma magie pour ne pas t’avoir entièrement perdue » -, et à l’évocation des femmes autrefois aimées qu’il faudrait, écrit-il, réunir dans « une villa à la campagne et aller de l’une à l’autre, et toutes seraient adorables entre elles. » Albert Bensoussan, juif algérien fait rennais, par son attachement à la figure maternelle – Aïcha, essentielle – et aux visages de ses amours disparus, retrouve les obsessions d’Albert Cohen, juif ottoman du Léman, et use page après page, comme son glorieux aîné, de mots tendres et mélancoliques, sève de riches, poétiques et foisonnantes envolées. Magnifique lignée !
La tendre indifférence : récit, par Albert Bensoussan, Éditions Le Réalgar, 89 p. (ISBN 978-2-491560-15-7) 12 €. Parution : 20 mai 2021.
À lire également sur Unidivers.fr :
CONTES DE MIGUEL DE UNAMUNO, MIROIR D’UN ÉCRIVAIN
UN PASSEUR DE MOTS, ALBERT BENSOUSSAN GRAND TRADUCTEUR DE LA LITTÉRATURE LATINOAMÉRICAINE
L’ANNEAU OU LE PARADIS PERDU D’ALBERT BENSOUSSAN