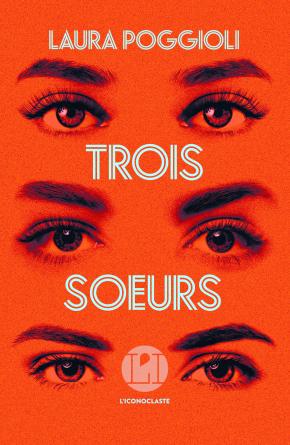D’un fait divers terrifiant, Laura Poggioli fait une œuvre littéraire, Trois sœurs aux éditions de L’Iconoclaste, en résonance avec sa vie propre. La violence faite aux femmes en Russie et ailleurs.
Une phrase : « S’il te bat, c’est qu’il t’aime ». Une injonction mise en exergue, répétée à plusieurs reprises. Un proverbe russe plus précisément qui dans sa brutalité dit tout de ce livre coup de poing.
Une date: 27 juillet 2018. Ce jour-là dans la banlieue de Moscou trois sœurs, Krestina, Angelina et Maria, tuent leur père. Trente six coups de couteau, dix coups de marteau. La déflagration est énorme dans la société russe.
Ce sont ces deux violences, l’une illégitime répondant à l’autre, de défense légitime, que cherche à comprendre et à dire Laura Poggioli dans son premier roman. Elle a des raisons de s’intéresser à ce fait divers qui eut même un écho en dehors des frontières russes. Dans un lycée d’Angers, elle découvre et tombe amoureuse de la langue de Tolstoï. Portée par cet amour, elle séjournera plusieurs mois et à plusieurs reprises à Moscou. Elle vécut même là-bas une passion avec un jeune homme. C’est un motif suffisant. Mais peu à peu au fil de son enquête, de ses visionnages de documents filmés, d’interviews à la télé russe, d’articles de presse, elle va se rendre compte qu’elle a elle-même des raisons plus intimes de s’intéresser à la violence des hommes faite aux femmes. Comme enfouie, dans un phénomène de refoulement bien connu mais toujours applicable, elle constate en écrivant, que son histoire personnelle est emplie de cette violence dont elle a nié la réalité, ou au moins, dont elle a partagé l’existence. Cette violence c’est celle d’un arrière grand-père, d’un professeur au lycée, de son amant russe, d’un amant français pervers et harceleur. Dans un parallèle saisissant, la violence extrême pratiquée par Mikhaïl Sergueïevitch Khatchatourian sur ses trois filles, violence décrite minutieusement dans un compte à rebours terrifiant, côtoie comme une destinée parallèle les souvenirs d’une vie amoureuse marquée souvent par « la dépendance, l’alternance du chaud et du froid – de promesses en agressivité, d’excuses en violences de plus en plus intenses- et enfin mon propre anéantissement ». Pour enfin admettre avoir « tout enterré ».
Cette double écriture conjointe montre combien les violences masculines sont multiples et combien elles sont tues ou cachées. En cela, l’ouvrage n’apporte qu’une pierre supplémentaire nécessaire à ceux écrits depuis quelques années par de nombreuses femmes. Pourtant, ce livre sombre éclaire aussi les différences de nos sociétés actuelles. Il n’est pas écrit que l’homme occidental est intrinsèquement moins violent que l’homme russe, et ce serait une énormité, mais on comprend peu à peu à la lecture des raisons d’espérer dans nos sociétés occidentales et de désespérer de la société russe.
Au pays de Poutine, les « violences domestiques » atteignent des chiffres record que valide à sa manière le proverbe russe. On découvre ici comment le régime communiste de l’URSS en privant chaque citoyen de sa part d’intimité, y compris dans les toilettes collectives, a laissé aux hommes la possibilité de manifester leur pouvoir dans le seul domaine de l’intimité la plus étroite. Celle du foyer. L’état participe lui-même à cette acceptation y trouvant un argument idéologique contre la dépravation des mœurs occidentales et en maintenant le respect des « traditions », celle du patriarcat et du rôle dominant de l’homme. « Il élevait ses filles de manière dure, mais dans leur intérêt pour qu’elles ne deviennent pas des putains » disent en substance les défenseurs du père assassiné. Dans le cas des « Trois sœurs », comme un écho à la pièce de Tchekov, s’ajoute la solidarité masculine des hommes de la communauté arménienne. Le récit reconstitué de la vie du petit appartement est lourd, difficile, mais indispensable pour comprendre le geste ultime des trois sœurs, car « tuer son père c’est aussi tuer une partie de son être », un geste sans doute rendu possible par l’internement d’un mois en hôpital de leur géniteur, un mois sans peur, sans cri, sans viol. Un mois de vraie vie accessible à portée de main si l’homme obèse, ignoble, répugnant, croyant orthodoxe qui chaque dimanche officie religieusement, si cet homme, protégé par les autorités, disparaissait.
En décrivant sans fard les violences faites à ces trois jeunes filles, en racontant de manière transparente sa propre vie affective, l’autrice, au-delà d’une œuvre militante, nous montre comment les combats contre l’obscurantisme ne sont jamais terminés. Ici et ailleurs. Ici pourtant les mentalités évoluent trop peu, trop lentement, mais elles évoluent et la loi l’accompagne. Là, la loi la contraint au silence : La Douma d’Etat a approuvé « début 2021 les amendements Dmitri Vitamine sur la diffamation: les victimes d’abus sexuels risquaient désormais jusqu’à cinq ans de prison pour avoir dénoncé publiquement des crimes ou harcèlements sexuels ».
Un livre difficile donc mais indispensable, une pierre de plus dans le combat des femmes.
Laura Poggioli, Trois Soeurs, paru le 18 août 2022, Éditions de L’Iconoclaste. 260 pages. 20€.