Avec Le ciel de Tokyo, publié aux éditions Rivages le 2 janvier 2025, Émilie Desvaux fait voyager son lecteur au coeur de la mégalopole japonaise en compagnie de Camille, la personnage principale.
Le Japon n’en finit pas de nous fasciner, depuis que Kawabata nous présenta ses Belles endormies et Mishima son Pavillon d’or, sans oublier, plus près de nous, l’ineffable Kafka sur le rivage de Murakami. Après quoi Amélie Nothomb, dans Stupeur et tremblements nous donna un regard européen sur ce monde étranger et attachant, avec une mise en ordre du monde et des règles de civilité si différentes de notre vivre-ensemble. Et aujourd’hui, campant ses personnages dans la « Maison des Étrangers » – Gaijin House –, Émilie Desvaux nous brosse, en nous stupéfiant aussi, un portrait aussi insolite qu’inédit de la mégapole nippone, dans son troisième roman : Le ciel de Tokyo.
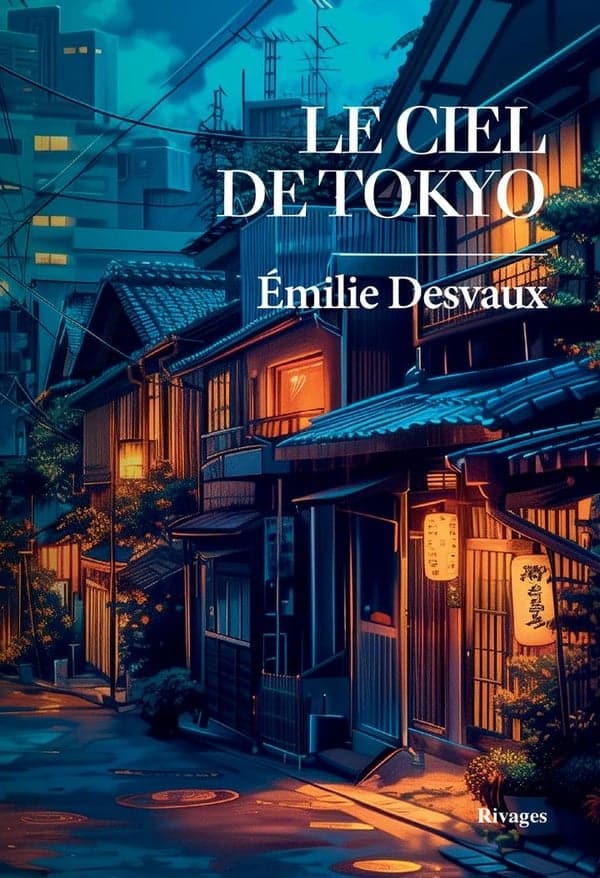
Sans aucun rapport avec le manga intitulé Sous le ciel de Tokyo de Takizawa, publié en 2010, Émilie Desveaux, une Toulousaine dont on sait qu’elle a vécu un an au Japon, entre dans la peau d’une jeune femme de vingt ans, Camille qui, orpheline de mère à six ans, a été élevée par un père scientifique et distrait qui ne s’intéresse qu’à la salamandre de ses recherches – qu’il réussira, à la fin, à se faire reproduire dans l’aquarium de son laboratoire. Elle s’est retrouvée, sans trop mesurer la chose, mariée et, s’ennuyant à mourir en un rien de temps, elle choisit la vie – la survie – et l’aventure et la voilà partie au bout du monde. Elle débarque donc un beau matin à Tokyo, au quartier vieillot, délabré à souhait, d’Asakusa, dans une pension pour étrangers, appelée (et c’est son sens) Gaijin House, « située entre deux immeubles de briques au creux d’une venelle », qui fut naguère une maison de thé, et puis la guerre, et puis la crise, et voilà qu’on n’y trouve, derrière « une façade en planches disjointes et un avant-toit en zinc oxydé », qu’une faune de marginaux venus d’ailleurs, étudiants et expatriés important avec eux leurs problèmes existentiels, leur névrose, leur mal-être.
Posant son sac de routarde, cette Camille est accueillie par un Brésilien, Flavio, installé là depuis des années pour ses recherches sur l’antique Edo, un jeune Belge surnommé Lénine, parce qu’au collège il était impayable en imitant Vladimir Ilitch, et qui vivote en fréquentant des Japonaises mûres et fortunées qui l’entretiennent, puis un Allemand tenté par la mystique shintoïste, ainsi qu’un Chinois et un Coréen qui ne semblent là que pour donner un peu de couleur locale et asiatique. Le lieu de vie commune est la cuisine, dont la description annonce la tonalité de l’ensemble visionnaire : « Des croûtes de friture cristallisaient l’inox des surfaces, les murs arboraient une teinte évoquant les algues, les aquariums putrides, les tasses de thé trop longtemps infusées… » Un sacré choc pour cette Camille qui a laissé derrière elle, sur le vieux continent, un univers si douillet, trop confortable, un père aimant mais dans la lune, un mari peu convaincant, tout ce qui l’a poussée à changer d’air, et la voilà confrontée à cette sinistre réalité : « Elle s’accroupit sur ses talons et avala quelque chose de salé, un gros sanglot, peut-être, une gorgée de mucus et de fièvre, comme si elle venait de gober un coquillage ». Les métaphores de l’auteure, tout du long, ne manquent pas de surprendre le lecteur, tant elles sont, comme le reste, marquées d’étrangeté ou de baroquisme. Puis nous voilà hors ces murs décrépis, et la romancière montre qu’elle connaît bien Tokyo, son histoire et ses avatars :
« Construite sur d’anciennes lagunes marécageuses entre le fleuve Sumida et l’avenue Kappabashi qui marque la frontière de Ueno, Asakusa signifie littéralement ‘’herbe rase’’ ce qui est une façon poétique de désigner les faubourgs pauvres de Tokyo, également appelés Shitamachi, ou Ville Basse. »
Nous pénétrons avec elle dans ce labyrinthe de bicoques et d’échoppes crasseuses, gargotes à sushis, maisons de jeux ou de passe, qui constitue la face cachée du Tokyo central avec ses gratte-ciels et ses enseignes éblouissantes ; et là, bien sûr, dans ce dédale de rues le plus souvent nommées par un numéro, la jeune résidente qui doit trouver ses repères est complètement perdue – comme elle l’était déjà avant de partir – et elle se dit convaincue que « la ville cherchait volontairement à saboter ses projets ». C’est son itinéraire quotidien et sa quête de stabilité qui, au fil des jours et des mois, vont dessiner le récit, entre l’un de ses colocataires qui, pénétré d’aspirations shintoïstes, part au couvent, l’autre plongé dans l’étude et les bibliothèques où il peaufinera une thèse qui, en fin de livre, le propulsera dans une université des États-Unis, tandis que cet autre, qui n’est qu’un petit gigolo tentera, vainement, après tant de coucheries juteuses, d’aimer cette petite Française. Nous pénétrons alors dans divers lieux de beuverie ou de débauche, mais Camille sait voir d’un regard plus serein, au-delà des illuminations clinquantes de Shibuya, le Sensō-ji, le plus vieux temple bouddhiste du Japon, abritant depuis des siècles la statue de la déesse Kannon, au milieu du délabrement d’Asakusa-ku. Du moins est-ce la vision que nous en donne Émilie Desvaux qui choisit ici, plus qu’une vision éloquente et flatteuse de la capitale du Japon, une sorte de rêverie hippie ou mélancolique dans un roman qui est, à proprement parler, un roman d’apprentissage qui verra, finalement, seule parmi tous ces déclassés et marginaux, Camille se faire une place au Soleil Levant. Elle trouvera là un précieux équilibre, devenant ainsi, presque une Japonaise comme les autres : « De toute leur petite bande, elle seule s’était résolue à embrasser son flottement identitaire », note la narratrice. Elle
deviendra la salamandre revivifiée à laquelle rêvait son biologiste de père, lui qui savait que les salamandres japonaises étaient « considérées comme des divinités ».

Dans l’intervalle, et au cours d’un récit protéiforme qui retient et fascine le lecteur, cette Camille aura connu de multiples aventures, couchant avec l’un ou l’autre de ses camarades de misère, sauf Flavio qui est gay, et qui jouera auprès de cette fille un peu paumée le rôle rassurant du protecteur et de l’ami : elle exercera divers menus travaux et travaillera même dans une boîte comme escort girl, de quoi la mener au désespoir – auquel succombera le personnage de Lénine, son amoureux, mourant d’une overdose – qui lui fera tenter de se noyer dans le Pacifique. Ainsi touche-t-elle le fond, un moment. Mais une sorte de sagesse, comme sourdant de cet abandon et de ce dénuement, la remet en surface, en survie, et la voilà heureuse de ce peu que l’étrange cité lui donne : « Le bonheur n’a pas d’histoire, il n’en est pas moins lézardé d’interstices », écrit-elle à son père, en tirant un trait sur tous les malheurs qui l’auront frappée depuis son enfance ; et tirant du même coup le rideau sur ce récit : « J’aime beaucoup cette ville et même mon statut d’expatriée. Je n’ai pas l’intention de rentrer ». Ainsi efface-t-elle sa marginalité.
On lira ce récit comme on déguste un flacon de saké et son alcool de riz. Saisi par le dramatisme des personnages, leur parcours chaotique, leur quête souvent désespérée qui est à la mesure du vide essentiel, de leur vacuité existentielle, on touchera avec la protagoniste au port de la quiétude, cette fameuse sérénité japonaise et bouddhiste qu’on appelle le zen. C’est cette carte-là que nous tend ici Émilie Desvaux dont on ne saurait trop saluer le talent.

En dépit des malheurs que connaît la protagoniste, parce qu’il est bien écrit, voilà, à coup sûr un roman qui se lit avec plaisir. Croyons-en Bensoussan sur parole! On ne peut toutefois que se désoler de voir tant de jeunes et de moins jeunes qui s’imaginent qu’il leur faut à tout prix s’exiler pour trouver leur identité qui n’a jamais, bien sûr, cessé de leur pendre au nez. .