Le Corps de l’écrivain est le premier roman de la Rennaise Constance Courson, publié aux éditions La Part commune. L’autrice plonge le lecteur dans un univers d’inspiration autobiographique, fait de phrases poétiques et d’un ton mordant, avec une surimposition des époques dans le paysage…
De Mauriac à Kerouac (et en plus ça rime), du Lot-et-Garonne comme point de départ jusqu’à l’arrivée en Bretagne, et cet air de paradis après la traversée d’un monde de tourments, aussi hoqueteux que loqueteux, la voilà, cette fille, cette femme, qui a trop lu et déjà trop écrit et qui, à la façon de Hernán Cortès prenant pied au Mexique de sa Conquête, rejette ce passé douillet et la bonne soupe des grands-mères pour charger sa maison sur son dos (sac de couchage et cahier d’écriture), après avoir brûlé tous ses vaisseaux, tous ses carnets et manuscrits où elle recensait ce monde-là, celui de l’Enfant chargé de chaînes, pour répondre à l’appel des Beat, à la voix de Burroughs et d’Allen Ginsberg, et aux pas de Jack Kerouac qui, un jour lointain, débarqua à Rennes, siffla un cognac à la gare et s’en fut à Brest retrouver ses ancêtres — Jacques Josse dans Ombres classées sans suite (éditions Cadex, 2001) et Terminus Rennes (Apogée, 2012) nous en a tout dit.
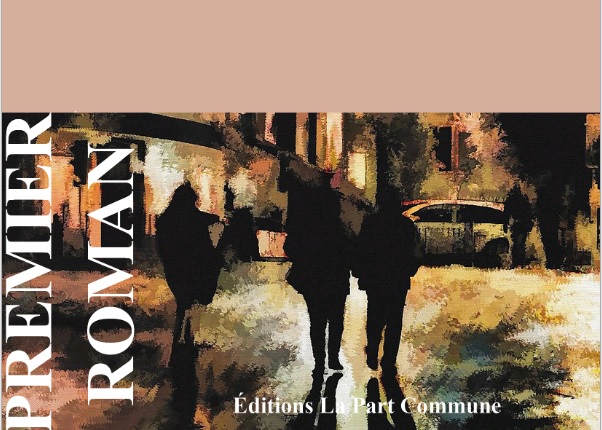
De cette descente, ou plutôt cette montée, Constance Courson a ramené un récit, son premier texte publié, qu’après avoir défait les bandelettes de la momie de Chateaubriand. Elle l’intitule Le Corps de l’écrivain, nous signifiant ainsi qu’elle, la vagabonde aux semelles de vent (Rimbaud est son phare), et son sac à mots sont un tout, soudé et unitaire, et qu’en tournant les pages de ce livre écrit d’un seul jet, brillant, lancinant, envoûtant — avec de temps à autre, contrairement à l’infini « Rouleau » de Kerouac, un point à la ligne pour reprendre son souffle —, c’est elle, l’écrivaine nouveau-née qui s’expose et s’exhibe et nous dévoile son corps. Son corps d’écriture.
Rimbaud, dit-elle, était « un terrible marcheur », elle le dit et le répète, en alignant les kilomètres qui lui font remonter la façade Atlantique. Que ne l’a-t-on dit ? La lumière vient du nord, scande-t-elle tout en marchant par vents et par mots, et la voilà débarquant en gare de Rennes, un jour d’automne, néanmoins éblouie. Première phrase : « Station de métro Sainte-Anne à Rennes (ligne A) », comme qui dirait le nombril d’un monde qui promet, en bout de couloir, « une forêt fraîche et ombreuse » au nom d’églogue : Via Silva. Et tout aussitôt — comment penser qu’il ne pleut pas sur Rennes, tout autant qu’il pleuvait sur Brest aux oreilles de Prévert (« Rappelle-toi, Barbara ») et de
Kerouac ? —, elle perçoit « le gringotement de la pluie », oui, pas le « grignotement » comme le pédant linguiste voudrait le corriger, mais ce « gringotement » voulu par Chateaubriand, dont la voix s’impose à l’ouverture, avant que, bien plus tard, à l’étape de Combourg, elle ne découvre « l’odeur des Mémoires d’outre-tombe elles-mêmes, le parfum du corps littéraire de François-René mort en odeur de sainteté ».
Mais pour l’heure, à l’instar du lointain Jack, elle fait la route et nous la voyons on the road battant le pavé rennais, couchant à la dure ou aux Jacobins ou au Thabor :
« [Nous] remontions la rue Saint-Melaine pour rentrer au campement sauvage établi au cloître du Thabor où je venais quelquefois dormir, lorsque le vent était au sud-ouest et que je ne pouvais passer la nuit au pavillon Delamare de l’Hôtel-Dieu ou contre la façade de la cathédrale Saint-Pierre, trop exposés à la pluie… »

Comme tout roman qui se respecte on retrouvera la règle des quatre éléments recensés par cet écrivain de mes amis qui, répondant à la règle de son atelier d’écriture : un roman doit comprendre noblesse, religion, sexe et mystère, rédigea cette seule phrase : « Ciel, dit la marquise, je suis enceinte et je ne sais pas de qui ». Et donc, Constance Courson nous parlera du Ciel et des croyances disparates chez ces Street People, dans le même partage du « dérèglement des sens » et un grand désabusement (« L’amour relève du théâtre social autant que les autres relations humaines, donc de la grimace, de l’imitation, du masque — de la singerie ») ; le mystère étant toujours, comme l’aventure, au coin de la rue et de ces rencontres hasardeuses qui sont, comme dans la structure des contes analysés par Propp, ou des « adjuvants » ou des « opposants », selon qui aide ou contrarie la quête ; et quant à la noblesse requise, quels noms plus héraldiques que Chateaubriand, Rimbaud et Kerouac, noblesse de plume plus que de robe ! Sans oublier Marguerite Duras campée ici en grande prêtresse (« Je m’en vais avec les algues », confie-t-elle à la Bretonne). Mais l’on retiendra, dans l’intense plaisir du texte, cette promenade en terre de Breizh qui nous mène à Lorient, la ville dévastée par la guerre, « ce ravage de laideur où il semblait qu’on sentît encore les dernières heures de l’ancien monde vibrionner sous les cumulus violets, bloquées dans le temps comme les aiguilles des horloges qui s’arrêtent dans les bombardements ».
Mais aussi ce « phare du Faouëdic » dont le bulbe arrache à la narratrice une coquine réflexion « puisqu’il ressemble à un membre d’homme dressé ». Ainsi du menhir de Champ-Dolent qui arracha un jour, à Mario Vargas Llosa, la même expression amusée. Mais Lorient, comme son nom l’indique, qui fut au temps de la Révolution Française le port de l’Orient d’où l’on pouvait gagner l’île Bourbon (La Réunion), comme nous en a laissé témoignage le poète Parny, est avant tout ouverture sur le grand large, et là, la plume de Constance Courson nous donne l’une des plus belles marines qu’il nous ait été donné de lire : « L’eau ruisselait, verte, sur le ventre blanc des dauphins, les torsions rapides des poissons restaient quelques secondes imprimées électriquement à l’intérieur des eaux avant de dériver dans le clapot en paillettes grosses comme des yeux — assez semblables à ces étoiles filantes, au-dessus de nous, qui roulaient de temps en temps sur la joue du ciel, comme des larmes sur un catafalque ».

Ce que prolonge ce petit tour des îles morbihannaises dans le bateau d’un compagnon de rencontre et sacré marin breton : « Assis sur le pont, saboulés par une houle contre laquelle il n’y avait rien à faire, de même qu’avec la grande houle d’ouest, le lendemain, dont les creux faisaient régulièrement déventer les voiles ouvertes en ciseaux de chaque côté du mât et claquer violemment la bôme que Méderic se décidait rapidement à attacher avec un anti hale-bas, me présentant un cordage souple qu’il nouait ensuite à l’extrémité de la bôme puis raccordait à un winch de façon à éviter l’empannage et que le vent prenne bien dans les voiles (…), malgré la houle, disait-il en jetant un coup d’œil au loch en annonçant : Cinq nœuds six ! » Constance Courson, à l’évidence, est une familière du Manuel des Glénans.
N’en citons, n’en disons pas plus, ce roman « breton » est, dans le flot tumultueux de la rentrée littéraire, une pépite, ou peut-être même un de ces pouce-pieds savoureux qu’on arrache sur les rochers de Belle-Île et qui feront dire à la narratrice que, tout de même, cette Bretagne a des fruits, des fruits de mer, qui n’ont rien à voir avec la soupe quotidienne des soirées guyennaises. Kerouac l’a emporté, et au bout de la route brille le soleil en pleine gloire. Ou peut-être l’éternité entrevue par Rimbaud :
« Elle est retrouvée !
— Quoi ?
L’Éternité. C’est la mer — allée avec le soleil »
Mais non, comment finir ? Reste la frontière et cette ligne où le Couesnon en sa folie a mis le Mont en Normandie. C’est donc au Mont Saint-Michel que Constance Courson consacre, à son terme, ses meilleures pages : « La Merveille se dressait sur les sables, aussi prodigieuse qu’une pyramide d’Égypte ». Et après une visite détaillée qui vaut les meilleurs guides de cette 8ème merveille du monde, elle nous laisse le spectacle de la célèbre plus haute marée du monde : « Voir le courant se perdre le long de la cale en clapotant dans les cailloux bleus avant de retourner à la mer qui entrait maintenant de front sur les sables, avec plusieurs lignes de ressac… la baie toute entière bientôt devenue une vaste soupe de glaise barattée par les malströms, projetant dans les airs des gerbes, des aigrettes et des scories de boue dans un prodigieux barouf… »
Que dire de plus, sinon en revenir à l’inspiration première, mise en route et fin du chemin : « Le texte s’en va lui aussi ‘’avec les algues’’, tiré par le jusant. Plus un mot — plus un mot de moi ». Constance Courson, qui n’a sûrement pas dit son dernier mot, nous donne là une magistrale leçon d’écriture.
Le Corps de l’écrivain de Constance Courson, éditions La Part Commune, collection Un Monde à Paris, 2023, 158 p., 17,50 €
Albert Bensoussan
Prix du Mont Saint-Michel 1975
Constance Courson
Le Corps de l’écrivain
La Part Commune, collection Un Monde à Paris
Rennes, 2023, 158 p., 17,50 €

Perle rare que cette écrivaine qui marche avec autant de plaisir qu’elle écrit! Plaisir partagé, bien évidemment!