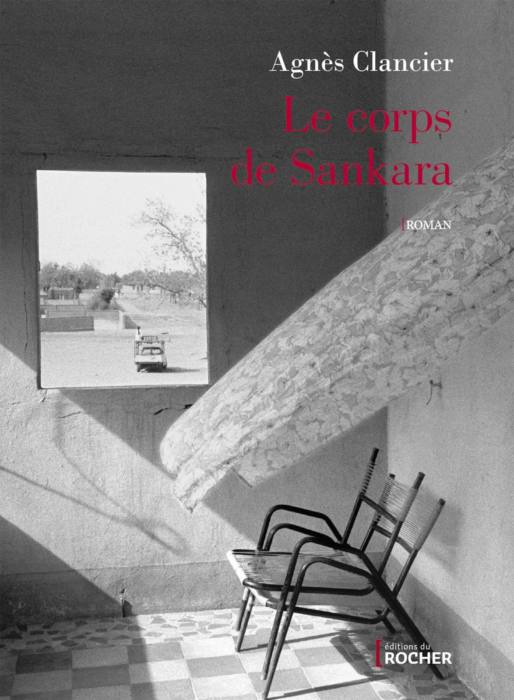En 2017, Agnès Clancier faisait revivre la figure de Maryse Bastié, pionnière de l’aviation féminine, dans un livre magnifiquement enlevé. En 2020, elle nous fait redescendre sur terre, précisément au Burkina Faso, ancienne Haute Volta, et nous plonge dans un pays chaotique dirigé un temps par Thomas Sankara, jusqu’en 1987, date de son assassinat. Un chef devenu mythique depuis cette date pour les mouvements africains de libération. Le livre d’Agnès Clancier nous restitue admirablement le climat mêlé d’actes de violence et de volonté démocratique de ce singulier et jeune pays d’Afrique de l’Ouest.
Deux Français atterriront dans ce pays, en 2014, pour des objectifs bien différents, un pays fiévreux et tumultueux dans les mois qui précèdent ce qui sera la deuxième révolution burkinabée. Agnès Clancier va leur faire vivre, jour après jour, les aléas, assauts et violences d’une révolution populaire qui finira par les submerger en quelques semaines et les mettre dans l’avion qui les rapatriera vers Paris.

Daurat – clin d’œil au monde aéronautique qui passionne aussi notre romancière ? – est un haut fonctionnaire mâtiné d’aventurier. Sexagénaire désabusé, malheureux époux traînant derrière lui le souvenir de trois divorces douloureux, il devient vite un insatiable admirateur de jeunes et nubiles beautés africaines et tombera amoureux de la jeune Yassia. L’homme vient d’être nommé à l’ambassade de France à Ouagadougou. Il y côtoiera un ambassadeur lui- même méprisé de sa hiérarchie du Quai d’Orsay et las de ce pays enclavé au beau milieu du continent africain sans jamais pouvoir se délecter, et pour cause, d’une escale du Charles-de-Gaulle pour égayer, dit-il, ses réceptions du 14 juillet dans les jardins de sa résidence !
Par esprit d’entreprise, autant que par naïveté qui va lui coûter cher dans ce pays de hasard et d’incertitude, Daurat s’engagera dans le redémarrage et l’exploitation d’une mine d’or ruinée par de peu scrupuleux orpailleurs, une mine à présent désaffectée qui a empoisonné la source d’eau potable et a fait le malheur du village voisin bien décidé à demander réparation.
Lucie, jeune étudiante parisienne, sortie d’un chagrin d’amour dévastateur, est venue dans ce pays pour oublier sa blessure sentimentale, finaliser un travail universitaire et aider en tant que volontaire du progrès – VDP pour les initiés – une ONG chargée d’alimenter en eau potable et nourricière les populations burkinabés. Ces Français qui ne se connaissent pas, de génération et d’esprit bien différents, tous deux modestes et fragiles acteurs européens plongés dans la tragi-comédie politique et sociale du Burkina Faso, ignorent – et pour cause, ils ne se sont jamais rencontrés – que l’objet de leur aide à l’Afrique s’oppose, l’un et l’autre, radicalement. L’exploitation d’une richesse aurifère potentiellement utile au développement du pays a déjà pollué la ressource aquatique et écologique du village voisin de Sakalka, province de Mangou. Deux projets comme le condensé et le paradoxe de la délicate et difficile aide occidentale au continent africain.

Nos deux protagonistes à peine arrivés à Ouagadougou plongeront dans la touffeur et le désordre d’un pays accablé de chaleur – « le feu de l’enfer » – et de poussière qui empêche même de savoir si le ciel peut être bleu, un pays d’insalubrité publique « où une blessure anodine en Europe peut ici dégénérer très vite en d’atroces lésions incurables », un pays de pollution et de fumées nées des « tas d’ordures amassées par les habitants sur les terrains vagues », un pays de corruption et de désordre, d’enveloppes et de bakchichs, de prévarication et de trahisons, de luttes sociales et de régressions politiques – « ignorance, traditions, corruption, voilà ce qui se maintient au pouvoir » -. Et Agnès Clancier, haut fonctionnaire de la République, dont on suppose, à la lire, qu’elle fut un temps en poste dans ce cœur de l’Afrique de l’Ouest tant elle nous fait vivre son sujet avec précision et justesse, nous offre des descriptions peu engageantes de Ouagadougou, « capitale aux allures de village qui paraît sans limites », une ville tentaculaire vivant dans « le tumulte, les odeurs de diesel, les fumées, la chaleur nauséeuse. » Le trafic automobile y est à tout instant un défi au bon sens, un automobiliste ou un cyclomotoriste ne répondant qu’à la seule préoccupation d’y sauver sa peau : « Un car rapide a toujours la priorité et en l’absence de car rapide, c’est le taxi qui est prioritaire. Le piéton n’est jamais prioritaire, jamais. Les deux-roues non plus, ils sont trop nombreux. Les feux sont indicatifs, ils fonctionnent un peu » assène, hilare, un chauffeur de taxi à Lucie fraîchement débarquée de l’avion, effrayée d’un tel capharnaüm et assourdissant enfer urbain.
Quant au temps, « on n’est jamais en retard ici, c’est pas comme Europe où le temps vous dévore ; chez nous les bus ne partent que s’ils sont pleins ; on ne peut pas savoir à quelle heure. Encore moins quand ils arrivent. Nous les Africains, on n’a pas de problème avec le temps. Je parle de ceux qui vivent au pays, pas des fils de ministres qui étudient à Princeton. »
De temps à autres, pourtant, une bulle de poésie éclate qui vient alléger le sombre tableau de ce paysage invivable et surprend nos deux Français : « Des chauves-souris géantes, silencieuses et blanches, s’échappaient des manguiers pour danser sur les toits. »
L’Afrique ? Un pays où tout le monde s’appelle Ouédraogo, relève, éberlué, Daurat quand il convoque des candidats au gardiennage de la maison qu’il va louer à Ouagadougou. Et c’est Alfred qu’il embauche, Ouédraogo bien sûr, « dont le livret de famille mentionnait deux épouses et sept enfants. » L’état-civil est singulier lui aussi : « On est né vers 1947, on nous somme d’avoir des papiers mais ils ne changent pas notre vie. Que la mouche vole ne fait pas d’elle un oiseau. » dit Mathias, le correspondant local de l’ONG qui sera le guide de Lucie pour partir en brousse et rejoindre Sakalka. Daurat apprit un jour de la gouvernante de la maison que son arrière-grand-père avait 140 ans. C’est impossible ! lui répond-il. Mais « cet homme vit loin de la ville, de la frénésie, du vacarme et des émanations de diesel. S’il est resté à l’ombre d’un manguier à regarder travailler les femmes ou à palabrer avec les autres hommes du village en se nourrissant d’une poignée de manioc deux fois par jour, il n’a pas dû beaucoup user son corps. Alors pourquoi pas ? » lui répond la gouvernante. Sagesse d’un autre continent et bon sens souligné de nombre de proverbes africains qu’Agnès Clancier nous sert avec intelligence et humour en autant de titres de chapitres : « Le bruit du fleuve n’empêche pas le poisson de dormir…L’ombre du zèbre n’a pas de rayures…Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d’où tu viens…Que celui qui n’a pas traversé ne se moque pas de celle qui s’est noyée.»
Thomas Sankara, qui donne son titre au roman, leader révolutionnaire et socialiste, fut chef de l’État de 1983 à 1987 et émancipateur du Burkina Faso, « pays des hommes intègres en langue moré et dioula. » Pendant ses quatre années de pouvoir, « il avait combattu la corruption, vacciné les enfants, vaincu la faim en développant l’autoproduction agricole, réformé l’éducation, modernisé le statut des femmes et s’était attaqué aux pouvoirs féodaux des chefs traditionnels tout en se mettant à dos l’ensemble du monde occidental développé. […] Il croyait que tout était possible. Il était de ceux qui fendent la nuit jusqu’à la rosée du matin, hardi et volubile, fier et sans questions. Le coassement des grenouilles n’empêche pas l’éléphant de boire, n’est-ce pas ? Une force de la nature. Inflexible. Infatigable. Il avançait toujours, ne se retournait pas. Sa faiblesse. Il faut se retourner pour qu’on ne vous tire pas dans le dos. Dans un bief, il ne peut exister qu’un hippopotame mâle. » Les proverbes, toujours…Celui qui lui tirera dans le dos s’appelle Blaise Compaoré, longtemps son bras droit – et son « judas », dira de lui la sœur de Thomas -. Le traître conservera le pouvoir pendant 27 ans. Jusqu’au jour où le peuple se soulèvera et le fera fuir. Pris au beau milieu de cette sanglante et singulière violence politique – « Quelque chose d’inédit. Ce n’est pas l’armée. C’est le peuple. Le peuple prend le pouvoir » -, Daurat et Lucie seront bien près eux-mêmes d’y perdre la vie. L’ambassade, sans tarder, les embarquera dans le premier avion en partance pour Paris. Avec un compagnon de voyage bien surprenant…
Pourquoi « Le corps de Sankara » ? D’aucuns ont prétendu que l’on n’avait jamais retrouvé son corps. Et ce corps, jamais rendu par ses bourreaux, a pu faire penser un moment que le « capitaine-peuple » comme l’appelait ses partisans était encore vivant. Enterré à la hâte dans un cimetière militaire, son cadavre fut exhumé quelques années plus tard pour connaître les causes exactes de la mort. Et le corps de cet homme traverse comme une icône de la liberté ce beau livre sobrement et superbement écrit.