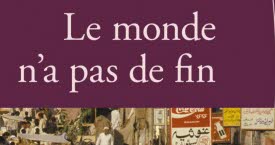Tu as déjà vu l’impact d’une balle sur un pare-brise ? À partir du trou central s’étend une toile nette et précise saturée de minuscules cristaux. C’est une parfaite métaphore de mon monde, de ma ville : disloquée, belle, née d’une violence inouïe.
Dans le monde n’a pas de fin Bilal Tanweer déploie un roman polyphonique qui est avant tout une ode à Karachi. Cette belle ville qui illumine encore la mémoire de Baba, le père du narrateur principal. Lorsqu’il entraîne son jeune fils dans les rues, il revoit les façades coloniales, l’India Coffee House où se retrouvaient les intellectuels, les bars et cabarets là où le fils ne voit plus que façades décrépites, boutiques bon marché, panneaux publicitaires. Tout est désormais violence avec les vols, la corruption, les interdits. Il faut savoir courir pour monter dans les bus qui ne s’arrêtent même pas aux arrêts, se cacher pour rencontrer un amoureux, rester calme quand les plus forts bousculent les enfants ou les faibles.
On dit que tout le monde à Karachi a été confronté au crime : certains se sont fait dévaliser ou agresser dans la rue, dans une banque, dans leurs bureaux ou chez eux, dans un bus, dans une voiture, au restaurant, au café…
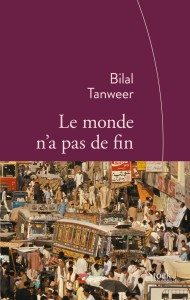
Nous connaissons particulièrement deux des victimes. Camrad Sukhansaz est un poète qui a fait huit ans de prison pour s’être opposé au général Zia, ce « chien de la CIA ». Il se rendait dans sa famille, une famille qu’il avait abandonnée pour se consacrer à la révolution.
Ce type a renoncé à son nom pour la cause, apparemment. Il a passé des années dans la clandestinité. Il fait partie des quelques rares qui n’ont pas renoncé.
En prison, il était devenu ami avec Baba.
Sadeq est la seconde victime connue du lecteur. Il était l’ami d’enfance du narrateur devenu aujourd’hui secrétaire de rédaction dans un journal. Un peu voyou dans son enfance, il entraînait son ami à s’échapper du lycée pour aller sur la plage. Il est devenu employé pour une société chargée de récupérer des voitures aux crédits impayés, avec les armes si besoin.
Pour la première fois peut-être je prends conscience que les endroits et les gens sont semblables. Ils sont constitués d’histoires, et sont porteurs de sens à nos yeux. Nous nous construisons à travers nos échanges avec eux.

Alors, l’auteur ne se contente pas de nous parler de la ville et de l’attentat, mais l’ensemble se ramifie vers des fragments de vie des victimes, mais aussi des personnes qui les ont côtoyés. On découvre ainsi Aapa et son jeune frère en vacances chez Nani. Le jeune enfant (et le lecteur) attend impatiemment les histoires qu’Aapa lui conte chaque soir. Le jeune frère s’ennuie avec ses trois poussins et sa grand-mère alors que sa sœur va retrouver en cachette un jeune voisin qui n’est autre que Sadeq. La découverte de cette liaison (pourtant chaste) amène le déshonneur sur toute la famille. Les énigmatiques frères, oiseaux de mort aux capes roses nous entraînent dans les campements, repaires de bandits en périphérie de la ville.
Nous ne sommes que des fragments et ainsi en va-t-il de nos récits. Les histoires vraies sont parcellaires. Tout ce qui est plus long est un mensonge, une fabrication.
Dans ce premier roman, Le monde n’a pas de fin, Bilal Tanweer nous fait découvrir une ville vibrante, violente, mais qui se prolonge vers des visages lumineux, des personnalités obstinées à vivre leur vie au-delà des contraintes du pays.
Je voulais que les voix sur le papier soient aussi vraies que celles que j’entendais. »

Bilal Tanweer est né à Karachi. Il a publié dans de nombreuses revues anglaises comme Granta ou The Caravan. Traducteur de l’urdu, il enseigne à l’université de Lahore, où il bit aujourd’hui.