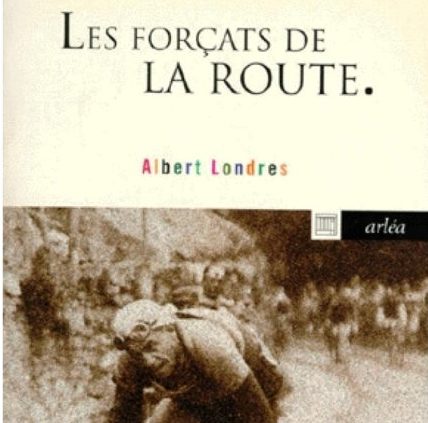Les forçats de la route : l’expression est entrée dans la légende et la littérature sportives, sous la plume d’Albert Londres, célèbre journaliste au Petit Parisien, quotidien concurrent de L’Auto, celui-là même qui fut à l’origine de l’épreuve mythique du Tour de France. Les journalistes ont alors pris le pli et n’hésitent pas à orner leurs articles d’expressions métaphoriques et dithyrambiques. Jacques Goddet, directeur de l’épreuve jusqu’au milieu des années 80 et éditorialiste à L’Équipe, journal organisateur qui a succédé à L’Auto, ne se privait pas de ces formules d’un lyrisme débordant qu’il reprenait à Albert Londres baptisant les coureurs de « géants de la route » et les cols alpestres et pyrénéens de « juges de paix » !
À lire Albert Londres, les coureurs de ce Tour de France 1924, dont il se fait le reporter, vivaient bien le bagne et la formule qu’il consacra n’était pas vaine ! Ce Tour de France alignait 15 étapes aux allures dantesques, courues chaque jour sur des distances de 400 kilomètres et plus, dont les départs étaient donnés au milieu de la nuit et les arrivées jugées au crépuscule. « Les batailles avaient lieu en pleine nuit, ou au petit matin », nous dit Albert Londres. Tout au moins pour les coureurs qu’on n’égarait pas en route ! « Une soixantaine de “lanternes rouges” se sont perdues autour de la France. On ne sait ce que ces hommes sont devenus. Ils cassaient leur roue et de préférence la nuit ! »
Partis plus de cent cinquante au Tour de 1924, ils sont arrivés soixante, vrais bagnards ahanant sur des routes pierreuses et terreuses à souhait qui transformaient vite les coureurs en méconnaissables silhouettes de poussière ou de boue. Pas forcément sans bénéfice secondaire au demeurant : « Avec la poussière, on n’a plus de figoure » répétait, avec son fort accent transalpin, l’Italien Bottecchia, maillot jaune et futur vainqueur, échappant ainsi à l’enthousiasme des tifosi ou la colère de chauvins supporters français. Car les débordements et l’indiscipline des spectateurs pouvaient faire perdre la course à chaque instant sur « des routes qui n’étaient pas à eux. On leur barrait le chemin, à leur nez, on fermait les passages à niveau. Et les vaches, les oies, les chiens, les hommes se jetaient dans leurs jambes ».

Le Tour connaît un succès immense, plébiscité par un public prêt à tous les sacrifices. À l’étape du Havre, « à la lisière d’un bois, il y avait une dame grelottant dans son manteau de petit griset un gentleman en chapeau claque. Il était trois heures trente-cinq du matin » ! Notre reporter n’en revient pas : « Si quelqu’un m’avait dit : vous allez voir sept à huit millions de Français danser la gigue sur les toits, sur les terrasses, sur les balcons, sur les chemins, sur les places, j’aurais dirigé mon informateur vers une maison d’aliénés. C’eût été une erreur. Mon homme ne se serait trompé que sur le chiffre. C’est dix millions de Français qui glapissent de contentement ».
Le Tour 1924 avait ses deux stars françaises, les frères Pélissier, Francis et Henry. « Vous n’avez pas idée de ce qu’est le Tour de France, déclare Henry à Albert Londres, c’est un calvaire. Et encore le chemin de croix n’avait que quatorze stations. Vous voulez voir comment nous marchons ? Nous marchons à la dynamite » lui lance-t-il en sortant de sa musette fioles de cocaïne, doses de chloroforme, et pilules non identifiées. Les « auxiliaires » pharmaceutiques étaient déjà de mise ! Les deux frères abandonneront la course. Pas par épuisement, mais par mauvais caractère, vexé qu’un commissaire et le directeur de course, Henri Desgranges lui-même, leur demandent de ne courir qu’avec un seul maillot : « C’est le règlement. Il ne faut pas seulement courir comme des brutes, mais geler ou étouffer » rapportent, furieux, les deux frères au journaliste qui conclut : « Les Pélissier n’ont pas que des jambes, ils ont une tête et dans cette tête du jugement ».

Albert Londres n’en oublie pas pour autant les anonymes et les perdants, pathétiques personnages, « guignards et ténébreux », damnés de la terre cycliste qui achèvent leur Tour couchés dans le fossé, épuisés et solitaires, injuriés parfois, perdus dans ce « Tour de souffrance » d’il y a un siècle.
Les Forçats de la route par Albert Londres, Éditions Arléa, mai 2008.
Collection : Arléa-Poche
Numéro dans la collection : 128
mai 2008
72 pages – 6 €