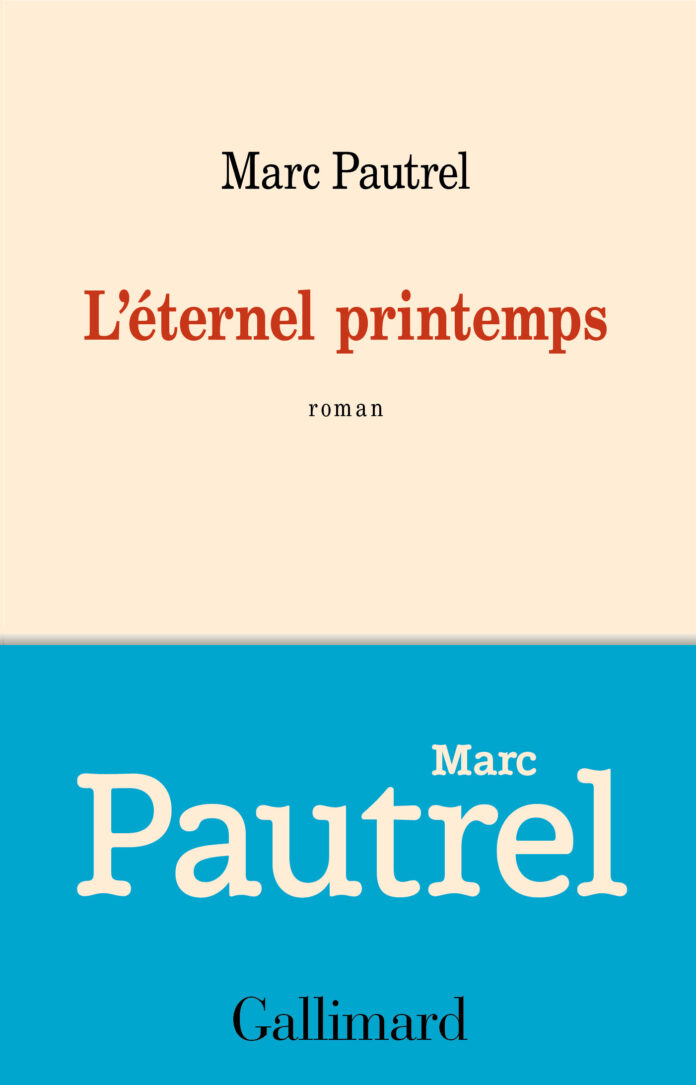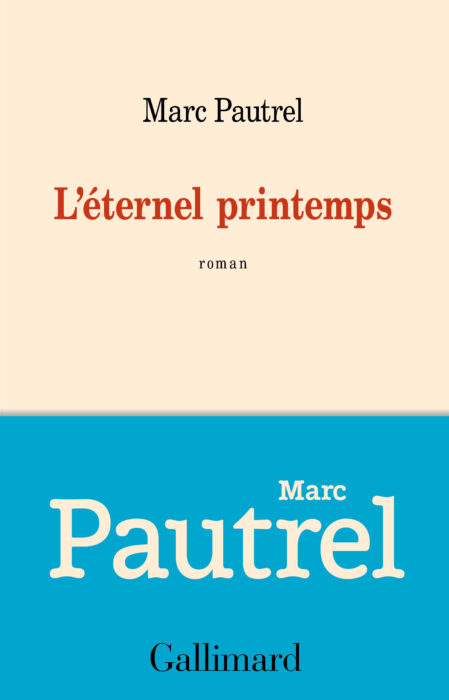L’an dernier, Marc Pautrel nous livrait un texte d’une grande délicatesse porté par des mots fluides et tendres pour traduire la passion naissante, grandissante et sans lendemain d’un jeune homme pour une femme rencontrée lors d’un colloque universitaire : c’était La vie princière, un roman largement lu et apprécié, malgré un écho relativement réduit dans la presse écrite et télévisée.
Marc Pautrel nous revient en 2019 avec un roman de la même eau, limpide et lumineuse: c’est L’éternel printemps paru au début de l’été. Le même plaisir de lecture nous y attend.
Le narrateur (et auteur ?) rencontre dans une soirée entre amis une femme, plus âgée que lui, de dix ans, vingt ans, ou plus peut-être.
On me dit parfois que j’ai l’air d’un homme de quarante ans, et elle, avec ses cheveux gris et sa grande mèche de bourgeoise, elle a parfois l’air d’une femme de soixante-dix ans, elle pourrait être ma mère.
Ils ne se connaissent pas, mais engagent très vite une conversation qui n’aura de cesse ce soir-là et ira bien au-delà de cette première rencontre. Parisiens tous les deux, l’unité du lieu facilitera bien entendu les rencontres et les échanges qui vont se répéter. Lui est romancier, elle, libraire de livres anciens, mais sa vraie ambition est d’écrire. Alors les questions de cette libraire fusent, l’occasion est trop belle de savoir « comment font les romanciers débutants », comment cet écrivain en face d’elle construit ses livres. Surtout fuir les ateliers d’écriture, lui dit-il,
l’écriture c’est comme le corps, chacun a son propre corps, il est à soi et est unique, il faut le protéger et surtout le découvrir seul. Je pense au fond de moi-même : l’écriture c’est comme la sexualité mais je ne le dis pas.
La conversation se prolongera, jour après jour, à la librairie, au restaurant, à l’ombre des parcs abrités de la chaleur étouffante de ce mois de juin parisien caniculaire. Mais jamais chez lui, encore moins chez elle, dont il ne connaîtra que le porche d’entrée de son immeuble : « Elle ne veut pas que nous nous trouvions seuls tous les deux ». Il n’empêche, les échanges se font de plus en plus fréquents – « d’une semaine à l’autre nous nous quittons très peu » -, des échanges familiers, intimes même, jusqu’à une certaine limite qu’elle contrôle toujours. Et ne franchit jamais.

« Nous parlons pendant des heures, des après-midi, quasiment des journées entières. Avec elle, c’est l’exercice complet et parfait de la conversation française, profonde, diverse, sincère, érudite, libre, didactique, tentatrice, réservée, tacticienne, débridée et pourtant extrêmement codifiée, la parole courtoise par définition, nous parlons de presque tout, ses souvenirs, mes souvenirs, ses amants, mes maîtresses, un peu de sexe survolé, un jeu complexe d’approches et d’éloignements, d’écarts, de circonvolutions et d’extrême plaisir intellectuel. Nous nous décrivons nos royaumes respectifs, et chacun de ces pays est un délice pour l’autre. Nous nous faisons la cour mutuellement. La conversation française est bel et bien une forme de pratique érotique. »
D’amour, il n’en sera jamais question entre eux, sauf pour évoquer, l’un et l’autre, des liaisons passées, imparfaites, inachevées, brèves et malheureuses. Mais dans le présent qui les anime, aucun élan ni même aucun geste, aucun mot, aucune maladresse, aucune intonation entre eux qui pourrait trahir un quelconque trouble amoureux. Au restaurant, parfois, l’étroitesse du lieu et le brouhaha des conversations les rapprochent, presque visage contre visage, pour mieux s’entendre et s’écouter. « Tout ce qui compte c’est d’être assis l’un en face de l’autre, et parler à table, s’observer mutuellement en train de vivre et se sustenter, en un sens : se nourrir l’un l’autre. […] J’observe sans me lasser ses doigts miraculeux si effilés et si longs, de petites mains avec des doigts fins comme des crayons-mines, la grande mèche de cheveux qui lui barre le front, avec ce mouvement réflexe adorable dont je ne me lasse pas. […] Je guette ses secondes de folie, les éclairs durant lesquels elle quitte la route et s’envole pour quelques minutes. »
Une fêlure apparaît pourtant, par moments, dans les mots de la libraire, une fêlure qui laisse échapper une obsession, fige ses traits, assombrit son regard : la mort, terme ultime qui la hante depuis la disparition de sa mère, il y a deux ans. Le roman qu’elle rêverait d’écrire lui donnerait ce pouvoir d’immortalité pour ainsi « vivre toujours et revivre encore chaque minute dans le corps de quiconque la lira, pour les siècles des siècles. » L’homme qui est en face d’elle l’apaise alors par « des mots gracieux, des phrases sonnantes et douces, des variations pleines d’allitérations » comme on charmerait l’oiseau vif et sauvage venu à vous et qu’un geste infime et maladroit suffirait à faire s’envoler et disparaître.

Cette femme solitaire quitte invariablement son compagnon de dîner et de promenades dans le rituel, immuable et cruel, de quelques mots brefs et convenus congédiant le malheureux homme à la porte d’un immeuble qu’il ne franchira jamais.
C’est ainsi qu’elle tient à faire durer ce lien de fidélité et de tendresse avec cet écrivain dont « elle a deviné depuis longtemps qu’il était amoureux d’elle, cela lui plaît, elle est flattée, pas du tout inquiète ou gênée. […] Plus de père, plus de mère, pas d’enfants, à peine une lointaine cousine, et qui, derrière elle, ne laissera rien ni personne, vers où veut-elle aller ? » se demande à l’infini l’ami et amoureux (é)perdu. La solitude ne lui pèse pas, sûrement l’héritage d’une enfance de fille unique, finira-t-elle par lui avouer: « C’est ainsi qu’elle vit, ainsi qu’elle tient : par fidélité à l’enfance. […] Elle me sourit en me le racontant, elle me laisse être une petite planète tournant autour d’elle inlassablement, multipliant les révolutions sans jamais me jeter dans son feu. »
L’attachement à cet homme est-il d’amour ou d’amitié ? Les deux en vérité, et le fil ne doit jamais rompre. Si l’amitié persiste et résiste, c’est que cette femme courtisée et indécise n’écarte jamais la perspective d’un épilogue où les magnétismes et les équilibres basculent et les corps finissent par se mêler. Dans un marivaudage à sa façon, cette grande solitaire tient à une forme paradoxale et subtile de fidélité amoureuse: « Elle se sait désirée et c’est tout ce qui compte pour elle. Elle veut gagner quelques secondes encore, accroître le temps restant, tendre vers l’éternité. » Et vivre la vie, sa vie, comme un « éternel printemps » éloignant sans cesse l’horizon et les menaçants orages d’un amour brûlant et destructeur.
Marc Pautrel nous livre ici, une fois encore, un texte bref, aussi tendu qu’enchanteur, aussi cruel que tendre, sans que rien ne pèse ou ne pose sur les mots délicats, simples et vibrants de ces délicieux et poétiques échanges, qu’un Eric Rohmer aurait admirablement su mettre en scène. Comme un nouveau « Conte de printemps« .
► Marc Pautrel, L’éternel printemps, Gallimard, collection L’Infini, 2019, 128 pages, ISBN 978-2-07-284703-5, 13 euros.
Lire les premières pages ici.
Marc Pautrel est né en 1967. Il vit à Paris où il se consacre entièrement à l’écriture. Il a publié huit romans aux Éditions Gallimard : L’homme pacifique (2009), Un voyage humain (2011), Polaire (2013), Orpheline (2014), Une jeunesse de Blaise Pascal (2016), La sainte réalité. Vie de Jean-Siméon Chardin (2017), La vie princière (2018) et L’éternel printemps (2019).