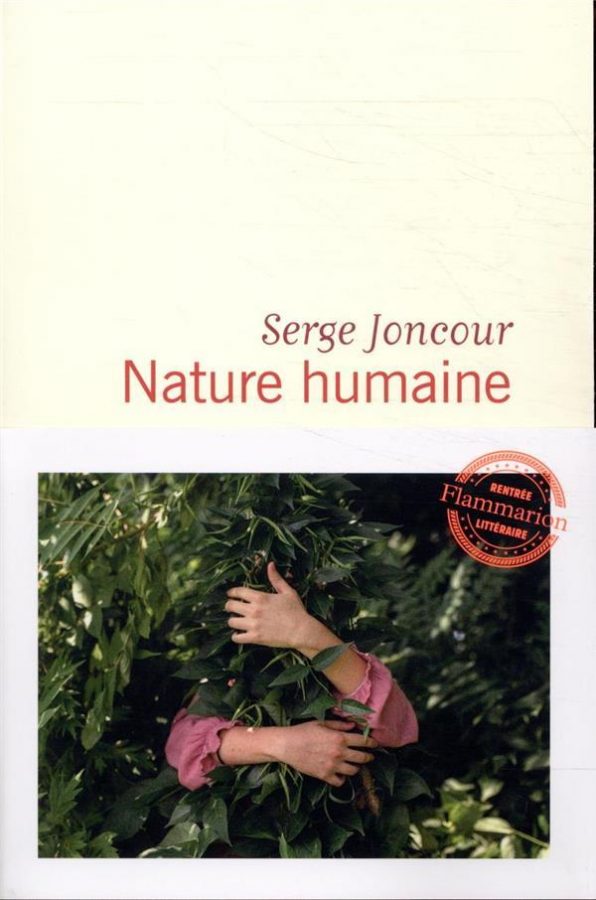De la sécheresse de 1976 à la tempête de décembre 1999, Serge Joncour dresse un tableau équilibré de l’évolution d’une société rurale, perdue entre tradition et mondialisation. Le département du Lot comme miroir d’une France qui se cherche. Passionnément humain. Et juste. Prix Femina 2020.
C’est un peu l’histoire de mondes à sauver. Ceux de la fin des années soixante-dix / quatre-vingts quand tout bascule dans ce qui paraît alors une logique implacable vers un futur meilleur. Les ronds-points se multiplient à l’entrée des villes, des autoroutes se construisent, les trains se raréfient, le nucléaire s’impose. Dans la ferme des Fabrier, aux Bertranges, dans une exploitation du Lot cultivée par plusieurs générations successives, on croit être à l’abri de ces transformations. Les grands-parents sont en bas dans la vallée dans un pavillon flambant neuf, les parents vivent à la ferme, Alexandre, seul garçon d’une fratrie de quatre enfants va reprendre le flambeau. C’est comme cela depuis des décennies et cela va le rester. À moins que. À moins que ce nouveau monde modifie cet ordonnancement éternel. Ce lent glissement peu spectaculaire, Serge Joncour va nous le montrer avec une finesse d’écriture et de regard qui lui est propre. Né dans ce monde rural qu’il décrit si bien, il sait, il connaît cet univers qui va de la toile cirée fleurie au tracteur Massey Ferguson.
Alexandre va être au cœur de cette révolution invisible qui va bouleverser le monde plus rapidement que les siècles précédents. Fils d’agriculteur, puis agriculteur, il va devoir résoudre seul les contradictions de ces mondes en marche. Pour son amoureuse est-allemande, Constanze, il va représenter un univers pastoral de paysages qui sentent bon le patchouli ou la menthe. Il sent, respire la terre, celle qui a permis à ses ancêtres de se nourrir. Pour l’État il est possesseur de terres à acheter pour permettre la construction de l’autoroute A20, celle qui va faire entrer le Lot dans le XXIe siècle. Pour ses sœurs, qui ne rêvent que de la ville, symbolisant la mondialisation, il est celui qui leur doit trois quarts de la donation-partage. Pour le « Mammouth » au nom si explicite, il est le futur exploitant d’une ferme totalement mise aux normes, aux multiples bâtiments flambants neufs. Au milieu de cela, Alexandre cherche sa voie, celle capable de concilier la beauté de ses paysages avec la nécessaire rentabilité économique. Mettre le Mammouth au milieu de ses champs de menthe. Pas menteur, honnête avec ses forces et ses faiblesses, il est le fil conducteur, la voix de l’auteur qui a voulu s’intéresser, pour une fois, plus à celui qui reste qu’à ceux qui partent de la campagne.

Serge Joncour, sur le thème et le traitement déjà moult fois utilisés de la chronique familiale ancrée dans l’histoire collective, réussit à nous intéresser à ces êtres qui tentent de rester en équilibre avec leur temps. La plupart jouent du balancier se taisant, approuvant, combattant. Jamais militants ou idéologues. Rien n’est noir, rien n’est blanc et la force du roman tient à ces nuances comme les ciels d’été au-dessus de Gourdon. Même Crayssac, le vieux voisin en lutte pour le Larzac, exprime ses doutes : « ce qui compte quand on rejoint une lutte, c’est d’abord de savoir avec qui on lutte. Bien souvent les gars se lancent dans la lutte, parce qu’ils sont creux, ils résonnent vide, rarement par pure générosité. » Ne comptez donc pas à ce que l’auteur décrive des bons contre des méchants, des citadins contre des bouseux. Le monde est plus compliqué que cela. Trop compliqué. Même si la résistance est nécessaire, la violence n’est pas la réponse adéquate.
Joncour n’a pas son pareil pour raconter l’atmosphère d’un café de campagne, un de ceux qui vont disparaître ou ces réunions familiales du 14 juillet, moment unique de l’année où la famille se réunit à l’intérieur de la ferme pour éviter le désagrément des mouches. On retrouve les paysans taiseux des photos de Depardon, les visages des personnages de Marie Hélène Lafon. Chez l’écrivain aussi, l’histoire du monde se déroule sur l’écran de télévision, entre Giscard et Mitterrand, la sécheresse de 76 et le naufrage de l’Erika. Devant le JT, le père d’Alexandre exprime son sentiment face à ce qui va devenir la mondialisation, un nom encore inusité lorsqu’il déclare que « les animaux c’est comme les hommes, faut pas que ça voyage, sinon ça ramène plein de saletés. » Alors, ce voyage, c’est le lecteur qui va le réaliser, un voyage dans le temps, un voyage entre l’évocation majestueuse des paysages et l’univers urbain. Entre le monde d’hier et celui d’aujourd’hui. Un vrai voyage en littérature.
Nature Humaine de Serge Joncour. Éditions Flammarion. 398 pages. Parution 19 août 2020. 21€.