La parenthèse de la pandémie du printemps 2020 qui a figé la vie dans une immobilité générale fut le moment d’un retour sur soi pour nombre d’écrivains. Philippe Le Guillou, homme de la mémoire, dont on sait l’attachement atavique à sa terre et sa famille de Bretagne, fut de ceux-là et le dernier en date de ses ouvrages, Le Testament breton, nous fait revivre ses souvenirs d’enfance et d’adolescence d’une Bretagne « des côtes, des baies, des pointes et des reliefs [avec] ses filigranes d’eaux tumultueuses et ses veines schisteuses […] ses lignes de crête, l’entaille de ses rivières, ses vallées boisées ouvertes au vent », une Bretagne rêvée, déjà, sur ces polychromes cartes de géographie physique signées Vidal-de-Lablache ornant les murs de son école primaire.
Sous-titré « récit », Le Testament breton, expression d’un héritage bien plus que prémices d’un trépas, nous fait ressentir à nouveau la grâce émerveillée d’une enfance passée sur ce massif primitif de rocs, de lande, d’eau, et de tourbe telle que notre écrivain nous l’avait déjà offerte dans L’Intimité de la rivière ou Les Marées du Faou.
Dans ce moment étrange et singulier d’un printemps immobile et de ces quelques semaines de réclusion propres à la réflexion, l’introspection et la mémoire, notre écrivain finistérien va plonger, une fois encore, dans « l’immense flot de souvenirs et le concert des voix de tous ceux que j’ai connus et aimés. […] Ce retour en amont me livrait avec une incroyable acuité des réminiscences enfouies, des odeurs, des anecdotes, et même des patronymes. »
Bretagne, toujours recommencée… Philippe Le Guillou en convient : « Je me suis beaucoup répété dans mes livres, tant dans le lexique que dans les invariants géographiques, les constituants du paysage, mais enfin c’est mon univers, c’est ainsi » avoue-t-il à son ami Luc Vigier à l’issue du colloque parisien qui lui fut consacré en novembre 2019.
Voilà donc une fois encore le livre de la mémoire née du Faou, base continue des souvenirs d’une enfance grandie sur le terreau de ce bourg au mitan de la Bretagne du bout du monde, porte d’entrée vers la roche cruciforme de la presqu’île de Crozon jetant son ancre à l’océan comme pour arrimer les terres paysannes aux territoires de la pêche. Le Faou, village intangible qu’est venu pourtant éventrer un ruban noir de bitume où sont lâchés à grande vitesse et grand bruit des flots motorisés lancés vers Brest et Quimper, blessant un bocage transpercé par le « cordeau de la modernité pompidolienne ».
Au fil de ses livres, Philippe Le Guillou sonde à l’infini une mémoire faouiste attachée à la rive de la mince rivière du village qui varie au gré des flots que la mer vient régulièrement gonfler jusqu’à la terrasse circulaire de la petite et bien nommée « église des marées » au plafond en forme de « carène renversée [avec] son badigeon bleu et la floraison d’étoiles qui le constelle ». Une mémoire nourrie de la douceur des clairières et des liserés de jonquilles et de primevères de la toute proche forêt du Cranou qui vous emmène vers la chapelle de Notre-Dame de Rumengol, riche de « ses retables somptueux sculptés par les ébénistes de la Royale », vouée à la Vierge que des foules pérégrines révèrent à chaque Assomption. Une mémoire familiale, enfin, soudée à la figure de deux grands-pères aussi différents l’un que l’autre, adulés pareillement par leur petit-fils, aïeux au verbe généreux ou retenu et passeurs, à leur manière, d’histoires « qui s’enracinent dans les fibres de l’être, dès la naissance. […] Je devenais l’enfant de Kerrod écoutant les récits de son grand-père, rêvant l’engloutissement d’Ys, se heurtant au silence de l’autre grand-père et au mystère de son bateau disparu. »

Le pays du romancier est la Bretagne « d’un écrivain-promeneur immergé dans la nature qui a éveillé sa vocation d’écriture » (Daniel Oster, Philippe Le Guillou : géographies intérieures, colloque de la rue d’Ulm, novembre 2019). Une Bretagne qui finit, au fil des livres, par forger le cadre d’une « autobiogéographie » (Michel Collot, Pour une géographie littéraire, J. Corti, 2014). Une Bretagne des quatre éléments, l’eau, l’air, la terre et le feu, comme autant de composants qui ravivent tour à tour chez notre écrivain peur et apaisement, angoisse et bonheur, extase et effroi, orage et rêverie, deux faces antagoniques d’une même perception inspirée par « la réalité rugueuse de la primitive Armorique […] fluide, sauvage, violente, d’une puissance à déraciner les vagues. »
Bretagne des terres et des rocs, « jadis occupée par les landes et bien plus avant plongée sous les flots, imaginaire de fossiles et de tourbe, de bruyères et de schistes qui renvoie au socle primordial, à l’échine pierreuse [d’une] terre de granite recouverte des chênes » d’une forêt « épaisse et drue, ténébreuse, pleine de mystères et de périls » qui cache, dans l’entremêlement de ses feuillus, conifères et fougères, à Corromps, Huelgoat ou Brocéliande, un chaos géologique de préhistoire et de « sylve hercynienne » (Julien Gracq).
Bretagne des vents et des « grands souffles féroces » des tempêtes de novembre « dont rien ne semble freiner le désir de destruction et de saccage, lisière de l’Autre Monde avec ses revenants qui viennent cogner aux portes et narguer les vivants, présence active de l’Ankou toujours armée de sa faux et prête à ravir des vies », Bretagne des danses macabres aux fresques des porches et des murs de ces petites églises flanquées d’ossuaires d’un « culte presque païen voué aux restes des ancêtres, sentinelles des ténèbres. »
Bretagne de feu que des foyers ont embrasé pendant l’été de 1976 ravageant la montagne d’Arrée, « terre noire et substrat élémentaire de l’Armorique humide et froide, racines des ajoncs, des genêts et des bruyères » transformée alors en macabres reliefs gris de cendre, où se dresse, sauvée des flammes par miracle, la chapelle qui couronne le Mont Saint-Michel de Braspart.

Bretagne d’eau océane, « maligne, sauvage, sournoise, […] menace irréductible qui plane ou gronde dans les abysses », en des flots qui renversent, engloutissent et anéantissent quand apaise le cours des rivières « lisses et lentes », comme l’Aulne ondulant au pied de l’abbaye de Landévennec, « romantique, avec ses grandes vasières grises où les barques reposent comme de lointains goélands, l’Aulne dont le nom seul murmure la douceur du monde, l’Aulne terrienne et maritime où l’Atlantique en ses marées vient caresser les granges et les arbres, l’Aulne que j’ai toujours aimée » écrit Xavier Grall (in : Les billets d’Olivier, 1985). Des mots qui font le bonheur de Philippe Le Guillou en symbiose avec ce poète, « grand écrivain dont les songes et les lignes entraient en véritable résonance avec mon univers le plus intime. » Grall sera désormais de son cercle des poètes disparus ou méconnus et des écrivains écartés ou maltraités en ces desséchantes et conventionnelles classes de littérature française qui ennuyaient si fort le jeune Philippe, khâgneux rennais du lycée Chateaubriand.
Écrivain méconnu, tout autant, de nos académiques cours d’histoire littéraire, Anatole Le Braz, « passeur et révélateur d’une bibliothèque invisible », dont Philippe Le Guillou découvrira, un jour de flânerie rennaise, dans l’arrière-boutique de l’irremplaçable librairie des Nourritures terrestres, le grand livre de cet intercesseur du monde des légendes et des croyances, prospecteur et scribe qui avait su « ouvrir bien des portes et délier bien des langues » de paysans qui n’osaient ou ne voulaient parler, persuadés que leur mémoire relevait alors d’une Bretagne pauvre et arriérée. De ces récits, Le Braz écrira La Légende de la mort. Une révélation pour le jeune lecteur : « À ma manière, j’étais de l’univers légendaire qu’avait exploré Le Braz. »
Un écho que Philippe Le Guillou percevra bientôt dans les mots de Julien Gracq, romancier mais aussi, et d’abord, géographe, parlant du « grand corps de tristesse de la Bretagne » dans Un Beau Ténébreux. Le Guillou, ébloui, y reconnaîtra « celui des landes de la presqu’île de Crozon si peu habitées, […], aux sutures rincées par la pluie et les vagues. » Ce livre venait de convaincre le jeune et nouveau lecteur du Maître de Saint-Florent le Vieil de la nécessité d’écrire, dans la même lumière, « sur la dimension poétique […] d’une Bretagne déchiffrée, magnifiée par les mots d’un styliste » qui se voulait arpenteur du paysage, écrivain du « grand chemin » et découvreur de « beautés géodésiques ». Le Braz et Gracq deviendront essentiels à Le Guillou.
Essentiel aussi, Yves Ellouët, peintre et poète surréaliste, uni à Aube, la fille d’André Breton, auteur d’un recueil inachevé, Falc’hun, faucon en breton, où l’on retrouve « la mer, la lande et la mort, le nom d’Ys, sans fin ressassé et cette vieille Bretagne couverte de poussière brumeuse. »
Essentiel comme Yves Tanguy, peintre surréaliste lui encore, et « guide lointain des druides du gui » (Paul Eluard), qui a peint Légendes ni figures où, au-delà du socle rocheux figuré au centre de la toile, Philippe Le Guillou y devine la mer, bleue et sans limites, et la ville d’Ys engloutie.

Essentiel comme Saint-Pol-Roux, poète méditerranéen transplanté en terre celte, que les Bretons du lieu avaient adopté sans nul ostracisme, et qu’il désignait en mots pleins de tendresse, « ces gars de faïence à la peau de falaise aux yeux couleur d’océan qui s’apaise, race aux grands yeux de mystère aussi nombreuse et pure que l’oiseau dans l’air. » L’homme « à la tignasse blanche constellée de sel et d’embruns » et « cosmographe des confins » (comme l’ont appelé Bruno Geneste et Paul Sanda dans un récent ouvrage) avait choisi de vivre dans ce manoir de Camaret, ultime vigie de la finis terrae, près des alignements mégalithiques de Lagatjar, bâtisse quelque peu baroque, à l’image de ce poète partagé entre symbolisme et surréalisme, baptisée Coecilian en souvenir de son fils fauché par la guerre en 1915. Et les tragédies seront le lot du pauvre poète. Un soldat de Silésie en juin 1940, pris de folie furieuse, s’introduira dans le manoir, tuera la gouvernante, agressera et blessera sa fille Divine et maltraitera le poète venu à son secours. Saint-Pol-Roux apprendra quelques jours plus tard qu’ont été aussi détruits tous ses livres et feuillets inédits. Autant de forfaits qui achèveront le pauvre homme. Le sort de l’écrivain et « la profanation de cet athanor poétique et l’impensable sacrifice des textes et des manuscrits » vont marquer profondément Philippe Le Guillou, à jamais lié à la figure de cet explorateur des lisières et des frontières, définitivement constitutif, lui aussi, de la « matière » bretonne de notre Faouiste de cœur et d’âme.
Quelle est-elle, cette « matière », ou « conscience », de la Bretagne du chrétien Le Guillou ? « Un ensemble de dits et de légendes, de contes et de romans, et lectures parallèles qui se convertissent aussitôt en rêveries » allié à une foi religieuse qui composera toujours avec les ancestrales formes de la mythologie et du sacré. Le Graal, « coupe sacrée à laquelle aurait bu le Christ au soir de la Cène et de sa vie », que porte le prêtre de Rumengol au moment de l’Élévation, et le Graal de Perceval et de Chrétien de Troyes sont les deux faces d’un « cheminement onirique et spirituel » et deux formes de foi fusionnées nées d’un peuple « avec son air sacré de descendre de Dieu » (Saint-Pol-Roux, Bretagne est Univers). « Le sacré se souvient des bois qui furent les premiers sanctuaires. […] Il n’y a plus de lisière, de démarcation et de frontières, et c’est ce qui fait l’essence et la beauté du sacré finistérien. […] Je prie pour que le christianisme breton qui m’inspire garde toujours cet enracinement, cette liberté – cette amplitude » conclut Philippe Le Guillou dans ce lyrique et lumineux récit d’enfance, d’amour et de foi.
Le Testament breton : récit, de Philippe Le Guillou, Gallimard, collection Blanche, avril 2022, 153 p., ISBN 978-2-07-296875-4, prix : 16 euros.
Philippe Le Guillou : géographies intérieures : actes du colloque de la rue d’Ulm, novembre 2019, Gallimard, collection Les Cahiers de la NRF, mars 2022, ISBN 978-2-07-298391-7, prix : 21 euros.
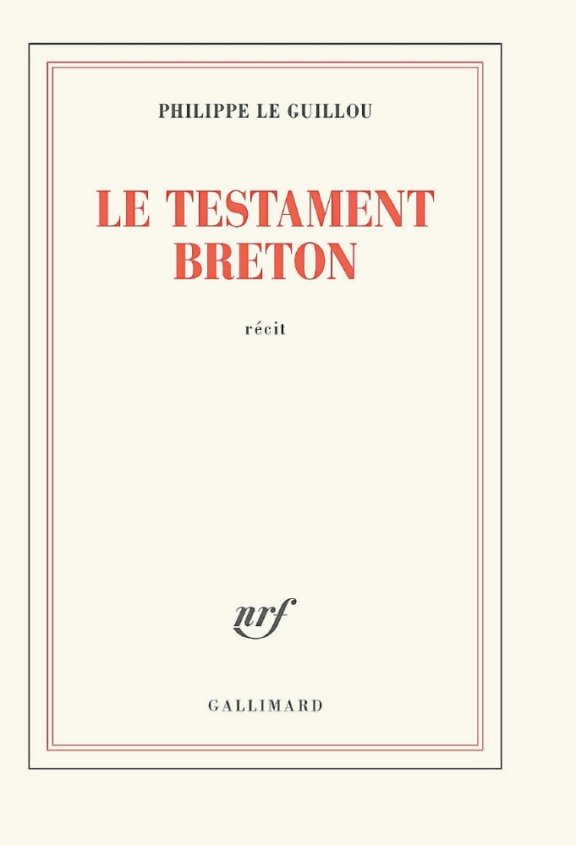
À lire aussi :
