Jacques Josse, qui connaît bien la confrérie de ces « trop épris », les repère aisément. Dans Trop épris de solitude, aux éditions Le Réalgar, ils sont au coin de la rue, au comptoir d’un bar, près d’une usine désaffectée, de retour du champ ou assis à l’arrière d’un taxi qui descend vers le port.
Marin à terre dès avant sa naissance, le Costarmoricain Jaques Josse n’a de cesse qu’il n’ait mis à l’eau sa felouque et navigué à l’ancre. Lui qui fut Postier posté, attentif au monde du travail et à l’univers des humbles, il se penche une fois de plus sur les humiliés et offensés de notre société patibulaire ou chaotique, avançant « entre des murs de suie et des troncs d’arbres calcinés », se retournant sur « le lit froid où ont dormi tant de morts » pour « souffler sur les braises de la mémoire familiale ». Son dernier livre, retraçant ce même itinéraire, a pour titre l’un des vers de ce bouleversant poème, Trop épris de solitude. Solitairement retranché dans sa mémoration vagabonde ou vigie des houles hauturières, il ne cesse de contempler ce monde qui n’en finit pas d’interpeller son âme infiniment humaine. L’œil au large, vers le tumulte de l’ingrate mer, les pieds ancrés sur ce limon où s’engravent tant d’êtres qu’il porte dans sa propre chair, sa mémoire, tel est, de livre en livre — en quarantaine —, ce « guetteur mélancolique ».
Et d’abord cette douleur familiale qui hante tant de ses pages, en ce déchirant rappel :
« Même quand il flâne au loin, en compagnie, dans des rues étroites, pavées, bosselées, il reste secrètement relié à la mansarde dont il ouvre souvent la lucarne à distance. Il oublie les vitrines, les façades de verre, les lumières qui scintillent au ras des trottoirs. Ne voit bientôt plus que l’aire, les fils à linges, les toits, les ruines, puis la route défoncée, presque lustrée sous la lune, où se sont un soir perdus les pas de sa sœur. Qui partit mourir dans les bois. »
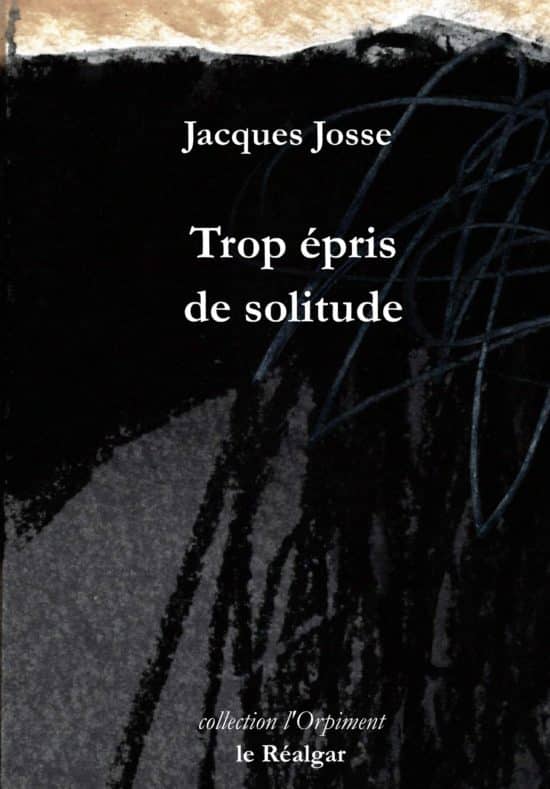
Seul un poète, un alchimiste, est capable de tant de pudeur, de retenue face au tragique. Avec si peu de mots, qui sont comme des larmes retenues sous les paupières. Et dans la campagne désolée, dans la futaie mutilée, « que faire d’autre pour que l’arbre efface de sa mémoire le geste de celui qui s’est accroché à l’une de ses branches pour y pendre ses souffrances » ? Et que dire quand « l’urne où reposaient ses cendres a disparu » ? Sentinelle des effacés, mais non-oubliés, Jacques Josse promène sa main sur « le grain de la pierre » comme pour en déchiffrer le braille des mutiques : sa tête est un vaste cimetière, ainsi qu’il en va des écrivains authentiques qui, comme le disait le grand Guillevic, ne font que « mâcher leurs morts » pour les rendre à la vie. Ce poète, l’une des plus grandes voix de la Bretagne, faisait alors allusion au traducteur qui, à l’instar de Joachim du Bellay dans sa Défense et illustration de la langue française, disait qu’en écrivant, en transcrivant, en traduisant le monde, il fallait mastiquer des vocables pour les régurgiter en de nouvelles fables. Et c’est ce que fait ce disciple du grand barde de Carnac qui, d’un poème à l’autre,
« pense aux disparus de l’hiver
partis rejoindre en silence,
transis, malmenés, à la peine,
le grand vide, l’enclos
aux mille feuilles
de marbre. »
Poésie de la mort, dans la tradition bretonne des défunts bavards qui habitent nos rêves, Jacques Josse ne se lasse pas de « semer ces idées noires / que les corbeaux déterreront à l’aube », ou d’« étreindre l’ombre du crucifié », lui qui « tire la laisse du passé, entend rire ses morts », mais par son « feu intérieur » et la chaleur de son souffle, il ressuscite tout un monde peuplant la grève, « debout près d’un chalutier / disparu en mer d’Iroise », mais aussi, mais surtout, lui, le Débarqué (éditions La Contre Allée, 2018), contemplant « la plaine, avec ses herbes pauvres, ses plis au sol » où
« l’humus
parle des mers du monde,
des ruelles grises et ventées
où traîne l’ombre de celui qu’il vient de porter en terre »
quand il n’évoque pas
« debout sur un chalutier
…une dame blanche
qui s’allonge, lascive, sur les coureaux
de Groix. »
Car cet « arpenteur de mémoire », né en bord de mer et de terre-neuvas échoués, cherche à « ralentir le cours de la mélancolie », l’œil fixé sur cet horizon qui, à jamais, se dérobe pour lui laisser entre les bras l’urne chaude de ceux qu’il a tant aimés et qui à jamais lui parlent, persuadé — et le voulant, le chantant toujours —
« qu’ici, en ces lieux tristes
mais chaleureux, personne,
jamais, ne meurt tout à fait. »
Tel est ce livre admirable dans la voix chuchotée d’un poète qui, dans ses demi-mots et la contrainte des larmes, sait aller à l’essentiel qui est cette fragilité de la vie face aux gestes absurdes des hommes, et qui entend, malgré les vents contraires et la nargue de la mort, déjouer l’oubli et laisser un sillage.
Trop épris de solitude de Jacques Josse. Éditions Le Réalgar, collection l’Orpiment. 80 pages. Parution : février 2024. 15 €
Articles connexes :

Savoir exprimer si sobrement une si grande douleur exige un talent rare. Et celui du critique rend admirablement justice à celui du poète.