Les livres de Florence Delay sont des miracles de légèreté, de poésie et de grâce. Et la plume de la romancière fait merveille quand elle nous fait entrer dans la mémoire familiale de son cher et lumineux Pays basque, havre d’un bonheur partagé chaque été avec famille et amis réunis dans le beau refuge de Miradour.
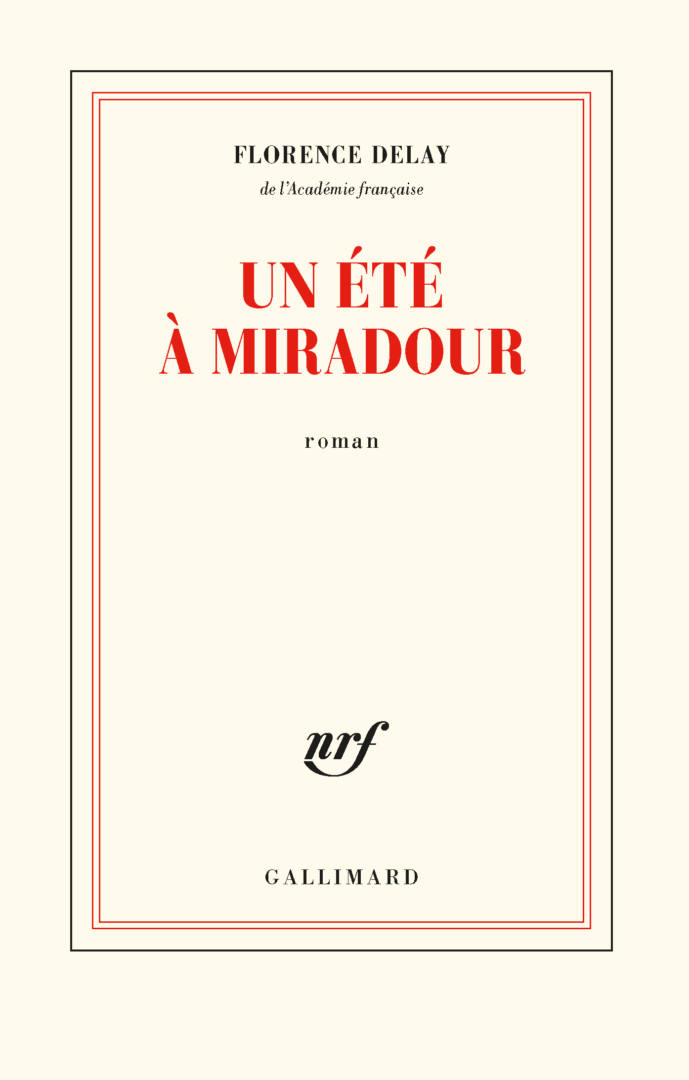
Florence Delay nous dévoile dans Un été à Miradour la belle maison de famille, perchée dans la montagne basque d’où l’on mire et admire l’Adour, propriété de Madeleine ou Madelou et de son mari Paul, chirurgien, tous deux parents de Marianne, romancière, et de Rose. Madelou, lumière et cœur battant de la demeure, y reçoit régulièrement sa « petite troupe », dit-elle, enfants, petits-enfants et amis. Et quelques écrivains occasionnellement.
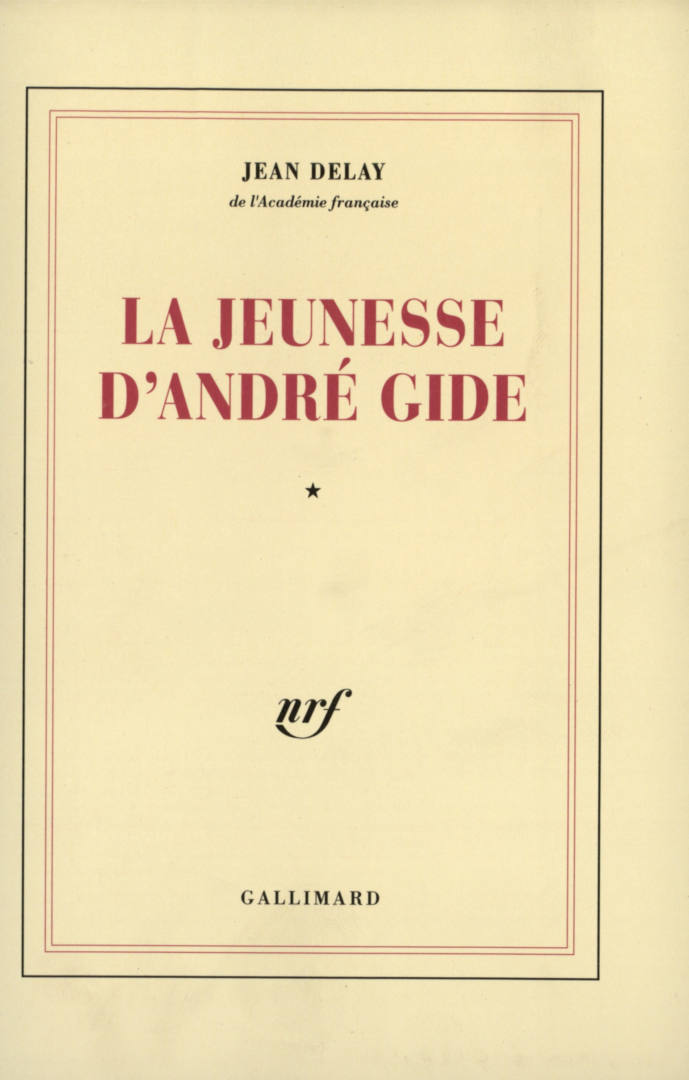
Très vite le lecteur entrevoit que les noms des protagonistes de ce court texte sont en réalité des masques et qu’Un été à Miradour est une chronique familiale à peine voilée. Madelou est Marie-Madeleine Carrez-Delay, mère de Marianne, autrement dit Florence, romancière et épouse d’un producteur de cinéma, et de Rose, ou Claude de son vrai nom. Madelou est marié à Paul, double académicien, fils de chirurgien, disciple du psychiatre Pierre Janet. Il est en réalité Jean Delay, illustre médecin psychiatre et écrivain, membre des deux Académies, française et de médecine, et auteur d’un livre devenu référence, La jeunesse de Gide.
Mauriac avait les terres de Malagar, en Bordelais, où il recevait famille et enfants, Claude et Jean, écrivains eux aussi, sa fille Luce et sa petite-fille Anne Wiazemsky, comédienne et romancière. Gide était aussi de ses visiteurs. Peut-on dire alors que Miradour est un peu le Malagar de Marie-Madeleine et de Jean ? Ces analogies portent à le croire. À la différence de Mauriac, maître et gestionnaire attentif d’un terroir viticole, Madelou avait fait de Miradour un lieu tout simple, mais essentiel au bonheur de son existence, un lieu où se reposer l’été venu, inviter les amis, échanger, se distraire et revivre. La famille de Florence Delay, c’est tout un monde de médecins, de souche basque – et bayonnaise – et de notables enracinés dans un vieux radical-socialisme, qu’Un été à Miradour campe avec tendresse et mélancolie.
« Je ne voulais pas que le livre ramène seulement à l’histoire de “ma” famille, raconte Florence Delay, mais que ce soit l’histoire d’“une” famille. Le point de départ en est une réflexion de Borges qui m’avait beaucoup émue : « Qu’est-ce qui mourra avec moi quand je mourrai ? » Écrire ces chapitres de sa vie équivaut donc pour elle à sauver un trésor : retrouver les images, les visages, les histoires et les mots échangés, réunir des vies disparues et faire émerger tout ce temps perdu et retrouvé par le miracle de la mémoire et le charme de l’écriture.

Madelou, maîtresse des lieux, règne sur Miradour, belle demeure que Jean a hérité de son père, riche et fameux chirurgien de Bayonne. Paul, en mari dévoué, accompagne son épouse chaque été, sans enthousiasme, passionné, depuis qu’il a entamé sa retraite – en mai 68 -, de recherches généalogiques « sur les ancêtres de sa lignée maternelle » qui le mobilisent des jours entiers dans son appartement parisien, en bibliothèques et aux Archives. Alors, le voyage à Miradour, pour lui, tient d’abord d’une « diplomatie conjugale » beaucoup plus que d’un plaisir estival et familial. Un plaisir en revanche que goûte intensément Madelou, pressée d’aller chaque jour se baigner dans la « Mer sauvage » qui borde la plage d’Hossegor toute proche, avec son amie Nénette et Capucine, sa petite chienne teckel.
« La deux-chevaux prend des petites routes de campagne et traverse une forêt de pins avant de se garer là où s’arrête le chemin, devant une barrière de hautes dunes empanachées de chardons et de pavots cornus qui semblent défendre l’accès à une sorte de paradis : une plage de sable fin couleur de lin, peignée par le vent qui s’étend à perte de vue. [Aujourd’hui…], la plage préférée n’est plus, on y a construit une cité balnéaire. »
Paul, dans l’effort d’une présence contrainte au milieu de tous, famille et amis, affiche une certaine raideur et distance envers le compagnon de sa fille en particulier, Octave, dont il titille la judéité et sa pratique de l’hébreu qui lui ouvrira « l’âge de la bar-mitsvah », le passage à l’âge adulte, « l’équivalent de notre communion solennelle » lui explique alors, un brin amusé, le cousin Charles, moine dominicain, venu rendre une brève visite au cercle familial. Octave est vite séduit par ce petit homme joyeux, œcuménique dans l’âme, « qui flotte dans son habit blanc et s’ébroue dans le salon comme un oiseau dans une flaque d’eau claire, aussi heureux de se retrouver en famille. » Dieu merci pour l’entourage et pour Madelou, Paul n’est pas seulement l’hôte sombre et austère de cette maison illuminée par le bonheur de son épouse. Les déjeuners lui donnent même l’occasion de raconter à Octave « des histoires de ponts, de rues de quartiers parisiens et des histoires bayonnaises. Celles-ci bien connues de sa femme et sa fille, éprouvent à les réentendre, voire à les corriger en leur for intérieur, un plaisir enfantin. »
La mer n’est pas seul point d’ancrage et source de plaisir, les eaux de l’Adour sont bien attirantes, elles aussi, et donnent à ce petit monde gravitant autour de la maîtresse de maison l’occasion de canoter. Une petite virée s’organise alors sur « la barque d’un copain pêcheur de Port-de-Lalanne, et les quatre embarquent, gais comme des pinsons, Nénette en jupe comme d’habitude, Madeleine en pantalon pour une fois, Octave en jean, Philibert en tenue d’excursion, jumelles autour du cou, bermuda ocre et spartiates. Tout est lisse, le ciel, le fleuve, pas un souffle de vent. Entre le bleu du ciel et celui de l’eau la barque glisse en silence, perlée de rires et de propos badins. »
Badin aussi, et plaisant, ce souvenir furtivement revenu à la mémoire de Madelou qui avait emmené un jour d’été en promenade sur le fleuve l’ami Gide pour le distraire de la campagne qui l’ennuyait quelque peu. « Quand Gide découvrit le batelier qui allait l’embarquer, un jeune garçon en short à la peau hâlée, aux yeux noirs, aux cheveux en broussaille, il baisa les mains de Madelou en prononçant cette phrase restée fameuse dans la famille : Chère, vous êtes merveilleuse, vous pensez à tout ! »
Madelou, amoureuse des lettres, aime à rassembler son monde autour de la littérature et des écrivains, qu’ils soient invités ou pas au domaine. Fascinée par la poésie d’Hölderlin, elle lit et relit Rêverie d’un soir et s’active quotidiennement, comme un jeu, à vaincre les difficultés et trouver les subtilités de la transmission des mots du poète d’une langue à l’autre, avec la complicité de Marianne, la romancière – qui achève son second roman -, et celle d’un correspondant et ami allemand. Tandis qu’Octave, producteur de films, travaille à un court-métrage sur Raymond Roussel. Les mots de Roussel, justement, ouvrent le livre avec cet exergue qui donne la couleur à ce récit d’un bel été basque surgi de la mémoire enchantée de Florence Delay : « Mes yeux plongent dans un coin d’azur ; ma pensée/Rêve, absente, perdue, indécise et forcée/D’aller vers le passé (…)/Grâce à l’intensité subitement accrue/Du souvenir vivace et latent d’un été. »
La mort n’a pas sa place dans ce texte délicieux né de la tendre et chère mémoire de Florence, un texte étonnamment sous-titré « roman » – mais après tout « le roman est une scénographie avec personnages » lui a dit un jour Pascal Quignard. Alors le seul drame, s’il en fallait un à ce récit, est la mort de Capucine, la petite chienne vieillissante et souffrante qui « godillait depuis longtemps du train arrière. » La mort de l’amie fidèle à quatre pattes sonne la fin du livre et la dispersion de tous les personnages au bout d’un été lumineux dans la maison familiale. Comme si Florence Delay ne voulait pas baisser le rideau sur ce petit théâtre dans la tristesse et la disparition d’un seul homme, d’une seule femme formant sa « petite troupe » qu’elle a fait revivre le temps d’une saison au soleil de Miradour, son cher refuge perché sur un coteau du Pays Basque.
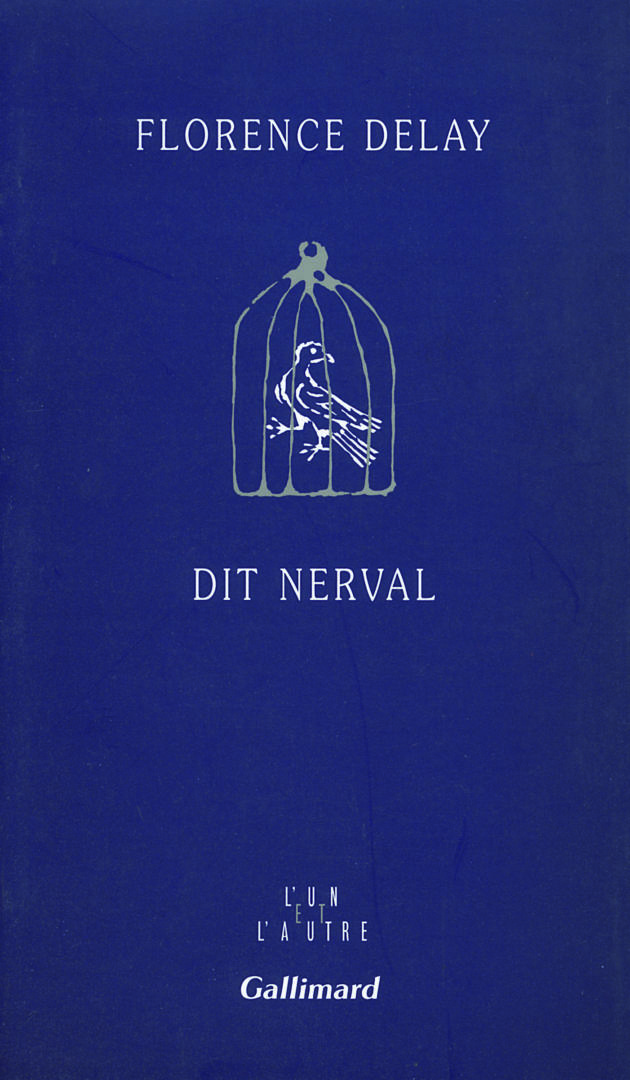
La romancière avait consacré avec Dit Nerval (Gallimard, 1999) un livre comme un portrait et un hommage à son père Jean, en proie à des relations difficiles avec son géniteur, le docteur Delay. Florence avait alors décrit Jean troublé et attendri par la figure de Nerval, en conflit avec son père lui aussi, le docteur Labrunie. Le souvenir plein d’affection et d’amour va cette fois vers la figure centrale du récit, sa mère sur laquelle Florence n’avait encore rien écrit. Et ce texte merveilleux d’intelligence, de légèreté, de douceur et de grâce, dont un cinéaste comme Éric Rohmer aurait fait un subtil Conte d’été, signe là le retour de notre romancière à une narration aussi belle qu’émouvante par l’image qu’elle nous livre de ces moments de bonheur miraculeusement retrouvés.
Un été à Miradour de Florence Delay, Gallimard. Parution : 4 février 2021, 103 p., ISBN 978-2-07-289112-0, prix : 12 €.
À découvrir de la même auteure sur Unidivers.fr :
HAUTE COUTURE AU SIÈCLE D’OR, FLORENCE DELAY ET LES SAINTES DE FRANCISCO DE ZURBARÁN
