Delphine Horvilleur, qui a remporté le prix Renaudot du Poche 2022, est un être d’exception. Femme, elle est rabbin ou rabbine, prédicatrice, ou disons conférencière, professeure, philologue, traductrice, conteuse, auteure ou autrice, et, pour tout dire, guide spirituelle. Qu’on ne s’étonne pas de cette accumulation : elle traduit des conquêtes, et de haute lutte. Née à Nancy, au sein d’un judaïsme traditionnel qui a connu la stigmatisation, la répression et la déportation, elle a très tôt cherché à s’élever sur ces blessures et ces cicatrices, disons simplement à s’accomplir en tant que créature humaine.
« À la mémoire de Jean-Léon Cohen, mon ami. » (Albert Bensoussan)

Et puisque femme il y a, interrogeons la langue et l’origine. Tsel’a en hébreu צלע et pleura en grec πλευρά signifient côté ou flanc, non pas côte ou côtelette, costa, dans la traduction latine de la Vulgate, devenue demi-portion et marginale. La femme a été créée à côté de l’homme ─ Delphine Horvilleur nous le rappelle ─, et l’humanité s’est développée en tenant ces deux êtres devenus particuliers côte à côte, soit à égalité. Telle est la question qui, de nos jours, occupe le devant de la scène. Delphine Horvilleur qui a bien lu la Genèse, sait que l’homme Adam fut créé androgyne et que de cet être initial dont Dieu dit qu’il n’était pas bon qu’il fût seul, le Créateur, après opération anesthésique (l’endormissement d’Adam), le partagea en son flanc pour créer la femme, et de l’ish il fit l’isha, qu’Adam appela Ève. Le premier ouvrage de Delphine Horvilleur s’intitule justement En tenue d’Ève et envisage les rapports entre le judaïsme et la femme. Mais bien sûr, sa réflexion n’est pas limitée à la seule religion hébraïque. Sa culture est multiple et sa parole de portée universelle.
C’est ce que prouve et illustre son dernier ouvrage, Vivre avec nos morts, Grasset, 3 mars 2021, 226 pages, 19,50€.
Rabbin depuis 2008 au MJLF (Mouvement Juif Libéral de France), Delphine Horvilleur s’est fait connaître par son parler clair, son engagement progressiste, un apostolat enflammé qui la conduit partout à parler de judaïsme, de sa conception libérale et des divers problèmes de la condition humaine, d’où sont issus de nombreux ouvrages, tous de grand intérêt comme ses deux dernières conférences Comprendre le monde (Bayard, 2020) ou Le Rabbin et le Psychanalyste (Hermann, 2020). Plusieurs vidéos sur YouTube, toutes passionnantes, relaient sa pensée.
Mais le grand sujet de toute sa réflexion sur la vie porte sur la mort, et elle nous rappelle utilement, face à l’alternative, la parole sacrée : « Tu choisiras la vie » (Deutéronome, 30 : 19). C’est à la science philologique qu’on reconnaît le rabbin averti et Delphine Horvilleur est une excellente philologue, décortiquant les termes hébraïques jusqu’à la racine pour mieux faire apparaître leur sens profond. Ainsi du terme kadosh qui, pour signifier « saint », désigne dans l’essence ce qui est à part, à l’écart de l’humain, de telle sorte que le kaddish ou prière des morts, qui est l’exaltation (en araméen) de la sainteté du Créateur, « fait entrer ceux qui survivent dans un temps à part », et elle déclare très justement que « la disparition d’un être cher… interrompt la linéarité ». Et certes, toute mort marque une rupture, une mise à l’écart, et c’est de cela, ainsi que de la douleur consécutive, que cet ouvrage entend traiter. Elle dont le « métier » ─ un mot choisi par elle ─ est d’accompagner le mort et les endeuillés.
Cet ouvrage envisage, en onze chapitres, les différentes attitudes de « l’accompagnatrice » face à la mort. Mais la mort, qu’est-ce ? et qu’en sait-on ? Déjà la question primordiale surgit dans la Thora : « Pourquoi suis-je ? » Interrogation existentielle formulée dans la Genèse (25 : 22). Mais voilà qu’on est encore plus perdu face à la mort parce qu’il n’y a pas de mots pour la nommer et dire tout ce qu’elle représente :
Personne ne sait parler de la mort, et c’est peut-être la définition la plus exacte que l’on puisse en donner. Elle échappe aux mots, car elle signe précisément la fin de la parole… Car les mots dans le deuil ont cessé de signifier. Ils ne servent souvent qu’à dire combien plus rien n’a de sens.
Peut-on dire que la mort a le dernier mot ? Il n’empêche qu’on s’interroge inlassablement, avec cette inévitable question : Et après ? Après, quoi ? Pour les croyants, et en particulier ceux qui ont placé leur foi dans le monothéisme, la réponse pourrait ou devrait se trouver dans les écritures saintes. La rabbine nous aide à la trouver :
Où vont les morts ? Le seul lieu auquel la Thora fait explicitement référence est un endroit nommé shéol où descendraient les disparus [Genèse, 37 : 35]. S’agit-il d’un territoire ou d’un monde souterrain ? Le texte n’en dit rien. Mais l’étymologie du terme est éloquente. Shéol vient d’une racine qui signifie littéralement « la question ». On pourrait donc l’énoncer ainsi : après notre mort, chacun de nous tombe dans la question, et laisse les autres sont réponse.
Cherchant une réponse, nous chutons donc sur une question. Un tel discours peut conduire au désarroi, voire au désespoir, car dans le monde de la mort, écrit la rabbine, « les mots n’ont pas leur place ». Mais, consciente de ce grand mystère de la mort, consciente aussi de son rôle de « conteuse » qu’elle revendique, elle déroule des histoires, elle sait même raconter la vie de la mère défunte à l’enfant démuni, et consoler la fille d’Elsa Cayat qui, ouvrant finalement la bouche, ne sait que dire : « Alors, ça y est, maman ne reviendra plus ? » Où l’on voit bien que la mort de sa mère, elle ne sait la comprendre et la nommer que par une question. C’est bien ce point d’interrogation qui dit la fin du monde.
Mais alors qu’en est-il de la résurrection ? Les trois branches du monothéisme revendiquent ce mot, et la prière juive ne manque pas de rendre grâces au Créateur qui « fait revivre les morts ». La source biblique est à trouver dans la prédication du prophète
Ézéchiel qui, le premier (Ézéchiel, 37), parle des tombeaux qui s’ouvrent, des corps qui se relèvent, de la peau qui repousse sur les os, et de la mise en marche des ressuscités (« Lève-toi et marche », dit Jésus à Lazare rendu à la vie). « Cette métaphore du retour à la vie des desséchés est ici une allégorie politique », estime la rabbine en replaçant la prophétie dans le contexte de l’exil des Hébreux à Babylone, après la destruction du Temple de Jérusalem six siècles avant notre ère. Il n’empêche, écrit-elle, « ce récit va devenir le support d’une autre théologie, la promesse éternelle d’une résurrection des morts ». Et nous en sommes là. Kierkegaard, jaugeant la Foi en regard de la Raison, estimait qu’en pareil cas la pensée, tout à la fois logique et magique, devait faire un saut : « le saut dans l’absurde c’est la foi », selon sa célèbre formule, reprenant d’ailleurs le non moins fameux argument ecclésiastique : Credo quia absurdum. Mais foin de la philosophie malgré ce qu’en disait Montaigne : « Que philosopher c’est apprendre à mourir », et revenons à la belle parole de Delphine Horvilleur.
Passent les jours, passent les vivants et passent les morts. Celle qui fait profession d’accompagner les endeuillés et de leur apporter quelque réconfort, évoque divers moments de son sacerdoce. Les obsèques de Simone Veil donnent lieu à une complicité souriante avec Marceline Loridan-Ivens, les deux jeunes déportées Marceline Rozenberg et Simone Jacob composant ce duo émouvant appelé par la première, goguenarde, « les filles de Birkenau », et Delphine montre bien, par quelques réparties de Marceline, combien elle sut masquer sa douleur par l’une de ses drôleries ─ comme de vouloir « allumer un pétard » pendant le discours du président Macron dans la cour des Invalides.
Il est d’autres obsèques bien éprouvantes, celle du grand frère dont le cadet demande avec insistance : « mais où est–il ? » Dans la terre ou au ciel ? Il cherche à savoir car il veut le suivre du regard. Pathétique interrogation :
Je ne comprends pas : est-ce qu’il va être dans la terre ou bien au ciel ? Moi, j’ai besoin de savoir où je dois regarder pour le chercher.
Mais oui, il est en bas et en haut, tout à la fois, et c’est le sens que donne Delphine Horvilleur au Kaddish, récité devant la tombe :
Les juifs au cimetière disent dans une seule et même prière : les morts sont sous terre et ils sont au ciel, ils sont ici et ailleurs, leur âme immortelle s’unit au divin, mais les disparus n’existent plus que dans nos souvenirs.
Reste l’affliction générale, et cette douleur si grande , si communicative que, parfois, les amis de la famille pleurent plus fort que les proches qui ont déjà étanché toutes leurs larmes. Mais qu’en est-il de l’ordonnatrice des obsèques ? La rabbine doit-elle rester impassible lors de la mise en terre ? Vient alors l’histoire de la mort de cette amie, si chère, qu’une tumeur au cerveau emporte, et qui arrache un sanglot à celle que sa fonction voudrait impassible :
Je devais tenir l’émotion à distance, car son effet sur les endeuillés serait potentiellement dévastateur. Le rabbin ou l’officiant ne peut, ni ne doit, être dans la parfaite empathie avec ceux qu’il épaule. Précisément, il se doit de ne pas faire sienne la douleur de ceux qu’il accompagne, et d’être le pilier d’une verticalité qui les a abandonnés.
Mais voilà que l’amie tant aimée est portée en terre, « dans le chaos d’un monde qui s’effondre », et à cet instant, écrit Delphine, la voix étranglée, « il m’a semblé que nous nous tenions tous au pied d’un grand escalier de pierre. Marche après marche, nous l’avons regardée monter ». (Image qui renvoie, à nos yeux, à l’ultime et bouleversante séquence du film de Fritz Lang, Les Trois lumières, où la mort, Der Tod (masculin en allemand), entoure de ses bras et sa cape les deux amants défunts et les fait gravir les degrés vers l’au-delà).
Une autre mort bien éprouvante est celle de ce fils qui est seul à accompagner sa mère, rescapée des camps et sans aucune famille. Delphine Horvilleur rappelle là son action, tous les gestes liturgiques, toutes les paroles apaisantes, car elle sait que « l’organisation de la mort raconte d’abord, et avant tout, son refus de l’accepter ».
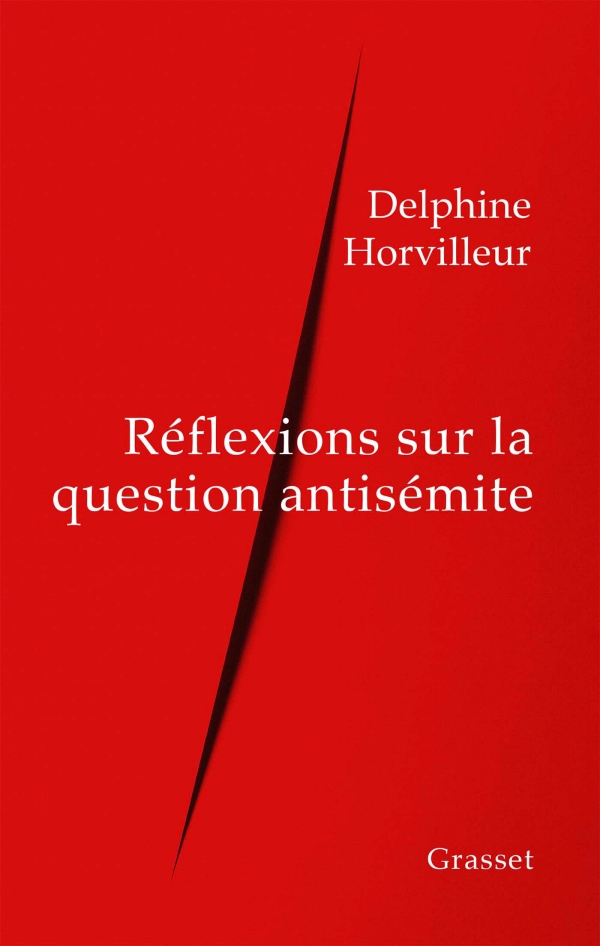
Et puis, bien sûr, il y a les obsèques d’Elsa Cayat, assassinée par deux terroristes à la table de rédaction de Charlie-Hebdo. La femme de foi et de religion ne peut s’empêcher de s’interroger et de s’insurger :
Les tueurs ont-ils perçu le paradoxe obscène de leur geste assassin ? Leur croyance en un Dieu qui demande vengeance et se vexe d’être méprisé constitue un gigantesque blasphème. Quel Dieu « grand » devient si misérablement « petit » qu’il a besoin que des hommes sauvent son honneur ? Penser que Dieu s’offusque d’être moqué, n’est-ce pas la plus grande profanation qui soit ? Grand est le Dieu de l’humour. Tout petit est celui qui en manque.
Elle s’autorise à s’ouvrir enfin à sa propre émotion en visitant le cimetière de Westhoffen ─ qui fut naguère un haut lieu du judaïsme ─- après sa profanation en 2019. Et là ressurgit tout son passé familial de petite Alsacienne dont une part importante de la famille disparut en « nuit et brouillard », se percevant comme « le fruit de ces arbres brûlés jusqu’à la cendre, ces résineux des plaines de Birkenau où personne ne m’avait jamais emmenée et dont on ne m’avait rien dit ». Et là, entre ces sépultures offensées, elle découvre, soulagée, la tombe intacte de son oncle, au milieu du délabrement « gammé ». Elle a alors cette phrase :
La haine antisémite en veut aux juifs lorsqu’ils sont vivants et leur en veut encore quand ils sont morts.
Justifiant alors l’attitude de Ruth Halimi ─ qu’elle rapporte ─ qui, après le massacre d’Ilan, son fils, par des barbares, fit déterrer son corps pour l’inhumer en Israël car « elle ne supporterait pas que la sépulture de son fils soit profanée ». Ce combat-là fait partie des préoccupations de Delphine Horvilleur qui publia aussi, en 2020 ses Réflexions sur la question antisémite.
Un dernier mot, enfin, sur cette femme d’exception qui anime un atelier et une revue de réflexion sur le « Judaïsme en Mouvement », le bien nommé Tenou’a. Son œuvre unit étroitement féminisme et judaïsme, deux concepts qui, dans le dénigrement et le racisme que l’on sait, se caractérisent par « le manque, le ‘’trou’’, la béance qui menace l’intégrité de la communauté ». Dénonçant inlassablement l’intégrisme et la croyance en l’uniformité et la finitude, qu’elle appelle le « Un », elle insiste sur le manque, la faille, l’imperfection qui sont inséparables de la condition humaine, ce qui l’amène à prêcher la tolérance et le plus grand humanisme, pour revendiquer, comme valeur supérieure, l’altérité, le « Deux », le respect de l’autre et le dialogue. Elle devient, dès lors, la meilleure avocate de la laïcité.
Nous conclurons avec elle sur la symbolique du caillou que, dans la tradition juive, l’on dépose sur la tombe et qui, s’il se dit en hébreu ebben, s’entend comme la liaison entre père (ab) et fils (ben) et impose, dans le lien étroit unissant les vivants et les morts, une pieuse filiation :
Poser un caillou sur une tombe, c’est déclarer à celui ou celle qui y repose que l’on s’inscrit dans un héritage, que l’on se place dans l’enchaînement des générations qui prolongent son histoire.
Ainsi la mort n’est plus tout à fait la mort, car elle demeure dans la vie et dans l’immanence, elle nous accompagne et ne nous lâche pas. Depuis la nuit des temps et de génération en génération vie et mort sont indissociables, ce sont les deux faces d’une même monnaie. Et le savoir, nous dit Delphine Horvilleur au terme d’une magnifique et émouvante méditation, demeure notre seul espoir : la mort est promesse d’éternité.
