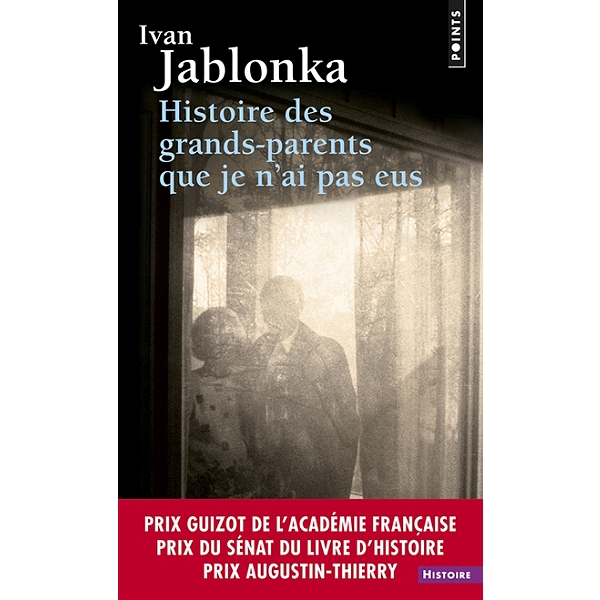« Je vais écrire un livre sur leur histoire ou plutôt un livre d’histoire sur eux, fondé sur des archives, des entretiens, des lectures, une mise en contexte, des raisonnements sociologiques grâce auxquels je vais faire leur connaissance. Récit de leur vie et compte-rendu de mon enquête, ce livre fera comprendre, non revivre. »

L’auteur, Ivan Jablonka, est historien de formation et de profession. Les grands-parents qu’il n’a pas eus, façon de dire qu’il ne les a jamais jamais rencontrés, ce sont Matès et son épouse Idesa, nés et grandis à Parczew, petit village de Pologne, habités dans les années 30 par une communauté de cinq mille femmes et hommes juifs dans ce qu’il est convenu d’appeler, dans la culture yiddish, un shtetl.
Le père d’Ivan s’y est rendu dans les années 80, en un singulier et énigmatique pèlerinage. Énigmatique, car il ne sait rien en effet de ses parents disparus dans le camp d’Auschwitz-Birkenau en 1943. Et c’est son fils, Ivan, qui ira à la source de cette histoire familiale pour combler un trou mémoriel que l’historien qu’il est devenu ne supporte plus. Tout le livre, sombre et poignant, impressionnant et bouleversant, est une quête, autant qu’une enquête, des origines d’un couple qui a traversé, vécu et souffert dans leur chair et leur âme toutes les épreuves politiques, idéologiques et raciales où s’est abîmée, et anéantie, la première moitié du XXe siècle.
« Chez les Jablonka, nous dit Ivan, il y a cinq enfants : Simje et Reizl, les aînés, futurs émigrés argentins, Matès, mon grand-père, le frère admiré et les deux derniers, Hershl et Henya, futurs émigré soviétiques. » La diaspora n’est pas un vain mot dans cette famille juive largement dispersée, en Argentine, en URSS, en Israël et en France avant, pendant et après la deuxième guerre mondiale. Matès Jablonka et Idesa Korenbaum-Feder naissent dans une Pologne « russifiée » jusqu’en 1918 et deviennent polonais quand le territoire se fait jeune République indépendante dans l’entre-deux-guerres. Généreux et plein de flamme, Matès deviendra vite amoureux d’Idesa « la plus belle fille de Parczew ». Tous les deux n’ont pas vingt ans. Matès grandit à l’ombre d’un père, Shloymè, juif pratiquant et rigoriste, « exégète des textes sacrés, contempteur des richesses matérielles » qui préfère « se déclarer illettré plutôt que d’écrire dans une autre langue que l’hébreu. » Étrange et invivable situation pour les deux jeunes amoureux : entre une Pologne nationaliste et antisémite et un radicalisme juif et patriarcal, Matès et Idesa voudront vite se démarquer et échapper à ces deux insoutenables extrémités.
« À vingt ans, cette situation leur est devenue insupportable. Bientôt le sentiment de révolte les étreint, les consume, ils veulent tout renverser : le communisme sera leur planche de salut. » Le communisme, au lendemain de la Révolution d’Octobre, est pour eux deux un idéal, comme un nouveau messianisme à l’opposé de la religion des pères. « Comme les prophètes, [les communistes] annoncent l’harmonie universelle : la rédemption ne sauvera pas seulement les enfants d’Israël mais tous les hommes. »
Juifs et communistes : dans l’entre-deux-guerres, les jeunes amoureux se doutent-ils qu’ils se préparent à un avenir bien difficile ? Non seulement ils seront en rupture avec les valeurs familiales mais aussi avec un pouvoir en place et une police pour qui « Juifs équivalait à révolutionnaires. » Et les juges polonais ne tardèrent pas à sévir : en décembre 1934 et juin 1935, Matès d’abord, Idesa ensuite, tous les deux militants du KPP, parti communiste de Pologne, sont pour un temps condamnés à la prison pour crime contre l’État.
Arrivent alors les jours sombres de la dépression économique des années 30 venant s’ajouter à la surveillance policière et politique du régime en place. La solution pour eux sera l’exil vers la France. « Tant de proscrits y ont trouvé refuge ! Gorki dit que tout révolutionnaire doit se rendre une fois dans sa vie place de la Bastille. Les Français ont émancipé les Juifs. Ils en ont même placé un à leur tête, et marxiste en plus : Léon Blum. » Mais l’exil s’annonce rude : ils sont des sans-papiers. Matès arrivera à Paris le 30 août 1937, Idesa un peu plus tard, le 18 avril 1938, par un train de nuit qui l’emmènera de la Pologne jusqu’à la frontière belge. « Le dernier lien avec le shtetl disparaît dans la nuit avec les parents, les oncles et tantes, les amies d’école, les professeurs, les voisins, les camarades du Parti. »
Matès et Idesa se heurteront à bien des obstacles : à la langue, au chômage, à la précarité. Et à l’administration française aussi, précisément la Sûreté nationale. En France, ils sont en effet des « étrangers illégaux ». Et sans autorisation de séjour, ils sont sous la menace permanente d’une expulsion. Ils sont des clandestins qui « s’accrochent avec l’énergie du désespoir aux associations », la Ligue des droits de l’homme et le Secours populaire pour Matès, fiché à la Sûreté qui enquête et statue sur son sort. Expulsable avec ou sans sursis ? Les policiers y notent sa religion : israélite. « L’administration française n’a pas attendu Vichy pour poser la question. » En avril 1938, le Front populaire est mort, le gouvernement Daladier qui lui succède intensifie la traque des clandestins et les Juifs semblent être « une menace autrement plus redoutable que le chancelier Hitler et ses émules ! […] Daladier conduit à Pétain, c’est Vichy avant Vichy […]. Et Matès, le révolutionnaire sans peur et sans reproche se rétracte en juif de diaspora. » Idesa, elle, doit s’occuper de Suzanne, leur petite fille née en France le 23 janvier 1939, deux ans après leur mariage, le 26 juin 1937.
Comme beaucoup de Juifs polonais, Matès s’engage dans la Légion étrangère, un corps d’armée jusqu’alors méprisé et réservé aux migrants et déserteurs de tout poil. La Légion a créé des unités négligées, auxquels on ne donne ni vêtements, ni matériels corrects, appelés par dérision « régiments de ficelle. » On recrute Matès au titre d’EVDG, « engagé volontaire pour la durée de la guerre. ». Pour défendre un pays qui ne veut pas de lui ? Peut-être, mais c’est surtout le seul moyen d’obtenir la naturalisation et l’assurance pour sa femme et sa fille de rester à Paris. Nécessité fait loi, et fait vivre. Matès et tous ces soldats « de seconde zone », dont le père de Georges Perec qui y laissera sa vie, participent à la défense farouche, désespérée et héroïque du front de l’Aisne en des combats féroces qu’Ivan Jablonka nous décrit avec le savoir et la terrible précision d’un historien militaire. Et « ils seraient bien étonnés, les généraux du GQG, les notaires de campagne, les ménagères du coin de la rue, les plumitifs des journaux du matin et tous les munichois, si on leur disait que les va-nu-pieds juifs et espagnols des « régiments de ficelle », ces clandestins que la police républicaine devait reconduire sans tarder à la frontière, ont fait revivre la légende des volontaires de 1792 – « cette armée de vagabonds, de tailleurs, de savetiers » écrit Michelet –au cœur de la plus grande défaite que la France ait subie de toute son histoire. »
De retour à Paris, Matès retrouve sa famille qui s’est agrandie, avec la naissance d’un petit garçon, Marcel, le père d’Ivan, en avril 1940. Matès et Idesa connaissent la tourmente des années noires de l’Occupation, les restrictions, les privations, l’angoisse des descentes de police dans leur immeuble du passage d’Eupatoria dans le quartier de Belleville cher à Georges Perec, lui aussi. « Les Ostjuden sont des proies faciles. Fragiles socialement et économiquement, parlant mal le français, concentrés dans les mêmes quartiers ». Ils sont finalement arrêtés le 25 février 1943 et internés à Drancy. Idesa subira un court interrogatoire et la fiche conservée aux Archives nationales fera monter les larmes d’Ivan bouleversé à la découverte de ces trois lettres « M.O.E. », mariée, zéro enfant. « Ces trois caractères commandent secrètement toute la vie de mon père, à la fois le miracle de sa survie et la blessure qui le fera saigner jusqu’à la mort : sa mère l’abandonne pour qu’il lui survive, son amour culmine dans le rejet, la négation. »
Déchirant sacrifice d’un père et d’une mère qui se séparent de leurs enfants parce qu’ils pressentent que leur chemin mène à la mort. Le 2 mars 1943, un convoi de mille Juifs dont ils feront partie quittera Drancy pour Auschwitz.
Chaque nuit, les deux petits dormiront chez leur voisin de palier, un Polonais exilé et « goy » qui affirmera aux policiers que ce sont ses propres enfants, avant de les conduire ensuite chez une cousine d’Idesa mariée à un Français. Cachés jusqu’à la fin de la guerre, Suzanne et Marcel seront ensuite confiés à un orphelinat et à un couple de paysans de la région de Fougères qui les aimeront et les protégeront comme leurs propres enfants en se fichant bien de savoir s’ils étaient juifs ou non.
Le dernier chapitre de cette ultime étape de la vie des grands-parents d’Ivan, consacré à la vie dans le camp, est déchirant de douleur et d’horreur. Idesa a-t-elle été gazée tout de suite ou sélectionnée pour travailler, avant de mourir d’épuisement ou de maladie ? Ivan cherchera à le savoir. En vain. Quant à Matès, jeune et encore en bonne santé, il sera affecté à un Sonderkommando, regroupement opéré par les nazis de juifs déportés, « auxiliaires du crime à leur corps défendant », qui ont charge d’emmener vers les crématoires les corps inanimés d’autres juifs extraits des chambres à gaz, agglutinés les uns aux autres et défigurés de souffrance sous la puissance du Zyklon B. Les nazis « réussissent à damner l’âme des innocents avant de les anéantir. […] Dans ce cas, c’est peut-être lui, Matès, qui jette au brasier le corps de sa femme. »
L’âme brisée de Matès part au fil de l’eau, « la Révolution en Pologne, la société sans classe, la fin de l’oppression, quelle farce ! Ses illusions ont crevé les unes après les autres. » « L’Enfer de Dante est immensément ridicule envers le vrai d’ici » dira à Ivan Jablonka Chaïm Hermann, un rescapé d’Auschwitz-Birkenau.
« Je crois que je suis devenu historien pour faire un jour cette découverte. La distinction entre nos histoires de famille et ce qu’on voudrait appeler l’Histoire, avec sa pompeuse majuscule, n’a aucun sens. C’est rigoureusement la même chose. Il n’y a pas, d’un côté, les grands de ce monde, avec leurs sceptres ou leurs interventions télévisées, et, de l’autre, le ressac de la vie quotidienne, les colères et les espoirs sans lendemain, les larmes anonymes, les inconnus dont le nom rouille au bas d’un monument aux morts ou dans quelque cimetière de campagne. Il n’y a qu’une seule liberté, une seule finitude, une seule tragédie qui fait du passé notre plus grande richesse et la vasque de poison dans laquelle notre cœur baigne. Faire de l’histoire, c’est prêter l’oreille à la palpitation du silence, c’est tenter de substituer à l’angoisse, intense au point de se suffire à elle-même, le respect triste et doux qu’inspire l’humaine condition. Voilà mon travail. »
Il est rare de lire des pages d’une telle force émotionnelle, dénuée de tout pathos ou larmoiement. Elles sont celles d’un historien porté par l’écriture magnifique du romancier qu’il est aussi. « L’écriture est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie ». Ivan Jablonka ouvre cet inoubliable livre de mémoire, individuelle et collective, avec ces mots de Georges Perec. Ils pourraient en être aussi la belle conclusion.
Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus : une enquête, par Ivan Jablonka, Éditions du Seuil, 2013, coll. Points-Histoire, 415 p., ISBN 978-2-7578-3669-9, prix : 10.80 euros.
Feuilletez le livre ici.
Discours au Sénat à lire ici.
Ivan Jablonka, né le 23 octobre 1973 à Paris, est un écrivain et historien français. Il est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-XIII-Nord et chercheur en sciences sociales. Depuis 2009, il codirige avec Pierre Rosanvallon la collection La République des Idées (éditions du Seuil), où il a édité des ouvrages de sociologues et d’économistes comme Éric Maurin, Camille Peugny, ou Thomas Piketty. Il est un des fondateurs et rédacteurs en chef de La Vie des idées, revue en ligne née en 2007. En 2013, il fonde la collection « La Vie des Idées » aux Presses universitaires de France. Dans L’histoire est une littérature contemporaine (2014), à la fois fondement théorique de l’Histoire des grands-parents et « manifeste pour les sciences sociales », il montre qu’on peut concilier sciences sociales et création littéraire. En 2005, il a publié sous le pseudonyme d’Yvan Améry un roman, Âme sœur. Bien qu’appartenant au genre de la fiction, ce livre partage des thèmes communs avec ses recherches d’historien, comme la défaillance parentale, la solitude des jeunes ou encore l’exil. Pour Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, il a reçu le prix du Sénat du Livre d’histoire 2012, le prix Guizot 2012 de l’Académie française, le prix Augustin Thierry des Rendez-vous de l’histoire de Blois 2012. En 2016, il reçoit le Prix littéraire du journal Le Monde pour son roman Laëtitia ou la fin des hommes.