Dans La Fugue, Aurélie Valognes opère un renversement discret mais profond : elle fait de son écriture psycho-narrative, déjà inscrite dans le courant feel good, un espace de soin, de réparation et de consolation. Par la simplicité assumée de son écriture, elle trace un chemin universel, à la fois intime et partageable, dans lequel les lectrices (et aussi quelques lecteurs) sont invité·es à se reconnaître, à résonner, et peut-être, à (s’)imaginer guérir.
Le style est dépouillé, les phrases souvent brèves, directes, sans effets. Quasiment une écriture no style. Elle déroutera les amateurs de virtuosité littéraire. D’autant que plusieurs coquilles et tournures maladroites émaillent çà et là le texte — ce qui interroge la rigueur du travail éditorial de supervision. Cette économie de langage peut dès lors être perçue aussi bien comme une faiblesse que comme un choix d’épure.
Bref, est-ce un objet littéraire ou non ? Tout dépend du regard que l’on porte. Pour ma part, je vois dans les romans d’Aurélie Valognes une mise en fiction de ressorts psychologiques qui constitue une sorte de feuilleton diaristique, un journal intime scénarisé à l’adresse d’un lectorat en quête de réconfort. Le roman devient un miroir doux, une main posée sur l’épaule, un écrin intime dans lequel chaque lectrice peut projeter ses doutes, ses deuils, ses désirs de recommencement.
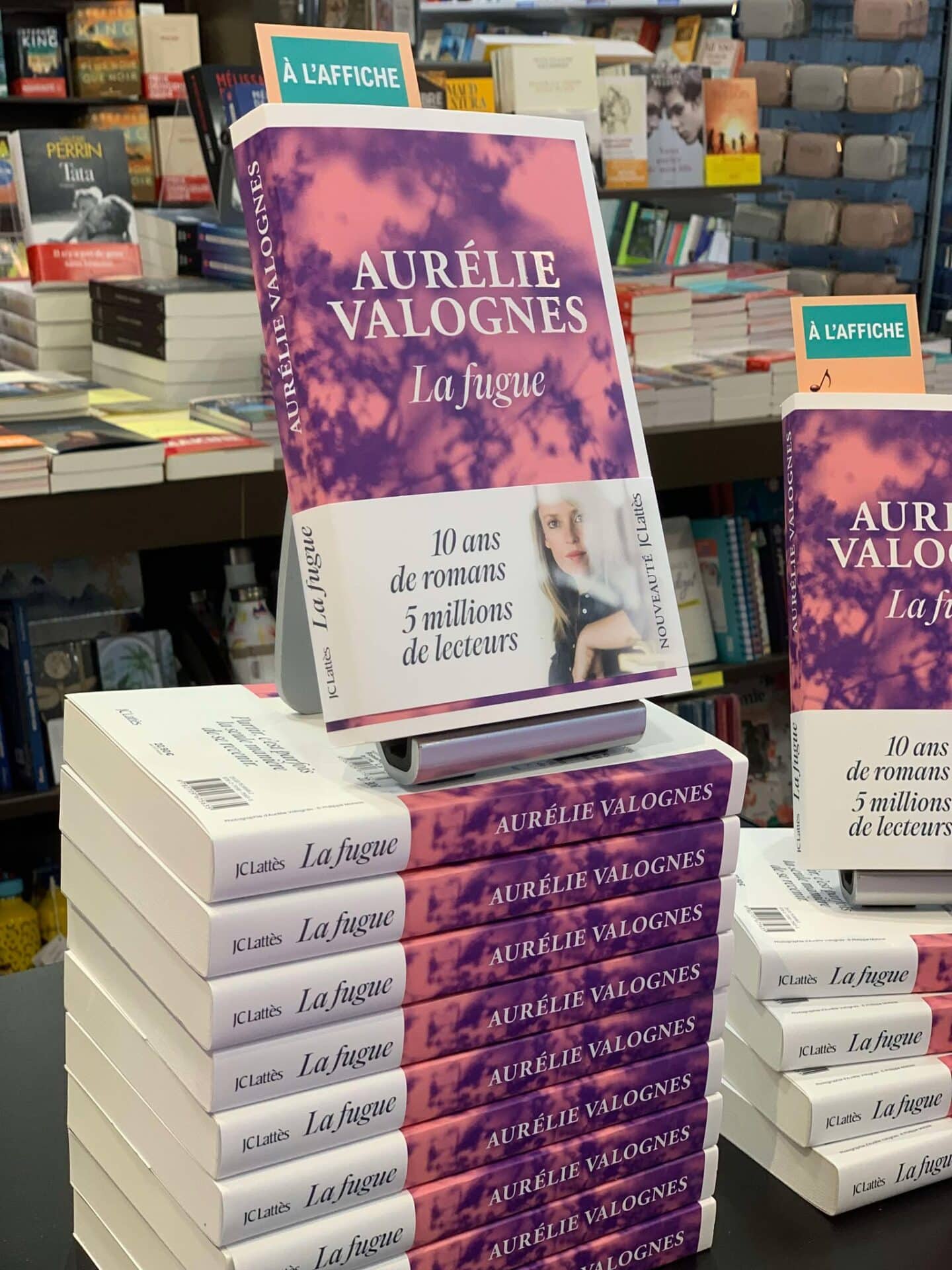
La Fugue est une épure stylistique au service d’une narration psychologique qui cherche à parler au plus grand nombre. Le geste d’Inès, l’héroïne, est de tout quitter pour tout recommencer. La forme rejoint le fond : dans la langue comme dans la vie, il s’agit de revenir à l’essentiel, à un essentiel partageable. « J’ai toujours attendu qu’on vienne me sauver, mais je l’ai compris désormais : personne ne viendra. Alors, je me sauve moi-même. »
Ce que fait Inès, c’est aussi ce que fait Aurélie Valognes : elle s’interroge, se répare, grandit, à travers le miroir narratif d’une œuvre qui entretient avec ses lecteurs un lien à la fois littéraire, émotionnel et thérapeutique. Un processus d’auto-analyse prolongée pour l’autrice, et de catharsis douce pour ses lectrices, d’émancipation par procuration.
La narration se fait ainsi sensorielle, contemplative. Les détails de la nature, les gestes quotidiens, les silences mêmes, composent un environnement apaisant, quasi thérapeutique. Ce rythme lent, quasi rituel, mime celui d’une reconstruction intérieure. Il faut du temps pour se retrouver — et Valognes le donne, à son héroïne comme à ses lecteurs.
Et cela fonctionne. Pour beaucoup, ses romans sont vécus comme une autorisation à prendre soin de soi. Valognes dit : « tu peux penser cela, tu peux le dire ainsi, tu peux être vulnérable sans que ce soit dramatique. » Elle défend une esthétique du quotidien, de la fragilité assumée, du minuscule réparateur. « Comme si elles avaient le pouvoir de me réparer, de me consoler », dit Inès à propos des fleurs, des murs, de la maison. Le roman tout entier devient ainsi un geste consolateur.
L’angoisse de la mort, subtile mais constante, traverse l’œuvre d’Aurélie Valognes et élève son écriture dans l’horizon psycho-affectif du feel good. Elle n’élude pas la finitude, mais l’aborde avec sobriété, comme une composante du quotidien, souvent liée aux liens familiaux et à la transmission.
Derrière les jeux de mots et les intrigues légères se cachent des personnages confrontés à la perte, à la solitude, aux regrets. Dans Le Tourbillon de la vie (2021), elle abordait la maladie d’Alzheimer d’un grand-père vue par un enfant. Dans Minute, papillon ! ou Au petit bonheur la chance !, la mort ou la menace de perdre un proche devient le moteur d’un changement intérieur.
Plutôt que de s’appesantir sur l’angoisse elle-même, Valognes montre comment ses personnages y répondent par l’entraide, la mémoire, la résilience. Loin du pathos, sa vision de la mort est émotionnelle, jamais métaphysique. Ce n’est pas sa propre disparition qu’elle interroge, mais l’absence des autres — et le vide qu’elle laisse.
Dans La Fugue, la mort n’est pas tragédie mais déclencheur : elle est ce fond obscur contre lequel se détache le désir de vivre. Inès n’a pas peur de mourir, mais de passer à côté de sa vie. Psychologiquement, la mort devient ici un aiguillon : elle pousse au sursaut, au réinvestissement du désir, à la réinvention de soi. Elle est convoquée comme métaphore du renouveau.
La manière dont elle traite la mort — sans pathos, mais avec sensibilité — explique en partie le succès de ses romans : ils offrent une forme de consolation. La mort n’est pas niée, mais intégrée, digérée à travers le prisme de l’humain, du quotidien, de l’humour. Cette écriture de Valognes, qui se caractérise par une forme de légèreté stylistique parfois trompeuse, parle intimement à un lectorat souvent en quête de réconfort, notamment face aux grandes angoisses contemporaines.
À sa manière — autrement dit, une manière paralittéraire — Aurélie Valognes rejoint la tradition antique de la consolation (Boèce, Malherbe, Montaigne). La consolation (ou consolatio en latin) est un genre littéraire argumentatif qui a pour objet de consoler des affligés frappés par un malheur, le plus souvent la mort d’un être cher. Aurélie Valognes la transpose au quotidien en un roman-feuilleton psychorelationnel ; la consolation se cherche dans les petites choses : la lumière, les fleurs, le thé, les souvenirs. Elle est lente, diffuse, mais bien réelle. Le lien à la nature et aux murs habités devient source d’apaisement et de sens retrouvé. Le gâteau aux noix de la mère, les fleurs du jardin, le silence retrouvé… tout participe à restaurer un équilibre, à créer un espace intérieur apaisé. Le roman devient un espace où l’on restaure un équilibre fragile, où l’on réapprend à habiter le monde.
La Fugue ne cherche pas à briller, mais à panser. Cette simplicité est celle du baume : elle ne guérit pas, elle soulage. Elle agit comme une psychothérapie douce — individuelle pour Inès, collective pour les lectrices. Valognes y propose une stratégie émotionnelle cohérente avec son projet littéraire : accompagner un processus de transformation intérieure, dans une langue dénuée d’ornement, mais pleine d’échos affectifs. Et c’est en cela que le roman touche : dans cette simplicité, dans cette proximité, dans cette foi retrouvée en une parole sans artifice, mais pleine d’échos intimes. C’est ainsi qu’il faut le prendre : une forme vive et stylistiquement anémiée d’une littérature de la consolation qui murmure efficacement à l’oreille du lecteur. Et l’on ne peut que se réjouir si ces romans aident des personnes à se sentir mieux et à avancer dans leur vie.
Il sera d’autant plus passionnant de suivre les prochains romans d’Aurélie Valognes que son écriture, véritable auto-psychothérapie narrative, semble l’entraîner vers une forme d’éveil spirituel. La question de la mort, désormais centrale dans son œuvre, devrait, comme elle nous l’a confié en entretien, déboucher sur une réflexion à portée plus spirituelle. Et là, l’intérêt se renouvelle : comment une littérature aussi dépouillée, voire simpliste, que réellement psychologique peut-elle devenir un chemin vers une conscience plus vaste — de soi, des autres, du monde ? J’attends donc, avec une curiosité tempérée mais réelle, la suite des histoires intérieures et extérieures d’Aurélie Valognes. Peut-être certains trouveront-ils dans Aurélie Valognes un phare, une boussole intérieure, un guide spirituel.
« Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre
Que des êtres charmants
S’en aillent, emportés par le tourbillon sombre
Des noirs événements.
[…]
Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le firmament ;
Et que ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement ; »
— Victor Hugo, À Villequier, Les Contemplations
