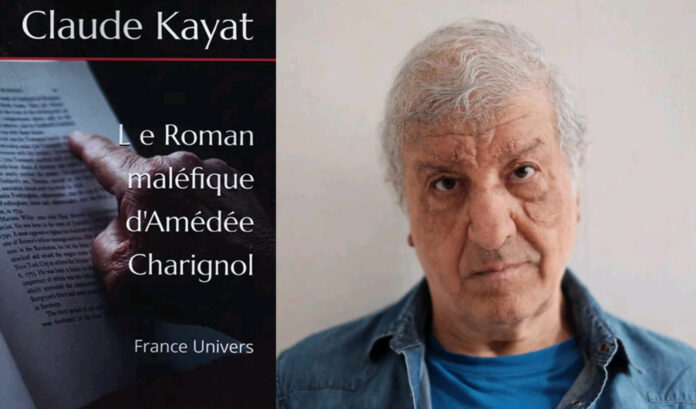Dans son dernier ouvrage, Le Roman maléfique d’Amédée Charignol, l’auteur franco-suédois Claude Kayat nous offre un roman dans le roman, autrement dit un roman mis en abyme. Il pousse l’ingéniosité jusqu’à superposer les deux intrigues, avec des protagonistes qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau, l’héroïne principale allant jusqu’à garder, dans cette fiction dans la fiction, même prénom et même nom. Le lecteur, comprenant aisément la règle du jeu grâce à la disposition aérée des paragraphes, est très vite entraîné dans une enquête mouvementée qui, comme dans tout bon polar, n’est résolue qu’à la dernière page.
Tout roman doit surprendre et tenir son lecteur en haleine, faute de quoi il se vide comme s’écoule l’eau en clepsydre. Claude Kayat, fort de son éloquente production, est maître dans l’art de nous retenir. Mais si les problèmes identitaires faisaient son ordinaire romanesque – et l’on se souviendra de La Paria (Maurice Nadeau, 2019) où l’auteur revisitait le mythe de Roméo et Juliette en Galilée dans une intrigue judéo-arabe savoureuse –, ou s’il promenait son lecteur de Paris à Stockholm sur fond de prise d’otages dans La voix du terroriste (Spinelle, 2023) (Cf. Unidivers : « Le terrorisme par l’absurde », 21 avril 2022), dans son onzième roman voilà qu’il revisite avec une belle curiosité littéraire le thème de l’adultère et du drame bourgeois traités avec une verve contemporaine, ayant pour vecteur l’inversion du fameux avertissement qu’on trouve d’ordinaire dans certains récits indiscrets : « Toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite ». Car là, au contraire, tout cadre, avec véritablement la superposition du fictif et du réel. Sauf que maître d’un récit mis en abyme, il ne risque pas, comme cela se passe assez souvent, une assignation en justice pour dévoilement de la vie privée d’un être en chair et os devenu personnage en papier.
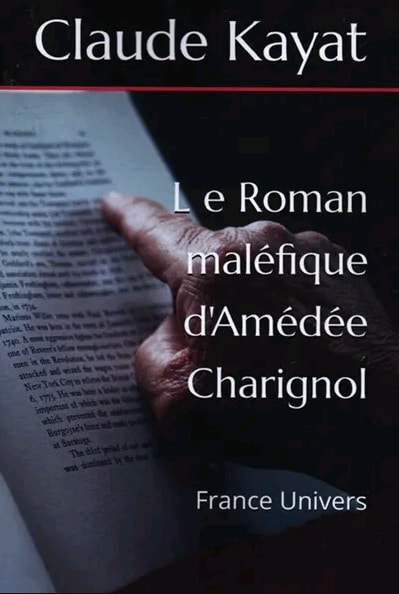
Vincent, jeune professeur de mathématiques marié à Martine, infirmière à la beauté saisissante, reçoit un jour et lit, secoué d’indignation, un roman érotique, signé d’un pseudonyme, intitulé Martine et moi, où il découvre comme protagoniste le portrait aussi bien physique que psychologique de sa propre épouse, nommée elle aussi Martine. Et voici ce début abrupt :
« Au milieu de la page 10 du roman d’Amédée Charignol, intitulé « Martine et moi », la description du sein droit de l’héroïne, identique à celui de ma femme, me plongea dans l’ébahissement. Une tache café au lait en forme d’Afrique, s’étirant juste sous l’aréole, pointait vers le sternum de cette Martine Martin. J’en conçus un sentiment de très fort malaise. »
Son malaise est d’autant plus grand qu’il n’a pas coutume de lire des romans et qu’il tient à le souligner, mais l’humour de sa proclamation de foi est évidemment à porter au crédit de l’auteur, le vrai, Claude Kayat :
« Professeur de mathématiques, je tends à me défier des mots. Leur fait défaut, comme chacun sait, la netteté cristalline des chiffres. Jamais ces derniers ne s’encombrent de cette gangue de connotations qui prêtent à l’arbitraire, aux pires dérives. »
Pour ce qui est des dérives nous serons servis tant l’intrigue s’attarde aux pires distorsions psychologiques sans occulter le scabreux et quelques accidents meurtriers au passage. Et nous assistons à un déroulement romanesque qui nous les met sous les yeux en toute posture de préférence licencieuse. Cette Martine, en somme, est une bonne épouse rangée projetée là, dans ce récit frauduleux, au miroir adultérin. Furieux en toute logique et en proie à une surprise extrême, Vincent – qui se retrouve sur le plan fictionnel dans la peau d’un boucher, ce qui ne saurait plaire à un professeur de l’enseignement secondaire – demande tout naturellement à sa femme de s’expliquer, or celle-ci jure ses grands dieux qu’elle n’a rien à voir avec le personnage de ce roman et ces scènes dignes d’un film classé X. Elle ignore tout de l’auteur tout en faisant la grimace sur les multiples avatars que ce dernier lui prête. De surcroît, le lecteur français aimant bien regarder par le trou de la serrure et se laisser ravir par des histoires de coucherie – autrement, qu’en serait-il des romans de gare ? –, le récit en question – fiction, répétons-le, dans la réalité fictionnelle – devient rapidement un succès de librairie. Les critiques, néanmoins, sont partagées, mais le fait est qu’on en parle beaucoup. Que reste-t-il à Vincent, interloqué, moqué sur son lieu de travail et risée de ses élèves, pétri de doutes et de perplexité, sinon mener une enquête en bonne et due forme, et le voilà qui espionne Martine, la harcèle de questions, conteste vertement ses réponses, la suit à la trace, si bien que la relation entre eux devient tendue à l’extrême jusqu’à finir à un doigt de la rupture – tant va la cruche à l’eau… – jusqu’à ce qu’au terme de nombreux rebondissements et d’un nomadisme du récit parcourant maints pays – dont la Tunisie natale de Kayat –, lecteur et mari, stupéfaits, découvrent enfin la vérité. Qui était, comme de juste, à portée de nez, mais encore fallait-il avoir le nez creux !
En vérité, par ce jeu de la femme dédoublée, la Martine fictionnelle échappe de plus en plus à la Martine réelle du roman, et son mari, Vincent le matheux, ne peut s’empêcher de poser le problème de son identité réelle, car enfin quelle est-elle cette femme qui est la même et tellement autre dans l’abyme du roman ? Tout lecteur habitué à lire Claude Kayat reconnaîtra là son obsession identitaire dont il s’est quelquefois ouvert : « Pour moi, l’identité, dans son sens le plus large, qui correspond à notre réalité au quotidien, n’est nullement immuable et ne se limite pas, loin de là, à la notion de religion, de nationalité ou d’appartenance politique. Il s’agit, le plus souvent, d’une identité autre, par exemple professionnelle, ou liée à un sentiment, en général fort, d’amitié ou d’inimitié, ou encore à une situation particulière où l’on joue un rôle plus ou moins actif. Rien d’étonnant, donc, si cette perception de notre identité change en permanence ».
Mais au-delà de cette intrigue et de cette équation identitaire, l’auteur se livre à une réflexion ironique sur les relations entre fiction et réalité. Et l’on se souviendra de tous ces procès intentés pour intrusion dans la vie privée de personnages fort réels dans des fils aussi fictionnels que non autorisés par la morale. Le romancier – ce démiurge dont Mario Vargas Llosa faisait l’égal de Dieu (prenant l’œuvre de Gabriel García Márquez pour modèle, il composait alors une Histoire d’un déicide) – a-t-il tous les droits ? À dire vrai, le créateur littéraire se révolte contre la réalité et tente de lui substituer la fiction qu’il fabrique lui-même, en supplantant, en quelque sorte, la puissance divine. Mais ici, Kayat superpose les deux plans, annulant fictivement réalité et fiction : si la fiction n’est que le portrait de la réalité, quelle valeur peut avoir un roman ? Simple miroir ? Photo, chromo sans nulle inventivité ? Cet Amédée Charignol ne s’est pas beaucoup foulé, faisant passer Martine de son métier d’infirmière à celui, fictif, de gynécologue, et son mari, en gauchissement excessif, de prof de maths à boucher, tous deux natifs de Marseille et affublés du même accent. Soit. Mais pour le reste, chacun garde la même blondeur des cheveux, les mêmes accidents de terrain de leur peau, leurs goûts dans tous les domaines, bref, ce prétendu romancier nous sert une copie conforme. État ultime du plagiat. Borges ne fit-il pas de même en composant son récit Pierre Ménard, auteur du Quichotte, qui n’est que la réécriture à l’identique de certaines pages du roman de Cervantès ? On trouvera chez Kayat un personnage fort extravagant appelé Méniard, est-ce un clin d’œil au grand écrivain argentin dont il partage le sens de l’humour… ou du canular ? Par chance, donc, ce récit baigne, on l’aura compris, dans une ironie permanente. Ainsi, dans l’impatience de trouver le coupable, lit-on : « Les charbons, sous nos fesses, se faisaient plus ardents », ou, face au danger, « rester terré sous son toit afin d’éviter les tuiles ». Ou bien le sourire prend aussi la forme d’un sarcasme drolatique : « Vous pouvez être poli, non ? Même si vous êtes Français ! », s’écrie tel personnage américain. Ou encore cette acrobatie stylistique : « Martine prit la parole à une dame soporifique qui, depuis longtemps, n’en avait plus besoin ». L’auteur se joue des mots et des expressions toutes faites qu’il sait savamment retourner comme des gants. Le lecteur se promène, de sourire en rire, dans un vaudeville qui met en équation, une fois de plus, l’adultère, la rage du cocu, les fils d’une enquête, les rendez-vous masqués et tant de ruses ingénieuses.
Le masque du narrateur, ce Vincent qui enseigne les mathématiques en musique, de Bach l’austère à Vivaldi le lubrique, est forcément celui d’Othello, celui qui, sur un soupçon fallacieux, trucidera sa femme. Il poursuit de sa vindicte de prétendu mari trompé tous les amants potentiels et forcément virtuels – puisque romanesques et fictifs – et rêve de tuer cet Amédée Verniac – lui-même miroir d’Amédée Charignol –, amant primordial dont les prouesses viriles remplissent tant de truculentes pages, avant d’occire l’épouse prétendument infidèle. Même si, pour ce faire, il s’adjoint les services de ce George, Américain de forte carrure et fort incommodé par la grossièreté ( !) des Français. L’épouse ne cesse de protester de son honnêteté, elle qui passe son temps, comme aide-soignante, à porter secours aux grabataires, et sans doute finira-t-elle par en avoir assez des jalousies maladives de son mari. Et si ce récit fictif qui calque tellement la réalité était le produit d’une vengeance ? Le dénouement l’infirmera ou le confirmera, voire ! Le lecteur, aux pages terminales, en déchiffrera la clé.
La trouvaille stylistique consiste à faire alterner la réalité et la fiction dans une lecture progressive du livre délétère, ou disons maléfique car les maux succèdent aux mots, en un plaisant jeu de massacre. Claude Kayat en cet ultime roman a troqué sa robe de procureur pour la plaisante pelisse du démystificateur et du baladin. Et comment ne pas succomber à de si brillants boniments ? Le dernier mot revient à Amédée ? Quel Amédée ? L’auteur supposé de ce « roman maléfique » ? Le personnage lubrique d’Amédée Verniac ? Que non pas : Amédée est le nom du lapin de compagnie de la ravissante héroïne :
« On sonna à la porte. Martine venait récupérer le lapin Amédée, endormi dans sa corbeille d’osier ».
Tout finit ainsi dans un éclat de rire.
Le Roman maléfique d’Amédée Charignol de Claude Kayat, France Univers, 236 p., 19,50 €. Parution : 2025