Le Dibbouk, Fantôme du monde disparu est le catalogue de l’exposition du même nom présentée au Musée d’art et d’histoire du judaïsme de Paris, publié aux éditions Actes Sud. Pascale Samuel et Samuel Blumenfeld décortiquent, avec intelligence et précision, les différentes représentations de cette figure de la mythologie juive dans les arts et la culture afin d’appréhender la complexité de cette âme errante.
Entre les légendes emblématiques du folklore juif d’Europe centrale, si l’on connaît Le Golem, créature de glaise conçue au XVIe siècle par un rabbin de Prague afin de protéger la communauté toujours menacée par quelque pogrom, popularisé par le roman de Gustav Meyrink (Der Golem, 1915, Le Golem, éditions Stock, 1969) ainsi que par la poésie de Borges et les films éponymes de Paul Wegener en 1917 et de Julien Duvivier en 1936, le mythe du Dibbouk, moins connu, a pris une signification et une place importante dans l’imaginaire et l’imagerie du temps présent. Un ouvrage vient de paraître qui rassemble tout ce que recèle ce thème et sert de catalogue à l’exposition qui se tient actuellement au MAHJ (Musée d’art et d’histoire du judaïsme) de Paris. La page initiale dévoile ce que l’on entend par « dibbouk » :
« Quand un homme meurt avant l’heure, son âme revient sur terre vivre ses années non vécues, terminer ses actions non accomplies, éprouver les joies et les peines qu’il n’a pas connues. »

Cette croyance remonte probablement au grand kabbaliste de Safed, Isaac Louria, qui élabora, au XVIe siècle le concept de transmigration des âmes, la Gilgul haNechamot, qui désigne, donc, l’esprit d’un mort qui pénètre le corps d’un vivant. Tout est parti, en Europe centrale, de la pièce de théâtre de Shalom An-ski (Shloyme Zanvl Rapoport), Dybuk, écrite en russe et en yiddish, représentée à Varsovie en 1920 et transposée à l’écran, en 1937, par Michal Waszyński.
Cette œuvre théâtrale a connu un succès fulgurant, devenant la pièce la plus populaire du théâtre yiddish, si prisé par Kafka, mais aussi sur la scène internationale. Elle sera créée à Paris au Studio des Champs-Élysées dans une mise en scène de Gaston Baty en 1928, et reprise souvent par la suite, en 1948 au théâtre Édouard VII (mise en scène d’André Marcovici), en 1957 au théâtre Sarah Bernhardt (traduction de Nina Gourfinkel et Arié Mambush), et plus récemment par Daniel Mesguich à l’Espace Rachi en 2004. Cette œuvre dramatique met en scène un couple d’amoureux malheureux, à l’instar de Tristan et Iseut ou Roméo et Juliette. Le jeune homme pauvre et la jeune fille de riche famille, unis par un amour véritable, ne pourront se marier car le père de la fille veut l’unir à l’homme de son choix ; l’aimé meurt et son esprit entre dans le corps de son amoureuse : à l’heure du mariage, la voix du dibbouk sort de la bouche de la fiancée clamant la vérité d’un amour immarcescible, et cette dernière s’effondre, rejoignant dans la mort l’homme qu’elle aime. Cette possession du corps par un esprit autre, du vivant par un mort, a eu un succès considérable dans les lettres et les arts (Chagall, certes), et l’on ne peut tout rapporter de ce que cet ouvrage richement illustré nous livre. L’histoire la plus étonnante est celle qui nourrit l’œuvre de l’autrice polonaise Hanna Krall, Preuves d’existence (Autrement, 2000) ; en 1977 elle publiait déjà Prendre le bon Dieu de vitesse (Gallimard, 2005), un récit à partir de ses conversations avec Marek Edelman, le dernier dirigeant survivant du soulèvement du ghetto de Varsovie ; ici, elle s’inspire du récit d’un professeur en Pennsylvanie, fils d’un survivant de la Shoah et possédé par le dibbouk de son demi-frère (dont il porte le même prénom) disparu dans le ghetto de Varsovie : ce professeur, Michael Steinlauf, qui ne sait rien du passé de son père, souffre de constantes douleurs et d’un malaise permanent :
« C’était l’équivalent d’une grossesse, à ceci près que je ne pouvais pas mettre ce gamin au monde. Ce dernier avait pris le pouvoir sur une partie de mon corps… : un dibbouk s’était emparé de ma personne. »

Ce professeur « habité » par un fantôme s’est alors rendu en Pologne, en 1990, où il devait prononcer une conférence sur le thème du dibbouk, à la suite de laquelle, écrit-il, « il s’est passé un phénomène unique, étonnant. Après cette conférence, mon dibbouk avait disparu ».
On trouvera là d’innombrables récits aussi stupéfiants que merveilleux, ou aussi inquiétants. Quelle meilleure illustration du concept de dibbouk que l’œuvre de Romain Gary ! Celui-ci n’a jamais pu chasser de son esprit l’horreur de la Shoah et de la persécution, mais puisqu’il ne peut s’en délivrer, alors il vit avec et en fait un motif tragicomique comme on en trouve peu dans l’histoire littéraire. Son coup de génie a été de créer le personnage de Gengis Cohn − de son vrai nom, Moïché Cohn, mais l’écrivain, on le sait, se voulait aussi des racines tartares, se figurant même avoir eu pour géniteur véritable le grand acteur russe du cinéma muet Ivan Mosjoukine : fantasme récurrent qu’on pourrait qualifier de dibbouk. Romain Gary, qui invente le roman picaresque hassidique avec La danse de Gengis Cohn (Gallimard, 1967), revisite la légende du dibbouk et campe là un ancien nazi « habité » par sa victime juive, un acteur comique qu’il a fait fusiller. Une des blagues les plus grinçantes de ce bouffon juif :
« Un jour, à Auschwitz, j’ai raconté une histoire tellement drôle à un autre détenu qu’il est mort de rire. C’était sans doute le seul Juif mort de rire à Auschwitz. »
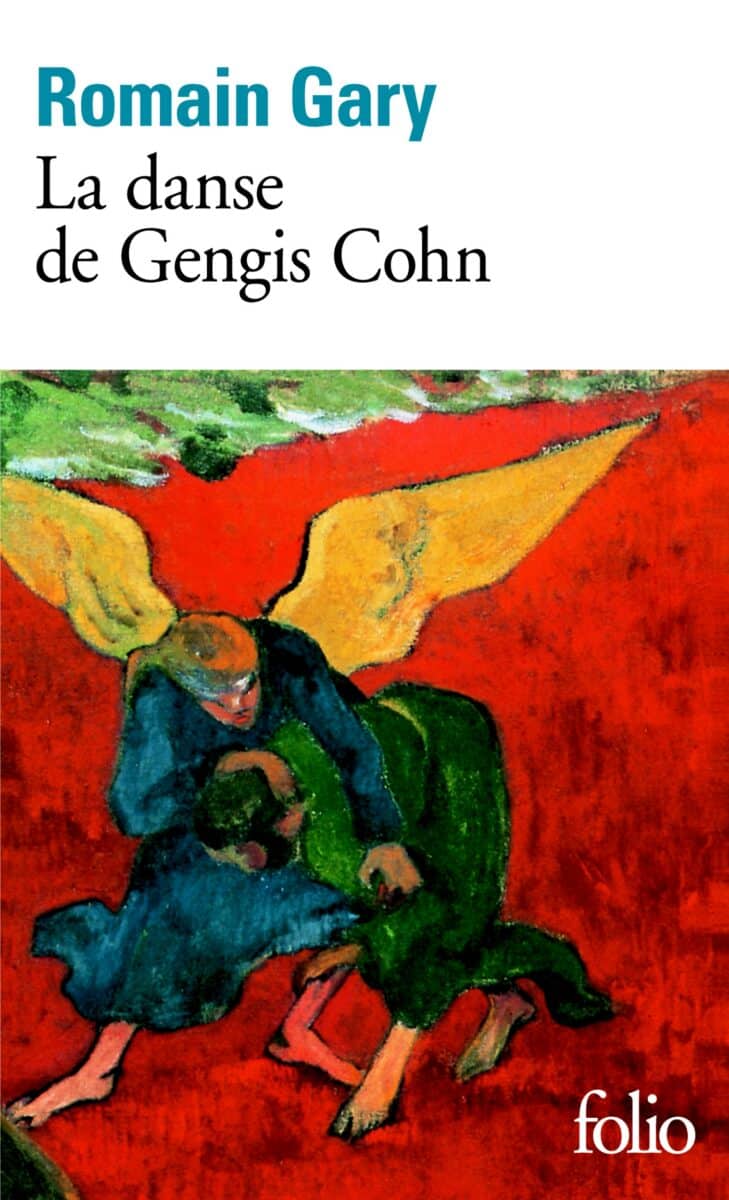
Il y a donc ce couple improbable. Ils sont inséparables, et le nazi se voit contraint de satisfaire ce fantôme omniprésent et intérieur, lui préparant même son tcholent de Chabbat, ou un gefilte fish pour Hanoukka, car l’autre n’est pas « muet comme une carpe à la juive » − un bon mot comme en multiplie Gary. C’est pire, le dibbouk le fait parler en yiddish, et c’est d’une drôlerie extrême, d’où le caractère tragique et terrifiant de la Shoah ne ressort que plus fort. Le nazi ne peut se boucher les oreilles des cris entendus : « Je ne veux pas paraître antisémite, mais rien ne hurle comme une mère juive lorsqu’on tue ses enfants ». C’est pourquoi il force son bourreau à chanter la célèbre
Yiddishe Momme, ce fleuron de la musique klezmer (et que chanta aussi Charles Aznavour) ! Et il ne sait comment se libérer de cette hallucination, de ce Juif qu’il a « sur le dos » : « un Juif particulièrement mal intentionné, du genre qui ne pardonne pas… du genre… exterminé. » Mais pourrait-il un jour s’en débarrasser ? Que non pas – le mot dibouk דיבוק signifie en hébreu « attachement » –, c’est déjà fait, car il l’a déjà tué, exécuté, assassiné. C’est sans solution, culpabilité infinie. Au comble du désespoir, il a même pensé se rendre en Israël − la psychanalyse est une science juive, non ? − pour s’en purger, mais « on ne peut tout de même pas demander aux psychanalystes israéliens de supprimer un Juif pour soulager un Allemand ! » Ce ton grinçant, cet humour féroce, fait rire dans une atroce grimace. Surtout quand le dibbouk contraint ce tortionnaire nazi qui a tant de victimes à son actif, à réciter le kaddish, la prière juive des morts, rédigée en araméen. D’ailleurs, Gary se proposait initialement d’intituler son roman Kaddish pour un comique juif.
Disons, pour finir, que lorsque Romain Gary se rendit à Auschwitz en 1966 avec son épouse Jean Seberg, il déclara, de retour du cauchemar : « Les Juifs étaient la couleur de Varsovie. On les voyait partout. Maintenant, c’est leur absence qui frappe ».

C’est cette même absence et la culpabilité collective des Polonais que traduit le plus grand cinéaste de Pologne, Andrzej Wajda – celui qui nous a donné un Danton au visage de Depardieu – adaptant au théâtre Le Dibbouk où le dibbouk devient l’incarnation d’un monde disparu, un fantôme dans un pays amputé d’une part essentielle de sa population, ainsi que le notait Gary. Le cinéma s’est volontiers emparé d’un thème aussi fascinant, que ce soit Sydney Lumet, à Hollywood, avec The Dybbuk, ou Ethan et Joel Coen dans leur célèbre A Serious Man. Et les auteurs de ce livre n’hésitent pas à conclure, à propos du premier, qui nous donna ces chefs d’œuvre que furent Douze hommes en colère, Serpico ou Un après-midi de chien : « un réalisateur dont une partie de l’œuvre, la plus secrète et la plus brillante, se regarde comme autant de variations du Dibbouk ».
C’est donc, à travers ce bel ouvrage et l’exposition qu’il illustre, une autre façon de rappeler l’indicible, alors qu’aujourd’hui rien n’est joué et le négationnisme court toujours. Alors qu’en psychanalyse freudienne ce que l’on appelle la « négation » aboutit chez Freud à un concept majeur, le « refoulé ». Quel maître de sagesse, quel miraculeux thérapeute pourrait ou saurait guérir les hommes de la malédiction caïnique, leur « manie » insensée de vouloir détruire l’autre ? Ce grand et beau livre marque, assurément, d’une pierre blanche la voie de la sagesse.

Passionnant,en effet, le phénomèrne du dibbouk. A rapprocher sans doute de l’obsession dévorante ayant pour objet un être follement aimé ou haî. L’identification totale avec un personnage exagérément admiré pourrait également constituer un intéressant cas de figure. Présentation admirablement érudite d’Albert Bensoussan, comme à l’accoutumée!