Dans L’Invention des miroirs, publié aux éditions des femmes Antoinette Fouque, Mérédith Le Dez nous plonge de manière fascinante dans la mémoire perdue d’une femme en quête de son identité.
Deux ans après son roman satirico-politique Musique française (La Part commune, 2023), la romancière et poète briochine Mérédith Le Dez ouvre pour nous la boîte de Pandore de sa riche imagination et nous propose une visite guidée de son kaléidoscope multicolore : la mémoire brisée d’une protagoniste doublement identitaire, Janus à deux noms pour un seul visage qui, par la magie des miroirs est toujours le même tout en étant autre, au fil d’une écriture « à quoi se raccrocher comme à une branche quand on se trouve seul face à soi-même à parler dans un miroir pour vérifier qu’on est bien là ». Dès lors la balance équilibre sur ses deux plateaux ici la vie – l’échec –, là l’écriture – la réussite.
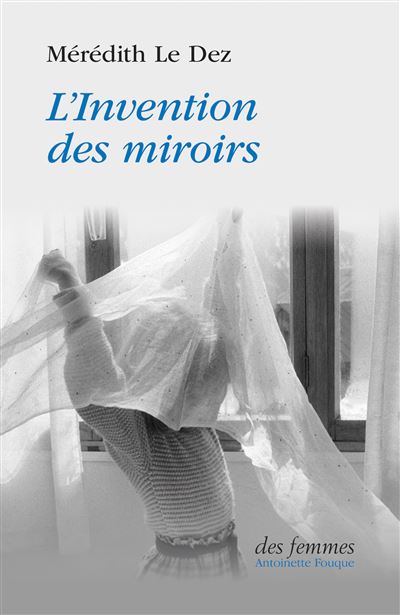
Au départ est l’amnésie : une femme qui n’est pas et ne sait plus ce qu’elle est. « Que voulez-vous que je vous dise ? Je m’appelle Isaure Clément », telle est la première phrase du récit. Elle dit qu’elle a 22 ans et se croit en l’année 1995. Or, ceux qui l’interrogent sur son lit d’hôpital lui font valoir qu’elle a, en fait, 49 ans, que nous sommes en 2022, et que ses papiers d’identité disent qu’elle s’appelle, pour l’état-civil, Laurence Métis. Où est la vérité ? En fait, cette femme a fait une chute dans les escaliers de la gare au cours d’une bousculade provoquée par une alerte terroriste ; un homme l’a poussée dans sa fuite et, piétinée et meurtrie, elle a eu un traumatisme crânien dont elle se réveille maintenant, au milieu des infirmières et du docteur. Peu à peu, sous l’interrogatoire, des images affleurent à sa conscience et nous livrent le récit d’une jeune femme dont le fil de vie commence à l’instant où elle attend les résultats du concours – probablement un capes de Lettres modernes – et va se dévider à l’envers jusqu’à nous faire rencontrer l’enfant qu’elle fut.
Et trois personnes tirant les fils, une mère morte (en fait, suicidée), un père qui « mène sa vie », comme on dit, et une professeure d’un irrésistible ascendant, Madame K. Cette dernière, figure majeure du récit, est ainsi appelée parce que, comme disait Aragon relayé par Léo Ferré dans « L’Affiche rouge », « à prononcer vos noms sont difficiles » : cette Polonaise s’appelle, en fait, Grażyna Kyzrpsak (avec 4 consonnes agglutinées imprononçables à nos oreilles), et son père se prénomme Adam, ce qui a son importance si l’on sait que Grażyna – d’une racine qui signifie « la belle » – est le titre d’un poème emblématique d’Adam Mickiewicz, l’un des plus grands poètes romantiques de Pologne et qu’une statue a été élevée à Cracovie à la gloire de cette héroïne qui, de fait, est l’image emblématique de la Pologne… à laquelle se rattache, précisément, Mérédith Le Dez par son ascendance, elle qui a publié l’émouvant récit Polska (Folle Avoine, 2010).
On ne sera donc pas surpris de découvrir ici quelques mots écrits en polonais au détour des pages – Żegnaj ojcze, proszę, Módl się za mnie / Adieu papa, prie pour moi s’il te plaît – et aussi une allusion à la langue yiddish. Cette Madame K est, en effet, juive – rescapée des camps de concentration, et pour cela tatouée de cinq chiffres sur son bras gauche – et, malgré tout son ascendant sur ses élèves et son charisme qui prélude à l’amitié profonde la liant à Isaure, elle sera victime de l’antisémitisme ambiant : alors même qu’a lieu la profanation du cimetière juif de Carpentras, on découvre au tableau noir de cette professeure de Lettres l’injure suprême : « Mort aux Juifs », ce qui entraîne, ipso facto, son retrait de l’enseignement et son départ pour Grasse, la cité des fleurs, où Isaure la rejoindra et aura sa chambre :
« Madame K avait pleuré dans son cou. Puis elle s’était reprise. Ses cheveux sentaient subtilement la verveine, cette délicate eau de parfum dont Isaure, pour mieux la respirer, avait ouvert le flacon dans la salle de bains où avant de se coucher elle s’était rafraîchie. Il y avait eu dans la nuque inclinée de Madame K à ce moment-là, sous le coup du chagrin et de l’épuisement, l’expression d’un abandon qu’elle ne lui avait jamais vu auparavant. »
Ce récit est plein d’une sensualité et d’une délicatesse de sentiments qui ne peuvent que toucher le lecteur. D’autant plus que le monde alentour est, dès le départ, d’une violence extrême. Au-delà de l’allusion au danger terroriste qui prélude au récit, nous retrouvons la brutalité des hommes qui fait écrire à la narratrice désabusée et retirée du monde : « Tous les humains se valent ». Le traumatisme majeur de cette Isaure est cette agression dont elle est victime dans ce grand magasin où elle est accusée à tort d’avoir volé un vêtement, traînée dans la cave par un vigile grossier et brutal avant d’en être libérée et innocentée au bout de quelques heures. La scène, présentée d’abord dans toute sa violence réaliste sera revisitée, revécue, marquée au fer rouge sur le front de la narratrice qui, à l’instar de Madame K choisira le repli, le silence, « la marge du monde » et l’oubli – ou plutôt le non-oubli, puisqu’elle en multiplie l’écriture.
Jusqu’à ce que le lecteur, perplexe, à qui l’autrice a livré la seule clé possible – « Écrire ajoutait souvent une énigme à l’énigme » –, comprenne enfin, en reliant les fils et les visages, qu’il se trouve, non pas dans la galerie des glaces, mais devant un jeu de miroirs et il se souviendra que l’autre nom du miroir est psyché et que ce mot ne signifie rien d’autre, étymologiquement, que l’« âme ». C’est alors que la narratrice qui tient, à un moment, entre ses mains un ouvrage du grand romancier japonais Yasunari Kawabata, nous délivre cette citation qui est une autre clé du livre :
« Montrez-moi votre âme en la posant sur la paume de ma main. Telle une boule de cristal. Et moi, je la dessinerai avec mes mots »
C’est exactement ce que fait Mérédith Le Dez dans ce roman que l’on pourrait, à défaut d’un roman d’apprentissage – bildungsroman – ou de formation, qualifier de « roman de la vocation ». Posant son personnage devant elle à la façon d’un peintre, derrière son chevalet d’écriture, elle esquisse sur la toile/page son profil, échafaude son ossature, sa structure, le place en paysage, en situation, privilégie les différents traumas d’une vie, ses blessures et ses cicatrices, et d’une plume leste, ainsi que fait l’aquarelliste, sans bavure ni pâté, elle trace les lignes brisées de son destin. Car l’on saura, en fin de route, qu’Isaure Clément est la fiction de cette Laurence Métis, et de même que disait Flaubert, « Madame Bovary c’est moi », eh bien ! Isaure est Laurence… dans le miroir, au terme de cette belle injonction à créer par l’écriture :
« Rejoignez Isaure sur son île. Nous publierons son livre. Reculez dans les forêts bleues de ses carnets. Avancez. Écrivez. Continuez à faire parler les miroirs, laissez la voyante hallucinée lire dans la paume de votre main. »
Et succombant à cet « exercice de lucidité paradoxale » qui, selon elle, définit l’écriture, la narratrice – l’autrice – referme son grimoire sur cette phrase ultime en forme de berceuse :
« Plus tard, dans la chambre comme une île, bien plus tard, dormant d’un sommeil d’enfant sage sanglée sous un drap blanc, se presseraient encore à ses paupières les beaux, les inquiétants souffleurs de rêve ».
Mais c’est, bien sûr, le lecteur de ce texte fascinant qui, tenant ce livre, tenant la main de Mérédith, est convié à faire de beaux rêves.
Mérédith Le Dez, L’Invention des miroirs, éditions des femmes Antoinette Fouque, 210 p., 18 €. Parution : 16 janvier 2025
Article connexe :
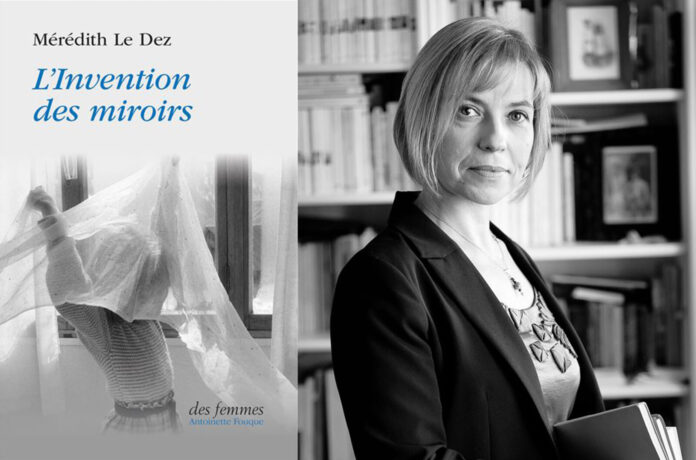
Notre existence avec toutes ses tribulations affecte-t-elle notre moi profond, notre âme? Ou celle-ci reste-t-elle identique à elle-même, quels que soient les événements qu’elle traverse? Les mots, comme parfois la musique, parviennent-ils vraiment à la faire partager? Oui, apparemment, à condition de bien les choisir. Et c’est ce que font, à l’évidence, Mérédith Le Dez, et, tout autant, Albert Bensoussan, cet autre miroir, qui, avec les siens, nous fait sublimement sentir ceux de l’auteur.