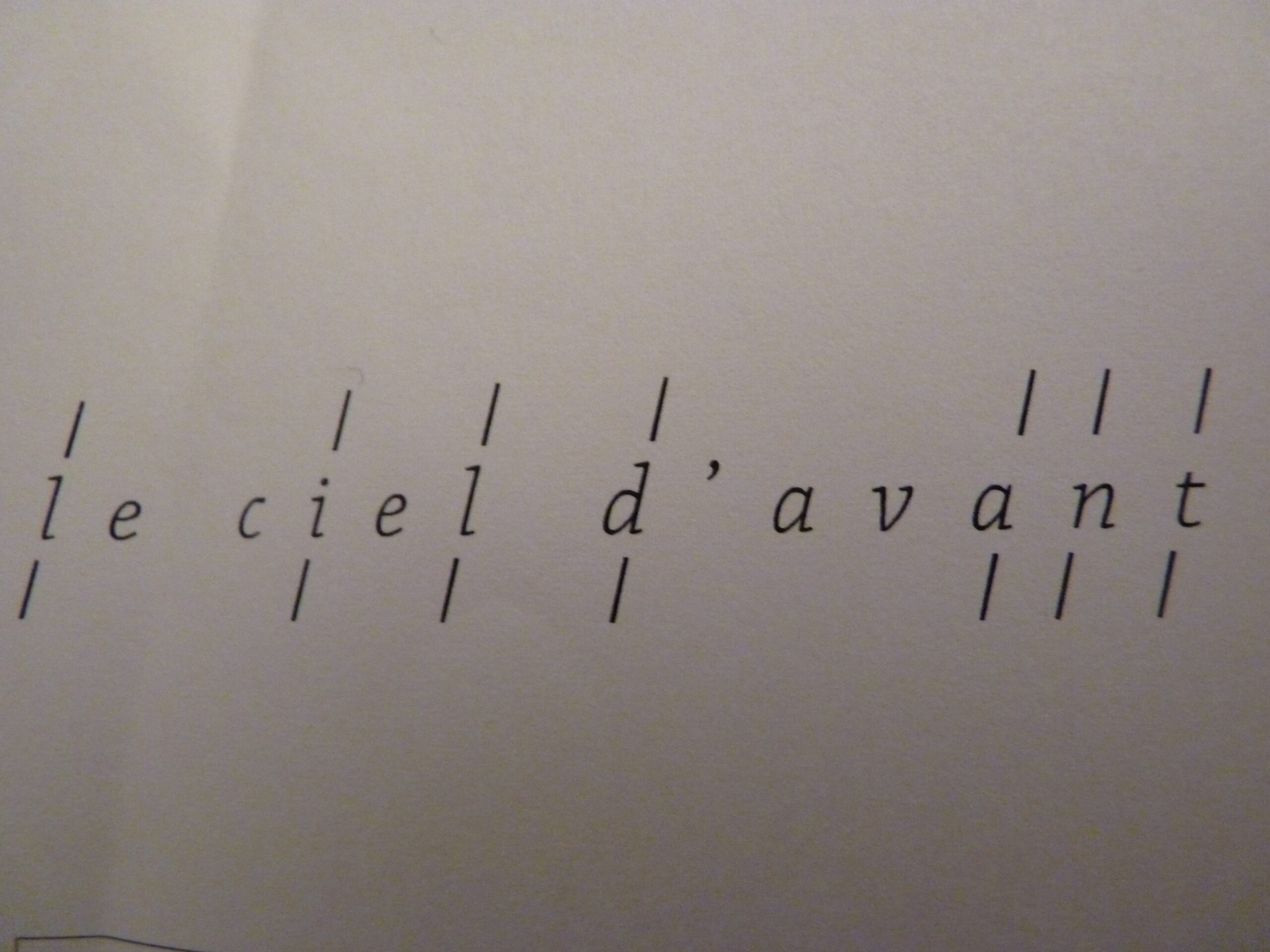Recension sous forme d’introduction par David Norgeot suivie d’une critique nourrie par Juan Asensio. Les points de vue enrichissent l’esprit critique. Il n’en fallait pas moins pour célébrer Muray.
Évidemment sans Fabrice Luchini, Philippe Muray serait toujours un illustre inconnu pour la majorité des français. Mais grâce à un spectacle dédié, il n’en est rien et c’est tant mieux. Pamphlétaire de génie, Muray l’était assurément. Drôle aussi. Mais il était beaucoup plus que cela. L’invention de Philippe Muray s’attache à le démonter.
Souvenons-nous : Muray a longtemps été considéré comme un grand réactionnaire. Son audience ne dépassait pas une dizaine de milliers de lecteurs. Alexandre de Vitry s’emploie à démontrer que cette perception est purement un artifice : selon lui, Muray aurait refusé ce rôle de penseur en lutte contre le bien-pensant politique et domestique.
Il brosse l’œuvre de Muray pour mieux en faire sa démonstration. Le père de Festivus Festivus dressait avant tout une analyse de son époque afin de déployer un jugement critique, loin des poncifs systématiques de l’intelligentsia établie. Attention : l’aspect critique, voire caustique, ne se réduit pas à une langue destructrice. L’humour, la tendresse et une certaine folie innervent en filigrane cette fête de l’intelligence critique.
En contrepoint, l’auteur donne une part importante aux adversaires de notre virulent penseur. Un des points qui fait l’originalité de cet ouvrage.
Certains apprécieront un angle d’attaque digne de Muray, d’autres la regarderont comme un viol réducteur imposé à l’auteur sans son consentement. Dans tous les, on ne peut que se réjouir que l’esprit critique soit un banquet partagé.
Étonnante, cette façon de découvrir un auteur, une œuvre et une lecture de l’histoire qui s’attache à son sens. À la fois séduisante et critiquable. Certains s’attachent à suivre le sens de l’histoire, d’autres, l’histoire du sens.
David
L'Invention de Philippe Muray, d'Alexandre de Vitry, Carnets Nord, 288 p., 20 €.
Critique par Juan Asensio
«La révélation de Dante est sa propre révélation, et elle sera celle de lui-même.»
Harold Bloom, Ruiner les vérités sacrées (Circé, coll. Bibliothèque critique, 1999), p. 60
Écrivons d’emblée que ce texte, s’il a pu constituer un mémoire honorable de DEA tout entier consacré au livre le plus intéressant de Philippe Muray, Le XIXe siècle à travers les âges, matrice selon Vitry du reste de l’œuvre (cf. p. 169), n’est qu’un essai assez banal par son écriture et son propos, et surtout fâcheusement répétitif.
Les 286 pages du premier ouvrage d’Alexandre de Vitry ne contiennent en effet qu’une seule idée, mais répétée tout au long de ses 286 pages ou presque (excluons quand même la bibliographie et la table des matières) : Philippe Muray est un écrivain, ce qui peut se traduire, précision utile, par un «individu littéraire» (p. 181).
Alexandre de Vitry, lui, est peut-être un individu littéraire, mais pas exactement un écrivain, puisqu’il prépare une thèse de doctorat sur Charles Péguy, sous la houlette d’Antoine Compagnon, du reste plusieurs fois cité dans son ouvrage, comme il se doit pour un directeur de thèse et professeur à la mode sinon influent. Notre agrégé de Lettres modernes et ancien élève de l’École Normale supérieure de Lyon semble, pourtant jeune (puisqu’il est né en 1985), déjà maîtriser quelques techniques qui lui permettront de poursuivre sa carrière que l’on devine universitaire et, s’il y renonçait, devenir le spécialiste autorisé de Philippe Muray en nous répétant à l’envi, sous toutes les formes, à tous les paragraphes, quatre ou cinq fois par page et plusieurs dizaines de fois au cours des douze chapitres qui composent son livre, que Philippe Muray, s’il est quelque chose ou plutôt quelqu’un, est un écrivain c’est-à-dire, désormais nous le saurons puisqu’on nous l’a répété un bon millier de fois, un individu littéraire.
Le procédé est tellement peu fin que même Élisabeth Lévy, qui jamais ne manque une occasion de rappeler tout ce qu’elle doit à Muray, a dû finir par le remarquer.
Un écrivain, ce n’est pas, comme nous pourrions le penser naïvement, un homme qui sait écrire, un romancier par exemple qui aurait composé de beaux romans (Muray, lui, en a composé d’à peu près illisibles, si tant est qu’ils aient été lus par d’autres qu’Alexandre de Vitry et moi-même), c’est, nous dit l’auteur, un individu qui s’est extrait, parce qu’il est porté par l’élan de l’exotopie qui n’est rien d’autre qu’un processus d’individualisation (cf. p. 169) admirablement réalisé par la littérature comprise comme absence de lieu et «nullité d’horizon» (p. 161), hors de la masse indifférenciée non seulement des écrivants mais des écrivains qui, comme Michelet ou Hugo, n’ont su que répéter le catéchisme dixneuviémiste occulto-socialiste, l’ocsoc dans les termes de Muray.
Ainsi, Philippe Muray, qu’on veut à tout prix nous faire prendre pour un écrivain, s’il l’est, ne l’est, à mon sens, que comme génial paraphraseur, manieur des langages seconds chers à Merleau-Ponty. Du reste, Alexandre de Vitry, parfois, ne peut que se résoudre à admettre cette évidence, bien qu’il la récupère, on s’en doute, pour servir sa thèse simpliste : «Ainsi, quand Muray fait le choix de la poésie, il ne s’agit pour lui que de faire saillir l’aspiration poétique ridicule de ses contemporains comme de tous ceux dont ils se réclament» (ibid.). Curieux, j’aurais eu tendance à penser qu’un écrivain, romancier, homme de théâtre ou poète, se prouvait, d’abord, par ce qu’il était capable d’écrire plutôt que par ce qu’il était capable de moquer, railler, conspuer, paraphraser. Étrange, encore, car j’aurais eu tendance à penser qu’un écrivain, si en effet il est comme excentré, jeté hors du monde par son art quitte, bien évidemment, à retrouver ce monde complètement récréé dans son œuvre, ne peut toutefois se contenter de la position de Sirius, pas franchement la plus à même de percer, de sa lointaine lumière, le ventre mou de l’Empire du Bien qui, de fait, semble avoir déjà digéré Philippe Muray.
Et l’Empire a digéré Muray avec ne facilité non point étonnante mais banale, sans doute parce qu’il n‘est pas un écrivain mais un observateur corrosif, un prodigieux commentateur, un excellent critique, un fier polémiste, bref, pour le dire simplement, un homme de l’Empire, un serviteur certes plus rusé qu’un de ces séides festivistes qu’il s’est amusé à peindre en couleurs criardes et ridicules, un allié masqué si l’on veut, mais un apôtre zélé de l’Empire. Un écrivain véritable peut prétendre échapper, et par quels efforts de tous les jours, quelle tension abominable dès qu’est née la certitude de l’œuvre à écrire, quelle force de résistance prodigieuse aux tentations raffinées de la courtisane, ses mille ruses pour encercler votre esprit et votre corps, aux filets de l’Empire. Pas Philippe Muray, essayiste de grand talent et romancier et poète à peu près nuls.
En d’autres termes, si l’Empire du Bien a si vite récupéré son meilleur ennemi qui n’était que son séide le mieux dissimulé, c’est que ce dernier n’est jamais parvenu à lui échapper par la création d’une œuvre littéraire romanesque digne de ce nom qui ne se serait pas contentée, comme le fait celle du polémiste, de cracher sur le temps présent mais qui, ô surprise, en aurait montré la complexité et la beauté. Seule l’apparition d’un chant capable de saluer la beauté peut dégonfler la baudruche festiviste et occulto-socialiste, mais certainement pas la dérision, aussi juste soit-elle, de l’Empire d’Homo festivus.
Il est ainsi déplaisant, mais hélas tout à fait normal, de constater de quelle très douce façon Philippe Muray, qui se serait sans doute coupé la langue plutôt que de devoir admettre l’existence d’élèves ou, pire, de disciples, commence à devenir un maître à penser pour tout un tas de jeunes et moins jeunes gens depuis qu’il est mort. En effet, le voici non seulement broyé mais digéré, liquéfié par les sucs gastriques de l’Empire, et ce n’est point l’ouvrage de Vitry qui pourra ralentir ce processus, si tant est qu’il ne l’accélère pas, en nous offrant un cas extrême de bavardage pseudo-érudit sur Muray… Le bavardage est l’arme la plus formidable de l’Empire du Bien qui réduirait une muraille de diamant, qu’importe le temps qu’il lui faudrait pour liquéfier, atome par atome, l’édifice imprenable.
En fin de compte, si Alexandre de Vitry n’a qu’un mot, assez laid, à la bouche, celui d’exotopie du sujet véritable, de l’authentique personne bref, de l’écrivain de race qui, pour survivre, ne peut que lutter sans merci contre l’Empire tellement glouton qu’il avale tout, le blanc, le noir, le oui, le non, le bas, le haut, la gauche, la droite et même le Mal, le livre qu’il consacre à Muray fait rentrer l’essayiste, d’une certaine façon à la fois ironique et paradoxale, dans le rang, il lui fait réintégrer le moule, celui des réseaux et des affinités bien évidemment électives et, par son bavardage consciencieux, ne nous donne pas même l’envie de nous plonger dans les fameux volumes, à la couleur gris bleu si indéfinissable, des Belles Lettres.
Bavardage disais-je. Ainsi l’auteur nous fait-il, bien que discrètement, comprendre qu’il a accès au journal intime de Philippe Muray (cf. pp. 218 et 272), ce qui augure une future publication et, sans doute, la préface qu’il conviendra d’écrire à ce gros volume. Ainsi savons-nous qu’il a participé également au volume collectif dirigé par Maxence Caron et, paraît-il (nous y reviendrons dans une note future), Jacques de Guillebon. La simple présence du patronyme Guillebon, dans un recueil de textes, est toujours le signe le plus évident d’une actualité brûlante, équivalente à la faculté commune de s’adapter à l’air du temps, tout comme le poulpe, grâce au mécanisme de l’homochromie, se confond presque parfaitement avec la couleur et la texture du décor qui l’entoure. S’il y a des hommes pressés, selon le refrain, je connais quelques catholiques pressés, pressés d’écrire, pressés de faire parler d’eux, pressés de rendre leur nom visible sur les couvertures de livres vendus à La Procure, pressés d’être invités, écoutés, lus, publiés, commentés, bénis et, allez savoir puisque nul n’est à l’abri de la sainteté, pressés d’être priés.
Pas de doute, Philippe Muray devient quant à lui, selon l’expression convenue, un véritable cas d’école, lui qui pourtant détestait les coteries, et, probablement plus que n’importe quelles autres coteries, les raouts littéraires, lui qui encore, bien que proche d’un christianisme pensé comme dernière force capable de dégonfler la baudruche festiviste qui a avalé la société contemporaine, haïssait les chapelles.
Les raisons de cette haine bandant sa force pour décocher le plus loin possible la flèche empoisonnée du curare de l’humour, Alexandre de Vitry les explique en affirmant que l’œuvre de Philippe Muray est moins celle d’un penseur que celle d’un écrivain puisqu’elle est «strictement littéraire» (p. 17), que le «projet littéraire détermine et englobe» (p. 32) tous les autres projets, qu’ils soient comiques ou critiques. Muray, ça oui, était un homme seul, mais la solitude, fût-elle une exigence impérieuse, n’est pas la condition essentielle pour faire d’un homme un écrivain.
Alexandre de Vitry revient également bien des fois, bien trop de fois à dire vrai, sur l’idée, après tout plus que banale et découlant de la précédente, que Philippe Muray se serait inventé lui-même, non sans s’être inspiré de modèles qui ont joué le rôle d’intercesseurs comme Balzac, Baudelaire ou Claudel (1), invention de lui-même en tant qu’écrivain afin de proposer «une façon nouvelle de décrire le monde, de s’emparer des phénomènes, sans laquelle on ne peut comprendre le regard qu’il portera sur notre modernité tout entière» (ibid.). Rien de bien neuf depuis tel ouvrage, infiniment plus convaincant que celui de Vitry, d’Harold Bloom qui écrit : «Tous les grands poètes, que ce soit Dante, Milton ou Blake, doivent ruiner les vérités sacrées et n’en faire que fable et vieille chanson, parce que, précisément, la condition essentielle de la force poétique est que la nouvelle chanson, la sienne propre, doive toujours être une chanson de soi-même» (cf. op. cit., p. 140).
Ailleurs, Alexandre de Vitry affirme que ce que «Muray invente, c’est justement ce «moi», une façon nouvelle d’être écrivain, de voir, de parler et de penser. Philippe Muray invente Philippe Muray» (p. 74, l’auteur souligne), chute de la plus belle eau journalistique davantage que tautologie énigmatique.
En fait, bien que l’analyse du XIXe siècle à travers les âges, qui occupe plusieurs chapitres du livre, soit intéressante en bien de ses points, l’auteur aurait pu sans peine résumer sa thèse en ces quelques lignes (p. 106 puis 182) : «En écrivant Le XIXe siècle à travers les âges, Muray réinvente toute l’histoire littéraire, politique et religieuse de la modernité, en la faisant sienne. Il s’invente une nouvelle date de naissance, 1786 (1) et se «rajeunit», lui aussi, de deux siècles, inaugurant une œuvre qui épouse les dimensions de la modernité tout entière. En réinventant Baudelaire, Balzac, Flaubert ou Claudel, c’est donc un nouvel écrivain qui s’invente, et toute son œuvre à venir. La description du grand mouvement collectif moderne s’accompagne de son envers : une théorie [je croyais que Muray n’était qu’écrivain ?] de l’individu, seul capable de décrire son autre, la masse dixneuviémiste, seul apte à construire une représentation littéraire lucide de la désindividualisation générale»; ou bien, donc : «Homo festivus a prétendu mettre fin à l’Histoire, mais Muray met fin à Homo festivus lui-même. Par la littérature, l’individu prend sa revanche sur l’irrépressible ordre collectivisateur de la post-Histoire, en le liquidant à son tour».
Las, nous avons, en guise de résumé d’une thèse après tout fort peu originale qui tient, je le rappelle, en quatre petits mots, Muray est un écrivain, des dizaines de répétition, la même antienne déclinée toutes les fins de chapitre : Philippe Muray, par le rire grinçant, le catholicisme, le sexe (3) qui permet à Muray de «jouir de relater seul l’absence de jouissance de ses contemporains» (p. 252), qui lui permet aussi, nous dit-on, de résister à l’impératif catégorique de l’Empire du Bien visant à la reproduction (cf. p. 249), mais aussi la poésie, qu’il illustra pour le moins assez lamentablement (4), le roman, qu’il illustra sans beaucoup de talent ni même de persévérance, la psychanalyse (5) et la politique (6), la redécouverte des grands intercesseurs comme Balzac grâce auquel, bien sûr, il s’est inventé (7), par le fait même, rendez-vous compte, d’avoir fendu une immense foule festive et versicolore de crétins à rollers en les injuriant ou bien, après avoir passé une journée à Disneyland, en ayant conservé sur la tête d’immenses oreilles de Mickey comme se plaît à le rapporter Vitry, bref, si j’ai bien compris, par le fait que Philippe Muray est bel et bien Philippe Muray, Philippe Muray s’invente lui-même, se découvre en tant qu’écrivain, s’extrait, représente «l’intégralité du monde uniformisé», rend «l’indifférencié à l’indifférencié» et par là produit «par l’écriture une différence irréductible, un non-lieu, une sortie de la «salle d’assises» [cf. Le XIXe siècle à travers les âges, Gallimard, coll. Tel, 1999, p. 643]» (p. 175).
Comme si, en fait, l’écriture d’Alexandre de Vitry avait été phagocytée par son sujet-même, non pas l’évocation de Philippe Muray, qui n’est finalement qu’un prétexte, mais celle de l’ocsoc, l’occulto-socialisme se répandant, selon Muray, à travers les âges et parachevant enfin sa trajectoire dans la béatitude de la société festive. Se diluant, ne présentant plus un seul visage sur lequel cogner mais des millions de mufles placides, s’indifférenciant (un terme dont Vitry saupoudre chacune de ses pages ou peu s’en faut) jusqu’à se tenir à l’extrême bord de l’annihilation, il faut, pour s’aventurer dans un pareil royaume d’ombres la force d’un Bernanos qui ramènera, de sa plongée dans le rien, le podagre Monsieur Ouine encore surpris d’avoir été exposé en pleine lumière si je puis dire, loin de ses ombres protectrices. Pour accomplir pareille anabase (puisqu’il est plus difficile de revenir des Enfers que d’y descendre), on se doute qu’Alexandre de Vitry, qui, dirait-on, s’invente ou tente de s’inventer, par l’écriture de son texte, plus qu’il n’invente Philippe Muray, n’est absolument pas de taille.
Échec de ce livre qui a dû porter comme premier titre Le rire de Philippe Muray, si j’en crois une première de couverture que tel site de commerce électronique met en ligne. Écriture répétitive, épousant la forme même de la modernité, l’itération, le ressassement : «La fête précède tout, désormais, et tout en procède. L’événement ne peut plus que prolonger la fête, répéter la fête. L’événement est une fête. L’événement fête la fête» (p. 15) et, en quelque sorte, Philippe Muray précède tout et tout, d’ailleurs, en procède, comme l’affirment, sans vraiment rire, les dernières pages du livre, non pas seulement répétitives mais insupportables dans leur obsession (8) : «C’est à travers la constitution de Muray comme individu littéraire que s’énonce la vérité de l’indifférenciation post-historique. Le monde moderne n’a pas inventé Philippe Muray. C’est Philippe Muray qui, s’inventant lui-même, a inventé le monde moderne» (p. 261).
Alexandre de Vitry, lui, s’il n’a pas inventé le bavardage, peut au moins se targuer d’en avoir capturé quelques bribes dans un livre inutile et, ainsi, d’ironique façon, d’avoir démontré que, captif de ce monstre sonore, il est tout ce que l’on voudra sauf ce que fut, avec talent, Philippe Muray : non pas un écrivain mais un essayiste.
Notes
(1) Page 131, cette bizarrerie : «la rupture pontificale [soit la «trilogie dramatique pontificale» selon l’auteur, L’Otage, Le Pain dur et Le Père humilié] permettait à Claudel de rompre lui-même avec le siècle; la rupture de Claudel permet à Muray, à son tour, de s’extraire sans ambages du grand ensemble dixneuviémiste».
(2) Cette date (précisément : le 7 avril) est, selon Philippe Muray, au moins aussi importante, sinon beaucoup plus, que celle marquant le début de l’Empire du Bien, 1789 bien sûr : il s’agit de la destruction du cimetière des Innocents, les cadavres étant désormais déposés dans les Catacombes, sous le faubourg de la Tombe-Issoire.
(3) Le chapitre 12, intitulé Sexe et caractère dans un calque de l’ouvrage le plus connu d’Otto Weininger, est, de loin, le plus ridicule de l’ouvrage d’Alexandre de Vitry qui écrit : «Cette érotique de la dissension est aussi une esthétique de la séparation : plaisir à pénétrer le monde, à s’en saisir comme d’un corps, plaisir à en sortir, à s’en dégager, puis à recommencer jusqu’à l’épuisement la même opération. Nous retrouvons, formulé dans les termes de la relation sexuelle, le rapport permanent de l’écrivain à son œuvre, du sujet à l’objet, comme rapport simultané de présence et d’absence à l’œuvre, d’adhésion et de désolidarisation, de contiguïté et de séparation absolue. Puisque la pratique littéraire est une pratique sexuelle, et puisque la jouissance sexuelle est l’expérience absolue de la différence entre les sexes, on ne s’étonnera pas d’entendre Muray dire finalement, de manière apparemment anodine : Je ne me fiche pas du tout des lecteurs et encore moins des lectrices» (pp. 258-9). Autre perle, absolument volontaire : «À la délectation de l’individu seul face au spectacle de l’absence de sexualité, forme de «pulsion scopique» renversée, succède le plaisir de l’extraction. Écrire Minimum respect, c’est se faire le dernier, le seul individu sexuel [je me demande, dans ce contexte pour le moins signifiant, si l’auteur à songer au sens le plus trivial de l’expression se faire]. Ce second temps de la jouissance (l’extraction après l’observation) est celui de l’écriture elle-même, de la par la littérature. Au sens propre comme au figuré, Muray dé-conne» (p. 257, l’auteur souligne).
(4) «Tu l’as voulu
Être foutue
Tu l’as dans le cul
Tu ne te sens plus», in Minimum respect (Les Belles Lettres, 2003), p. 111.
(5) «L’écriture n’a que la vie terrestre pour objet, tout en ayant pour origine négative une mort au monde, dans le tombeau vide comme injonction au réalisme – chez Balzac : disparition du père, assomption du réalisme intégral» (p. 222).
(6) «Pour résumer, je dirai que l’individu démocratique, l’individu qui obéit à l’impératif catégorique, pourrait être appelé : individu politique. L’individu qui s’y dérobe : individu littéraire» (p. 208).
(7) «L’invention de Muray passe par une réinvention de Balzac, comme on parle de l’«invention» d’une relique dans la religion catholique : découverte qui institue l’objet dans sa vraie nature de relique» (p. 141).
(8) Par exemple : «Nier ou oblitérer Le XIXe [siècle à travers les âges], c’est ne pas voir que Muray s’invente, à un moment donné, à l’échelle de toute la modernité. Qu’il se constitue comme individu littéraire afin de se créer une position, une «chambre d’écho», comme il dit, d’où décrire la fin de l’Histoire comme indifférenciation générale» (p. 266). Quelques lignes plus loin, rebelote : «Ce qui, précisément, permet de saisir le travail de Muray comme une entreprise spécifiquement littéraire, c’est la mise en relation de tous ses éléments, c’est ce en quoi, ensemble, s’emboîtant les uns dans les autres, ces éléments font œuvre» (p. 267, l’auteur souligne). Enfin, les toutes dernières lignes du livre, p. 272, nous resservent, pour la cinquantième fois peut-être, la même rengaine, histoire probablement que nous la mémorisions bien : «Commençons par envisager son œuvre comme une entreprise foncièrement, continûment et exclusivement littéraire. Et attendons de lire son Journal, tenu pendant près de vingt-cinq ans, qui paraîtra bien un jour [faisons, sur ce point, confiance à Alexandre de Vitry]. À travers lui, plus que jamais, nous pourrons suivre au plus près l’invention de Muray, au fil des années, l’édification, pierre à pierre, de l’édifice-Muray, et comprendre celui-ci comme un individu littéraire, et avant tout comme cela » (l’auteur souligne).
Juan Asensio (voir l’article sur Stalker)