« C’est pourquoi aussi tout ce qui, dans la distribution des couleurs, des ombres et des lumières d’un paysage y fait une part matérielle plus apparente aux indices de l’heure et de la saison, en rend la physionomie plus expressive parce qu’il y entretisse plus étroitement la liberté liée à l’espace au destin qui se laisse pressentir dans la temporalité ». J. Gracq. (En lisant, en écrivant, tome II., p. 616, Gallimard).
Évoquons ce voyage éclair qui aurait dû estomper sinon occulter les lieux et les paysages s’il n’y avait eu la Loire au bout de notre route.
Voyage dont le but est Saint-Florent le Vieil, en une sorte de salut à Julien Gracq, mort en décembre 2007. Le village de Saint Florent le Vieil est le lieu de naissance, de jeunesse, de retraite et de mort de Julien Gracq, homme de lettres que beaucoup – dont moi, pour ce que je sais du domaine littéraire – placent parmi les plus éminents de la littérature française contemporaine.
L’émotion forte de ce voyage provient d’abord de la Loire. Non que ce fleuve me soit méconnu. Pour l’habitant de Normandie que je suis, tout voyage méridional dans l’hexagone en impose le franchissement. Que ce soit à Tours, Angers, Amboise, Orléans, Saumur, ou Nantes. Mais les ponts favorisent rarement la connivence avec les eaux qu’ils surplombent. Là, au Fresne sur Loire, ce village frontière entre l’Anjou et la Bretagne, rien de tel.

Il est vrai que nous ne sommes pas si loin de l’estuaire, ouvert comme une gueule qui s’apprêterait à mordre l’Atlantique comme pour y marauder les richesses d’Amérique dans on sait bien quels commerces triangulaires. Mais la Loire ne saurait se résumer à l’évocation de son histoire, aussi fastueuse soit-elle du temps des cours royales, pérégrinant de château en château, aussi laborieuse soit-elle du temps des mariniers de Loire… Elle frappe d’abord par sa puissance immuable comme le temps. On comprend enfin pourquoi les Latins, s’inspirant de la singularité inouïe du sens du divin chez les Grecs, voyaient dans les fleuves une divinité. À cette aune, la Loire, le fleuve Liger, dans cette religiosité profane définie par W. F. Otto, conserve quelque chose de divin.
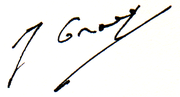
Mais tout cela ne saurait dire sinon de façon maladroite et sentencieuse combien ce passage par le lit de la Loire – à toucher l’eau – m’a fait ressentir à la fois la puissance, l’immuabilité et la présence quasi obsédante du fleuve. Ce qui explique sans doute la permanence de ces « chanteux de Loire » qui, contre le cours du temps, chantent les joies et les peines de ces métiers quasi disparus.
Et, pour reprendre la citation de Gracq, liminaire à ce texte, le fleuve Loire entretisse plus étroitement la liberté liée à l’espace au destin qui se laisse pressentir dans la temporalité.
La Loire bien sûr me conduit directement à Gracq et à son œuvre. Ce n’est pas la première fois que j’évoque Gracq, mais c’est la première fois que je l’aborde par la proximité de ses lieux de vie. L’œuvre de Gracq est jalonnée de références permanentes au fleuve.
Grèves de Loire dans l’île Batailleuse. – Dès qu’on est couché au niveau de l’eau, champs et maisons cachés au regard, les berges s’ensauvagent, et les heures passent au long d’une espèce d’Orénoque ou de Sénégal, gris ou bleu selon le moment… L’eau, calme en apparence, et traîtreusement violente dès qu’on y plonge un peu profond, avec cette froide et pénétrante odeur de vase et de poisson qui sort d’elle dès que le soleil descend, et qui reste pour moi l’odeur même des soirs d’enfance, en été – le frisson brusque qui court sur la peau dès que monte cette odeur assez fine, un peu avant que ne descende la première fraîcheur -, et quand on remonte la berge, après le sable encore brûlant, l’herbe sous les pieds est froide et déjà nocturne : la menue coulée de Sahara qui se tord au long de Niger s’arrête tranchée net. (Lettrines, II, p. 244-245).
Loire d’enfance, de pieds nus dans la vase, d’odeur de vase et de poisson, de plongeons profonds dans les courants froids du fleuve géant devenu soudain Orénoque ou Niger longeant le « Sahara » du sable de laisse fluvial.
Loire d’enfance encore, de barques et de jeux d’eau ainsi évoquée dans Lettrines 2, (Gallimard II, p. 344-345) :
Plus tard, quand on me permit de conduire le bateau, le dédale des petites îles feuillues que les atterrissements de la Loire allongeaient à la queue de l’île Batailleuse devint notre repaire : là où s’étend maintenant un champ labouré il y avait des igarapés boueux entre les saules, des îlots vierges, larges de quelques mètres, envahis de roseaux et d’aulnes où robinsonner à loisir. J’ai encore dans l’oreille le bruit espacé, plat et liquide, des avirons quand nous glissions en froissant les branches le long de ces marigots tapissés de vase… un coin d’Amazonie ou de Louisiane s’embusquait là, intact, long d’une centaine de mètres à peine mais suffisant pour l’imagination…
Écrits fragmentaires qui révèlent chez Julien Gracq, tout autant les paysages de Loire que les jeux et les souvenirs récurrents de l’enfance, renforcés, d’évidence, par la fréquentation de l’œuvre de Jules Vernes – l’un de ses auteurs de référence – puisqu’il fait réminiscence, quelques lignes plus loin à des paysages et des personnages tirés du roman Nord contre Sud. Julien Gracq est d’autant plus subjugué par ses souvenirs d’enfance des bords de Loire que s’y recèle étroitement son enracinement familial :
Quant à mes origines, je manque de mélange. Pas de croisements profitables dans mon ascendance. Du côté paternel, mes attaches sont à Saint Florent, au moins depuis la Révolution et sans doute au-delà ; du côté maternel, à Montjean, la Pommeraye, Champtocé, depuis aussi longtemps : un cercle d’un rayon de huit kilomètres entre le tombeau de Bonchamps et le château natal de Gilles de Rais, a contenu toute mon ascendance depuis six générations et au-delà : tout cela Mauges, vallée de la Loire et Mauges encore, artisans de villages presque tous, « filassiers », boulangers, mariniers, tous, aussi loin que je remonte, parcimonieux, âpres au gain, comptant sou par sou, fermes sur les liens de famille, acharnés à acquérir, à hériter, à conserver… J’attribue à cette ascendance vendéenne mon caractère casanier, ma méfiance vis-à-vis des figures inconnues, le caractère figé de mes habitudes, le confinement dans un cercle de relations étroit, surtout familial, le goût de dire non… Je n’ai jamais eu à voir avec les espèces de plein vent.
D’évidence, Gracq est victime de la logique de son exposé. Certes, on ne saurait être plus « casanier », plus vendéen et habitant des bords de Loire que lui. À condition toutefois d’oublier ses longues éclipses migratoires, celles du lycée à Nantes, celle des classes préparatoires, de Normale Sup. et de Sciences Po, celles du service militaire, des pérégrinations liées à la guerre comme soldat ou comme prisonnier dans un stalag de Silésie, celle du compagnonnage d’André Breton, au surréalisme, au parti communiste, celle d’enseignant à Nantes, à Amiens, à Angers celle de la période d’enseignement universitaire à Caen de 1941 à 1945. Mais, il est vrai qu’il y eut aussi une longue période d’immobilité géographique et professionnelle, le temps de l’affectation au lycée Claude Bernard à Paris, de 1947 à 1970, soit 23 années, comme professeur d’histoire et géographie et auteur en vue.
Rien de tout cela, n’empêche d’être casanier et enraciné dans un territoire matriciel comme en témoigne, dès son entrée en retraite, l’évidence du retour de Julien Gracq au havre familial de Saint Florent. Bien entendu, la carrière littéraire et intellectuelle hors du commun de Julien Gracq n’entre pas dans ce schéma et lui a évité les risques des ressassements : membre reconnu du mouvement surréaliste, participant très actif des cercles d’intellectuels, d’écrivains, de cinéastes, de poètes, de gens de théâtre. Tout cela qui rappelle qu’on peut être un grand voyageur et changer la vie sans beaucoup se déplacer. En témoigne d’ailleurs le cercle des littérateurs et des artistes qui ont fréquenté Julien Gracq : André Pieyre de Mandiargues, Nora Mistrani, Hans Bellmer, Ernst Junger, Saint John Perse, Henri Queffélec, Léonor Fini, André Hardellet, André Breton et bien d’autres.
En notant aussi qu’en l’année du retour à Saint Florent le Vieil et dans les années suivantes, Gracq a publié huit ouvrages : La Presqu’île, 1970 ; Lettrines II, 1974 ; Les Eaux Étroites, 1976 ; En lisant en écrivant, 1980 ; La Forme d’une ville, 1985 ; Autour des sept collines, 1988 ; Carnets du grand chemin, 1992 ; Entretiens, 2002. Soit presque la moitié de sa production littéraire publiée. Sauf Autour des sept collines, traitant de Rome et de l’Italie dont le manuscrit attendait depuis des années, le tout consacré à des territoires de proximité. Qu’il s’agisse de proximité géographique et territoriale ou d’affinités littéraires.
Ce qui est souligner aussi que l’entrée en retraite n’aura concerné que l’activité professionnelle et pas du tout l’activité littéraire. Hormis le fait que les cercles parisiens d’attraction littéraire se seront progressivement dissous et défaits, du fait de la distance. Les visiteurs, les contacts, se seront progressivement raréfiés, à l’exception de quelques voyageurs respectueux, souhaitant l’onction du maître ou plus durablement, la mise en œuvre d’un rituel périodique d’amitié fidélisée. On retrouve là Régis Debré, Érik Orsenna, Bernhild Boie, Louis Le Guillou, Michel Murat et, dans la discrétion, un certain nombre d’autres. Qui n’ont probablement pas empêché l’entrée en solitude pour l’occupant unique de cette grande maison. Solitude renforcée par le décès, en 1997, de sa sœur qui partageait avec lui la maison familiale et qui fut sans doute la responsable de la mise en scène domestique, dans le droit fil des habitudes et du patrimoine familial.
J’aurais aimé reprendre, à propos de cette demeure un dispositif narratif que j’ai quelquefois utilisé : il s’agit de la maison chronotope que je décalque du concept, élaboré par Bakhtine, pour rendre compte des relations organiques que le romancier crée entre l’action, le personnage, le moment et le lieu, Bakhtine a créé le concept de « chronotope » : le « temps-espace ». Ainsi, pour Bakhtine, le lieu chronotope des romans de Balzac, de Stendhal et de Flaubert est le salon, là où se rencontrent les acteurs et où se nouent les intrigues… Il me semble qu’on peut élargir le concept de chronotope à la maison tout entière comme lieu métaphorique entre la demeure et ses occupants. Car la maison et son environnement peuvent être vus comme clef de lecture du monde, point d’intersection entre individus, petits groupes, voisinage, quartiers, sociétés locales et cultures régionales. En même temps qu’elle est sédiment de l’histoire personnelle et familiale et projection des rêves les plus intimes elle est, dans l’ordre de l’intime, système de théâtralisation sociale. Pour ce faire, il m’aurait fallu pénétrer dans la demeure de J. Gracq, ce que j’aurais jugé indécent de tenter, de son vivant comme après sa mort. Mais il est possible de s’appuyer sur des auteurs qui ont eu ce privilège : je pense à Louis Le Guillou dans Le déjeuner des bords de Loire, à Pierre Assouline et à Régis Debray par les nombreuses notices transmises aux journaux après leurs visites à Saint Florent, au point, sans doute que la renommée de l’un nourrissait celle de l’autre.
Régis Debray accompagne sa description sans concession de la maison de Gracq d’un saupoudrage de parisianisme. Ce qui lui permet de faire montre de son usage du monde, marqué d’une ombre de dédain :
Gracq, vivant, n’est pas dans cette villa balnéaire aux volets fermés, tout en hauteur, comme on en voit des milliers à Cabourg et à Trouville sur la digue. Harpes et clefs blanches sur crépi grisâtre, chien-assis à corniche de bois, proéminente, terrasse à balustres. Pas d’intérieur, ou si peu. Où sont ces « riens charmants de la vie » qui sédimentent insensiblement dans le sillage des poètes ? Ces admirables bric-à-brac que j’ai vus jadis chez Neruda, au bord du Pacifique, chez Aragon, ou dans l’ancien appartement d’Apollinaire, chez sa veuve, ou chez Breton, avec Élisa ? Tout est net, astiqué, et fichu comme l’as de pique. « Je suis peu sensible au mobilier, vous savez… ». Papier jauni aux murs, napperons brodés sur la table, buffets bretons à crédence, poêle Chappée, portemanteau suisse à gueule d’ours et horloge normande à balancier : rien du dépareillé « artiste ». Je me rappelais son portrait par Bellmer. Je n’aperçois qu’une gravure de tigre à côté d’un chromo d’aïeul dans un cadre doré : la « foudre espiègle » n’est pas passée par là ».
Régis Debray finit par se souvenir de l’histoire familiale qui lui donne les clefs de lecture de la maison de Gracq. L’homme vit en solitaire, après la mort de sa soeur aînée – dans les meubles accumulés par ses parents et grands- parents. Cette coquille d’emprunt ne donne pas le sentiment de faire partie de son moi romanesque…
Mais il achoppe sur l’essentiel : la maison de Julien Gracq a pour fonction première, et majeure, de lui donner à voir et à communiquer avec la Loire. Et ainsi de contribuer à une connivence entre Gracq et le fleuve. Le reste de la maison, meubles familiaux vieillis sous le harnois, papiers peints jaunis, fauteuils avachis, tapis élimés, cela n’est que « l’écume des jours » qui érode gens et objets…
Louis Le Guillou, dans un texte tout en volonté de réserve et d’empathie, décrit à touches subtiles la maison de Julien Gracq et son lien au fleuve :
Dans Dickens il y a plusieurs fois de grandes maisons sombres et la personne qui les occupe cloîtrée dans une seule pièce, avec le lit, la table, les photographies anciennes, la grande armoire et la pendule (mais pas, comme ici, la fenêtre sur le fleuve, les voitures au loin sur le pont comme un fil). Tiens, nous n’avons pas parlé de Dickens : il a parlé évidemment de Jules Verne et de Poe, je ne sais pas son rapport à Dickens.
Prenez le fauteuil.
Nous n’avons pas le même poids, je me suis lamentablement enfoncé dans le vieux fauteuil de cuir usé, il y avait les mêmes chez mes grands-parents, et le même son de pendule aussi, nous est venu d’une pièce plus loin, peut-être de la cuisine (« Je mange bien peu, désormais… »). À ma main droite le poêle, avec le journal du jour : c’était son fauteuil, sa place. Il avait gardé une casquette (« Vous me pardonnerez de garder mon couvre-chef… »), parce que la maison est peu chauffée – mes grands-parents non plus n’ont jamais chauffé leur maison comme nous chauffons les nôtres. Nous parlions de la Loire, et il a parlé de combien l’horizon lui était nécessaire pour écrire. Il a dit cela au présent…
Le tout rappelant d’évidence, la parfaite dichotomie entre l’homme de lettres au faîte d’une célébrité connue partout, sauf à Saint-Florent, où la plus grande discrétion s’impose, dans les rapports de voisinage, dans le choix des vêtements, dans la tenue de la maison. J’en ai eu confirmation en parcourant quelques rues de Saint Florent le Vieil, pour demander à une dizaine de passants s’ils connaissaient Julien Gracq – j’aurais sans doute dû demander Monsieur Poirier – et s’ils savaient où il habitait., pour n’avoir en réponse que signes de surprise et d’incompréhension. Étanchéité cultivée donc entre la carrière littéraire et l’homme social, d’une parfaite urbanité, attaché à son territoire et à son histoire familiale. C’était pour lui lucidité que d’écrire : J’attribue à cette ascendance vendéenne mon caractère casanier, ma méfiance vis-à-vis des figures inconnues, le caractère figé de mes habitudes, le confinement dans un cercle de relations étroit, surtout familial, le goût de dire non… Je n’ai jamais eu à voir avec les espèces de plein vent.
L’homme de lettre vivait sa vie d’abord par ses écrits, les visites qu’on lui rendait, ses échanges épistolaires et littéraires et par son goût prononcé pour les activités raffinées de bibliophilie concernant ses publications. Comme s’il en attendait un dérivatif à sa solitude doublé d’un prolongement et d’un surcroît de reconnaissance pour son œuvre, dans le temps long de l’histoire littéraire.
Mais son œuvre, parlons-en :
Je suis subjugué par cette écriture fascinante, raffinée, tout à la fois méticuleuse comme un scalpel et porteuse d’une poésie liée sans doute à l’accumulation des détails comme si cette accumulation permettait de forcer, en douceur, le seuil des choses et de transformer chaque paysage en métaphore d’un ressenti.
Cette précision lexicale, cette attention descriptive donnent bien sûr de la densité et de l’importance aux objets, aux paysages, aux ambiances et contribuent à cette recherche d’assonance et de symbiose entre les paysages, les rues, les villes, les maisons et les personnages qui s’y meuvent et qui, bien sûr, définissent l’auteur lui-même. Comme si le décor surdéterminait ce que ressentent les sujets. Ainsi, là encore, rôde l’ombre du chronotope… D’autant que dans Le rivage des Syrtes le chronotope de forteresse est d’évidence entouré d’un paysage méditerranéen.
Mais, il me plaît surtout que la littérature de Julien Gracq au fil de son œuvre, prenne distance avec la fiction. Je reprends là ce qu’en dit Philippe Le Guillou dans Le déjeuner des bords de Loire (Mercure de France, et Gallimard, Folio, 2007)
Il fut un écrivain de fiction… Et peu à peu la nécessité de la fiction s’est éteinte en lui. Non qu’il fut à aucun moment empêtré dans les contraintes lourdes du romanesque. Toujours il s’est situé ailleurs, à la lisière du récit et du poème. Sa phrase vient de Chateaubriand mais elle a rencontré, en route, la fulgurance de Rimbaud et les éblouissements du surréalisme. Je ne l’ai jamais entendu procéder à la moindre théorisation à propos de cette extinction de la fiction, ni la regretter. Aujourd’hui encore, il ne me semble pas homme à être habité par le regret. La fiction n’était qu’une modalité de l’écriture. Et l’on peut explorer les lieux, le cryptogramme des œuvres des autres, les chemins de terre et la bibliothèque sans avoir recours à elle.
Et c’est probablement aussi cette distance à la fiction et cette capacité de libre pérégrination qui me séduisent et pourraient me servir de modèle dans l’œuvre de Gracq, tant je goûte la liberté donnée de parler dans le même mouvement, de la Grèce comme de la Normandie et des environs de Caen, où, dit Julien Gracq… j’aimais prendre le chemin du nord qui mène par Douvres-la-Délivrande à Langrune, jusqu’à laisser derrière moi l’égrènement des maisonnettes au long de la route, jusqu’à rejoindre les labours à corbeaux, où le chemin coupait en demi-tranchée les molles ondulations du calcaire, et où un vaste horizon nu, éventé et salubre, me dispensait en même temps l’ampleur sédative de la campagne et le pressentiment de la mer…
Cette évocation pourrait s’arrêter là. Mais comment ne pas évoquer, même si tant d’autres l’ont fait, la perfection du Balcon en forêt, la magie de l’empathie au paysage, dans toute son œuvre, notamment dans Liberté grande, la sieste en Flandre hollandaise, et aussi dans toute description des hauts pays : J’aime les plateaux de lave comme le Massif central : le Cézallier ou l’Aubrac. Ainsi, Gracq fait dériver, tel un continent, la géographie vers l’univers poétique…
Que l’on retrouve dans ses rêveries – vaticinations de marcheur infatigable : Et dans un repli de la vallée de la Laize, j’ai longé plus d’une fois, l’oreille fascinée, le bouquet de hauts arbres où se tenaient, à l’écart, d’autres conciles, criards, caverneux, rituels, immémoriaux, sur les branches de chênes comme au temps des druides du gui, ceux des noirs pèlerins « de l’armée étrange aux cris sévères » : Rimbaud revient, partout sur la route, Rimbaud est né, s’est éveillé sur le grand chemin. Seul. Maintenant c’est fini. Une écoute s’est rompue. (Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade II. Lettrines, chemins et rues, p. 281).
Mais la mort est survenue. Vite expédiée selon les prémisses qu’en prévoyait Julien Gracq : le cercueil au feu, les cendres dans le caveau familial. Rien apparemment de plus inévitable pour ce vieux géographe, quasi centenaire qui rappelait que le maître concept en géographie physique est celui d’érosion.
Le tout, pour moi, dans un temps de connaissance de l’œuvre dramatiquement abrégé : entre la rencontre approfondie de l’œuvre de Gracq – qu’il s’agisse de La forme d’une ville, du Rivage des Syrthes, d’En lisant, en écrivant, du texte de Le Guillou, des Œuvres complètes de la Pléiade, des notules et articles liés à telle ou telle revue littéraire ou à tel encart sur Internet – et la mort de Julien Gracq, il s’est déroulé quelques mois. C’est dire que mes lectures initiales de Gracq correspondaient sans doute à des moments où il avait déjà rédigé ses prescriptions testamentaires, tant en matière de la création d’une Maison d’écrivain à Saint Florent, dans son logis familial, que de la cession de ses archives à la BNF et à la bibliothèque de l’Université d’Angers. Le choix de Bernhild Boie, comme exécutrice testamentaire, celle même qui avait produit tout l’appareil critique accompagnant la publication de ses œuvres complètes dans La Pléiade, était sans doute, lui aussi arrêté… Mais le temps postérieur à sa mort m’a permis d’approfondir la connaissance de son œuvre littéraire, sur le mode de l’aléa, de l’impulsion et du bon plaisir. Ce qui est le privilège souverain de toute bonne littérature. Ce qui est dire aussi la puissance de l’attraction stylistique, comme pourrait l’être une musique de Bach, de Pachelbel ou de quelque autre qui, par la maîtrise de la technique musicale et artistique vous entraîne vers le rêve et la beauté.
Peut-on augurer de la réponse à la seule question qui compte désormais : la mort de l’auteur scelle-t-elle le déclin de l’œuvre ou en prépare-t-elle un regain ? L’histoire littéraire est trop fertile en rebondissements inattendus pour se risquer à pronostics… Tout au plus peut-on spéculer sur le fait que la perfection stylistique, la magie de la langue et son caractère réservé et intemporel inclinent à penser que cette œuvre, dont beaucoup reste à publier, sera encore porteuse de ravissements et de longues résonances. Même si beaucoup regrettent cette réserve, cette partition dans le retrait et l’intemporel du monde.
Pierre Coulmin
Œuvres
Au château d’Argol, (1939)
Un beau ténébreux, (1945)
Liberté grande, (1946)
André Breton, quelques aspects de l’écrivain, (1948)
Le Roi pêcheur, (1948)
La Littérature à l’estomac, (1950)
Le Rivage des Syrtes, (1951)
Prose pour l’étrangère, (1952)
Un balcon en forêt, (1958)
Préférences, (1961)
Lettrines I, (1967)
La Presqu’île, (1970)
Lettrines II, (1974)
Les Eaux étroites, (1976)
En lisant en écrivant, (1980)
La Forme d’une ville, (1985)
Proust considéré comme terminus, suivi de Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, (1986)
Autour des sept collines, (1988)
Carnets du grand chemin, (1992)
Entretiens, (2002)
Plénièrement (Éditions Fata Morgana, 2006) (réédition d’un texte d’hommage à André Breton publié dans la NRF en 1967)
Manuscrits de guerre, (2011)

