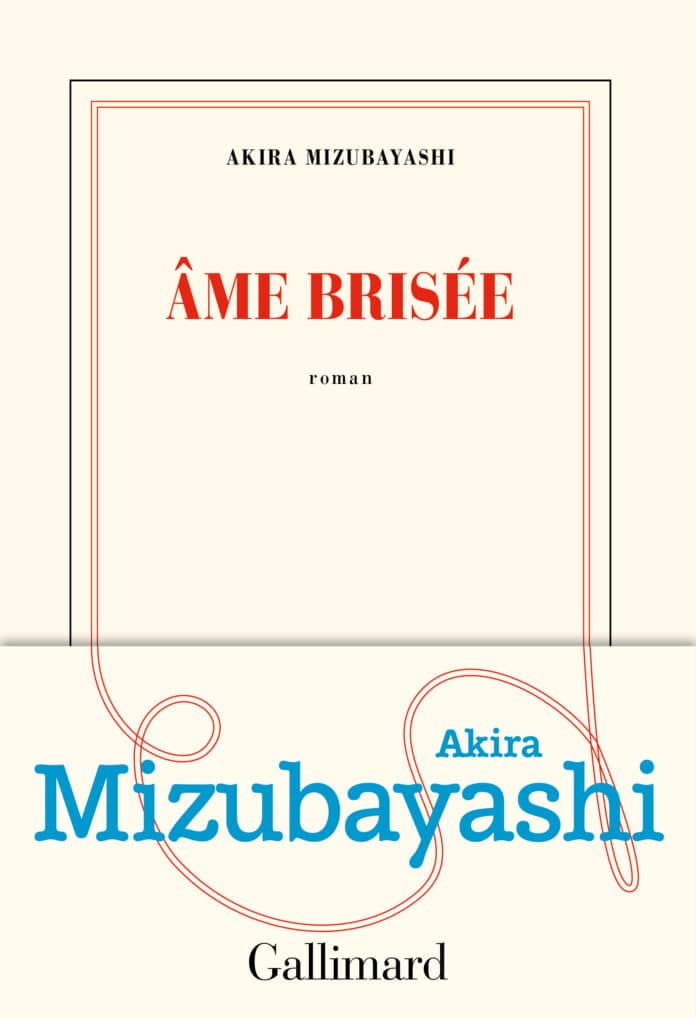Voilà le cinquième livre et deuxième roman d’un merveilleux écrivain japonais féru de littérature française, maîtrisant parfaitement notre langue dans un style toujours fluide et délicat. Akira Mizubayashi, marié à une Française et homme de deux cultures, nous avait séduits avec Une langue venue d’ailleurs où, disait-il, il s’abandonnait avec délice à « cette errance entre les deux langues ». La musique est aussi son territoire et sa passion. Un amour de mille-ans, son premier roman, baignait dans la musique de Mozart. Âme brisée nous fait découvrir cette fois l’enchantement et les miracles nés de l’aventure d’un violon à la sonorité sublimée par la musique de Schubert et de Bach. Prix des libraires 2020.
Dimanche 6 novembre 1938, Tokyo, un petit ensemble de musique de chambre répète dans un centre culturel d’un quartier de la capitale japonaise. Yu, un professeur d’anglais, a réuni là trois de ses étudiants, musiciens comme lui : Kang, un violoniste, Yanfen, une altiste, et Cheng, un violoncelliste, tous les trois Chinois. Yu, lui, est Japonais. Blotti dans un coin de la salle, Rei, « politesse » en japonais, jeune fils de Yu, est plongé dans la lecture d’un livre, tout en ne perdant pas une miette de la répétition.
En 1938, on est en pleine guerre entre Japon et Chine. Ce groupe de quatre musiciens, « fraîchement constitué, fondé sur le seul principe du plaisir musical partagé » comme un îlot de paix au milieu des vagues de violence armée entre les deux pays, répète le quatuor à cordes n°13 en la mineur de Schubert.
Ce 6 novembre précisément, un commando de cinq soldats japonais débarque dans le centre culturel, mené par un caporal brutal qui soupçonne et questionne sans ménagement le doux et pacifique Yu. Que fait là ce traître qui pactise avec des « Chinetoques » ? Très vite le chef japonais de l’escouade militaire le malmène, le jette au sol, le frappe au visage et d’un violent coup de talon fait éclater la frêle structure de son violon, « la table d’harmonie fendue, l’âme brisée en deux », puis il s’apprête à embarquer tout ce petit monde de musiciens apeurés et sans défense. Rei, caché dans un placard, échappe à la rafle et ne reverra plus jamais son père. Le pauvre garçon, déjà orphelin de mère, se voyait ainsi brutalement privé d’un père enlevé par la soldatesque nippone.
Un officier japonais, plus mélomane que militaire, le lieutenant Kurokami, « Dieu noir » en japonais, demandera à Yu, avant qu’il ne soit embarqué par le barbare sous-officier, de lui jouer une quelconque pièce pour violon – ce sera la Gavotte de la Partita n°3 de Bach – jouée avec toute la grâce naturelle d’un musicien surpris autant qu’enchanté d’une demande surgie comme un bref instant de paix dans l’effroi et la violence guerrière :
Trois minutes pendant lesquelles les notes de musique s’égrenaient comme une enfilade de gouttes d’eau argentées sur une feuille de bambou. Lorsque l’archet se détacha des cordes, la dernière note fut suivie d’un long silence après une forte averse.
Après l’arrestation et le départ des musiciens, le lieutenant, resté seul avec l’enfant tremblant, d’un geste doux lui tendra le violon détruit, « presque aplati, corps souffrant avec les quatre cordes distendues, qui avait dans l’obscurité l’allure d’un petit animal souffrant. »
Philippe Maillard, un journaliste français spécialiste de musique classique et ami de Yu, recueillera l’enfant chez lui et l’adoptera. Une longue histoire commencera alors, celle de la vie de Rei devenu Jacques – référence au grand violoniste Jacques Thibaud -, grandi en France entre mère et père adoptifs.

Jacques gardera comme la plus précieuse des reliques le violon détruit, un Vuillaume de 1857. C’est décidé, il deviendra luthier. Formé à Mirecourt d’abord, où il rencontrera sa compagne – une archetière, couple parfait ! -, il se perfectionnera à Crémone ensuite, et de ces temps d’apprentissage, il n’aura de cesse d’œuvrer à la restauration et la résurrection de l’instrument saccagé, « labeur de forçat et patience de bonze », pour lui rendre son « âme » autant que celle de son père disparu. Un violon sauvé deux fois, par ce « Dieu noir » et bienfaisant de novembre 1938, par Rei, ou Jacques, fils résilient de Yu.
Le massacre d’un violon n’est pas autre chose qu’un assassinat, pense-t-il : « Un homme est capable de tuer un autre homme… Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il soit aussi capable de démolir un violon. » Jacques se souvient du moment où, un jour, il écoutait un disque de Menuhin « interprétant les Sonates et Partitas pour violon seul de Bach. Et quand le moment de la Gavotte est arrivé, il s’est passé en moi quelque chose d’étrange : j’ai cru entendre à travers le phrasé sculpté de Menuhin le violon de mon père. » La musique abolit miraculeusement les années, le violon chante Bach « et fait fondre toute l’épaisseur du temps » écrit superbement Akira Mizubayashi. C’est la vertu singulière de la musique et de l’instrument qui la fait s’élever, en son « âme » et sa toute puissance.
Le croisement de ces vies continuera après la guerre, tout aussi miraculeusement, comme le fil d’une histoire polyphonique ou d’une mélodie traversée de variations : Kurokami, inoubliable « Dieu noir », orphelin lui aussi de sa famille disparue dans le feu luciférien d’Hiroshima, viendra en Europe avant de mourir, pour y visiter les grands lieux de la musique et de la lutherie, Crémone et Mirecourt. C’est Midori Yamazaki, violoniste concertiste elle-même, petite fille de ce lieutenant bien peu martial, qui le racontera à Rei venu au Japon pour la rencontrer après une inattendue invitation par message électronique. L’échange sera fusionnel. Rei abandonnera son violon pour le laisser définitivement au creux de l’épaule de la jeune fille bouleversée par le geste : le violon et l’« âme » retrouvée de Yu ne chanteront plus désormais que sous les doigts et l’archet de la jeune musicienne. Lin Yanfen, enfin, l’altiste du quatuor de 1938, par la magie d’internet, retrouvera Rei et lui donnera « deux objets témoins du passé assassiné » : ce petit cardigan rose de sa défunte maman que le doux et protecteur Yu lui avait mis sur les épaules pendant la répétition, et puis le petit livre qu’il lisait avec avidité dans un coin de la salle de musique ce jour-là, Le Bateau-usine de Takiji Kobayashi, témoignage des misérables conditions de vie des pêcheurs de crabes.
Âme brisée, roman du souvenir, bouleversant d’amour et de tendresse, dévoile toutes les obsessions et convictions d’Akira Mizubayashi : sa hantise du « cancer nationaliste », de « l’expansionnisme colonial », des armements et des guerres, son amour des mots porteurs d’une pensée libre à l’opposé de « la possibilité de la domination des uns sur les autres »…Et puis faire naître ou renaître un violon, en restituer l’âme et le son, est pour Rei le plus beau geste qui soit, celui qui apaise « la douleur traumatique issue de la destruction foudroyante de tout ce qui vous attache le plus intensément au monde et à la vie. » Le temps est alors aboli, il se « défossilise et recommence à trembler », dit magnifiquement Akira Mizubayashi.
« Sayonara, soshite mooichido, arigatoo… au revoir et merci », écrira Lin Yanfen à Rei dans une dernière lettre, peu avant que la vieille femme ne meure dans un hôpital de Tokyo. En refermant ce livre, le lecteur émerveillé pourrait bien adresser les mêmes mots à Akira Mizubayashi.
Âme brisée d’Akira Mizubayashi, Gallimard, collection Blanche, 29 août 2019, 237 pages, ISBN 978-2-07-284048-7, prix : 19 euros.
Lire un extrait ici.