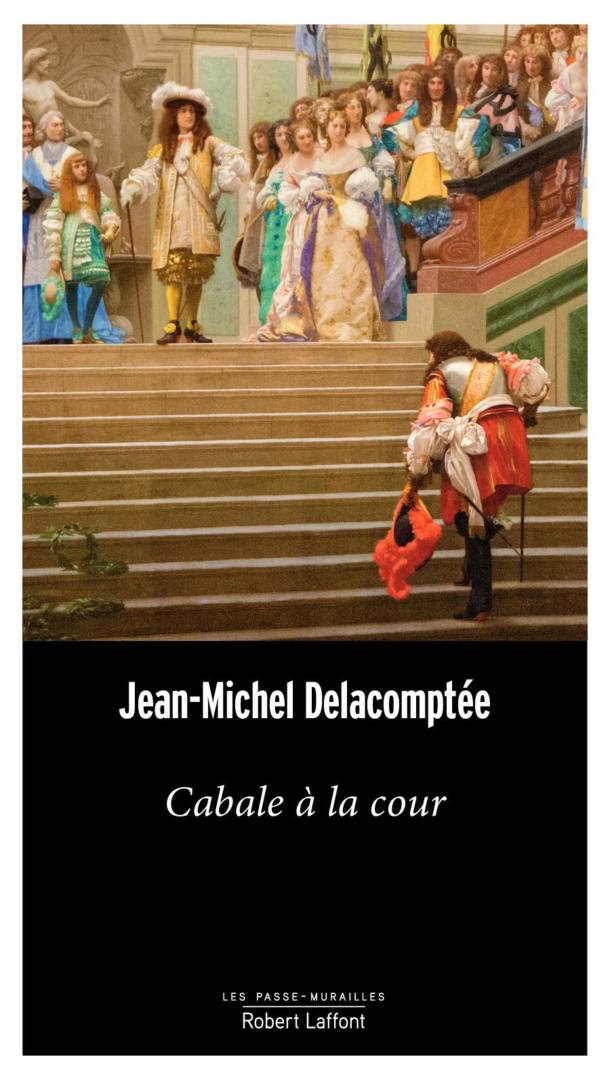Jean-Michel Delacomptée est historien de notre littérature : Montaigne, La Boétie, Saint-Simon, Racine, Bossuet, La Bruyère, Madame de la Fayette ont été ses objets d’investigation en autant de lumineuses études ou biographies. Cette fois, l’historien, pénétré de la connaissance intime des Mémoires de celui qu’on appelait le petit duc, Louis de Rouvroy, autrement dit Saint-Simon, nous plonge dans la cour de Versailles, théâtre agité de toutes les rumeurs, jalousies et coteries entre ses acteurs poudrés et emperruqués, et nous offre un récit dialogué et imaginé entre le fameux mémorialiste et son ami, Philippe d’Orléans, neveu du Roi-Soleil. Cabale à la cour est un texte enlevé et vivant, qu’on croirait sorti de la plume de Saint-Simon lui-même.
Jean-Michel Delacomptée plante admirablement le cadre et les pages qui ouvrent la théâtrale représentation de la Cour nous offrent le spectacle de personnages « héliotropes », mus par leurs seuls mouvements d’attraction et de virevolte autour de l’astre royal. Nous sommes le 1er janvier 1710 : « Le rituel quotidien se déroulera à huit heures précises, quand Louis Bontemps, le premier valet de chambre, ouvrira les rideaux en velours cramoisi du lit à baldaquin qui dissimulent le roi en chemise et bonnet de nuit. Alors il dira : « Sire, voilà l’heure » et le théâtre commencera. » Le rideau se lèvera alors sur la comédie humaine de Versailles. Les courtisans en seront les acteurs, sans cesse aux aguets des moindres regards, faits et gestes du Prince, toutes et tous personnages d’un théâtre baroque et d’un ballet de cour : « Multitude fardée de craie et tamponnée de poudre, avec chez les coquettes des mouches sur les joues blanches. […]Spectacle polychrome : c’est un monde fait pour les yeux. »
Un autre fervent lecteur du petit duc, José Cabanis, dans son inspiré Saint-Simon l’admirable, nous désigne à Versailles une « société compliquée et refermée sur soi, où on ne pouvait faire un geste qui ne fût réglé, dire un mot sans tourner la tête pour voir si on n’était pas écouté, et où on passait ses journées à grimper des marches pour faire une visite ou rendre un hommage de pure convention, on y tenait tant qu’en être éloigné, si peu que ce fût, c’était l’exil. »
Vivre à la cour était un perpétuel entre soi, fait de méfiance et de défiance, un jeu de manèges et de privilèges, de regards et d’égards, de déférence et d’irrévérence, vivre au Palais, c’était se parer et se comparer, s’observer et s’épier. Voilà bien ce que fut la matière et l’objet de ces infinis Mémoires, riche de dix mille feuillets d’une graphie serrée et sans ratures, rédigés par un duc qui enferma ses chroniques dans un coffre qu’on découvrit après sa mort, « comme un tombeau qu’on ouvre », pour en exhumer un corps fait de onze portefeuilles de veau écaillé enfermant plusieurs milliers de singulières et fulgurantes pages écrites « à la diable pour l’éternité » disait Chateaubriand, marquées de « cette plume en pointe et cette encre noire » ajoutait Cocteau.

Les rumeurs, intrigues et cabales hantent le palais, les murs ont des oreilles et les bruits arrivent à celles du brillant et cruel chroniqueur de la cour. Il y a urgence quand Saint-Simon apprend qu’une cabale est montée contre son ami d’enfance, Philippe d’Orléans, en grand danger de se voir pris dans l’étau d’un procès pour haute trahison politique et familiale : Louis XIV le soupçonnerait de vouloir renverser l’actuel roi d’Espagne, Philippe V, petit-fils du souverain. L’autre Philippe, d’Orléans, le Régent, n’y croit pas : « Détrôner Philippe V pour usurper sa couronne ! Mon oncle ne peut me charger de ce crime abominable. »
Comme pour alourdir la charge du procès qui se profile, le roi ne supporte pas que son neveu délaisse ouvertement l’épouse – « insupportable » – qu’il lui a choisie, la future duchesse d’Orléans, née Françoise-Marie de Bourbon, fruit des amours de la marquise de Montespan avec le souverain : « Elle s’en montre humiliée, le roi est son père, il l’aime. En vous affichant de façon ostentatoire avec Mme d’Argenton, vous le blessez durement » lui assène le petit duc. Mme d’Argenton est la maîtresse adorée, adulée, de son amant Philippe qui nourrirait avec elle, dit-on dans l’entourage du souverain, un commun dessein conjugal et royal… outre-Pyrénées.

« Mme d’Argenton illumine ma vie. La Cour n’apprécie pas ce genre de bonheur. Elle exige que l’on se contraigne à des apparences. » Mme d’Argenton est une femme que déteste tout spécialement Mme de Maintenon, épouse morganatique du roi, femme de principes et de rigueur, sombre et austère figure dans sa mise et dans ses mœurs, que Philippe un jour eut l’audace de moquer d’un bon mot colporté jusqu’aux oreilles du couple royal par une cour avide, empressée et malveillante.
Comment sortir Philippe de ce très mauvais pas ? Abandonnez votre maîtresse, intime alors Saint-Simon à son très cher ami d’enfance, retrouvez ainsi un peu des faveurs royales et vous verrez s’éloigner ce méchant procès qui vous perdrait et vous exilerait loin de Versailles. « En quittant Mme d’Argenton, vous mettez fin aux bruits qui vous accusent de vouloir l’épouser. L’affaire d’Espagne tombe du même coup emportant le procès. Place nette. » Saint-Simon, fin politique, habile diplomate, diabolique intercesseur, aurait eu un bel avenir dans n’importe quelle ambassade de son souverain s’il n’avait eu les ailes coupées par quelques courtisans influents et jaloux : « Mon esprit et mon instruction indisposent. »

Les deux amis pourraient bien avoir ainsi d’identiques ennemis et griefs. Mais qui sont ces deux-là, si dissemblables et qui s’entendent si bien ? L’un est impie, à lire Rabelais pendant les offices de Noël, trousse et festoie à tout va, l’autre est mari fidèle et mène une vie sans écarts, loin des chemins perdus et contre-allées du libertinage. Et puis « Saint-Simon et Philippe d’Orléans ont passé leur enfance dans l’espace du Palais Royal, des souvenirs communs les rapprochent, nous dit Jean-Michel Delacomptée, ils sont aussi brillants, aussi cultivés l’un que l’autre. Sans doute Saint-Simon se sent-il flatté de l’amitié que lui réserve le neveu du roi. »
Philippe, d’abord violemment opposé à toute forme de repentir, finira par écouter le duc, toujours maître d’une subtile rhétorique et brandissant la menace ultime : « Une fois condamné vous serez exilé dans les profondeurs les plus sauvages du royaume. Plus personne n’aura soin de vous. Plus personne ne vous visitera. Vous remâcherez vos remords dans une solitude plus obscure que celle des moines impatients d’expier leurs péchés par l’exercice d’une piété implacable. »

Mieux, ou pire, Saint-Simon recommandera à Philippe de jouer devant Mme de Maintenon, « vieille ripopée » dans l’orbe des Jésuites, la comédie de l’humilité jusqu’à l’humiliation. « Émotions, sentiments doivent rester tapis au fond de soi, […] être double, triple, une enveloppe à ne jamais décacheter », c’est la règle du courtisan. Saint-Simon s’y voyait contraint, lui aussi, et se masquait, cachant sa détestation pour un souverain si peu attaché à l’étiquette, qui dotait et anoblissait bâtards et courtisans de douteuse naissance et moralité. « Cette femme et le roi aiment les pénitents qui viennent à eux la corde au cou. Avec eux, inutile de mener une vie décente. Il y a plein de gens irréprochables qui n’ont jamais rien pu obtenir d’eux, et de gens méprisables dont le faux repentir a flatté leur amour-propre et qu’ils ont récompensés par des fortunes éclatantes. […] Au point où vous en êtes, ne vous gênez pas pour imiter ces faux pénitents. Chargez la barque à ras bord. » Et puis, règle d’or de tout éhonté flatteur, « l’hypocrisie est un vice privilégié, qui jouit en repos d’une impunité souveraine », c’est Molière qui le dit, par la bouche de Dom Juan.
Cabale à la cour est un récit dialogué, par choix délibéré de Jean-Michel Delacomptée qui aime la rigueur, la tension et la force du théâtre classique, toutes qualités retrouvées dans ce texte. Dans cet échange entre Saint-Simon et Philippe d’Orléans, empreint de la vivacité, des nuances et des subtilités des Mémoires, enrichi de brefs intermèdes éclairant judicieusement le cours de l’action et des situations, apparaît à l’acte final l’incontournable souverain, maître du jeu sur l’échiquier de la cour, qui n’aurait peut-être fait que déplacer discrètement et habilement les pions et manipuler astucieusement les têtes, celle de Saint-Simon en particulier. C’est ce que finit par se demander le petit duc pour conclure cet original et beau moment théâtral à deux voix. Avec une seule envie chez le lecteur, ou futur spectateur, une fois le rideau refermé : se (re)plonger dans la prose unique de Saint-Simon en attendant que ce huis-clos tendu et magnifiquement construit soit un jour prochain monté sur la scène d’un vrai théâtre.