Le sous-titre de Il n’y a pas de Ajar de Delphine Horvilleur, publié aux éditions Grasset, ne laisse de place au doute : un monologue contre l’identité. La parole est donnée à Abraham Ajar, fils d’Emile, rejeton d’une entourloupe littéraire orchestrée avec brio par l’écrivain aux multiples pseudonymes, Romain Gary. La Bible, l’humour juif ou, encore, les obsessions identitaires du moment sont au menu de ce seul-en-scène.
Dire Ajar, c’est penser Gary (Romain), et dire Gary c’est penser Kacew (Roman). Et nous voilà dans la valse des identités propulsée par cet écrivain né à Vilnius en Lituanie dans l’empire russe, fils d’une comédienne et, peut-être, du plus grand artiste russe du muet, Ivan Mosjoukine. Du moins se plaisait-il à le dire, ce qui lui permettait de se définir comme un Juif-Tartare.
Romain Gary, sa vie durant, a jonglé avec les identités ─ Roman Kacew, Romain Gary, Émile Ajar, Fosco Sinibaldi, Shatat Bogat, François Mermont et Lucien Brûlard, pas moins de sept étiquettes ─ en les chargeant, parfois, de sens : ainsi Gary signifie en russe « Brûle » à l’impératif, comme l’autre pseudonyme de Brûlard (qui renvoie, sans doute, au propre pseudonyme de Henri Beyle, alias Stendhal, alias Henry Brulard), et Ajar signifie « Braise » en russe ─ c’était le nom d’actrice de Mina Owczyńska, sa mère ─ tant il joua, sans doute, sa vie durant avec le feu, jusqu’à faire feu contre lui-même et disparaître. (Romain Gary, dans sa soixante-sixième année, se suicida le 2 décembre 1980 en se tirant une balle dans la bouche.)
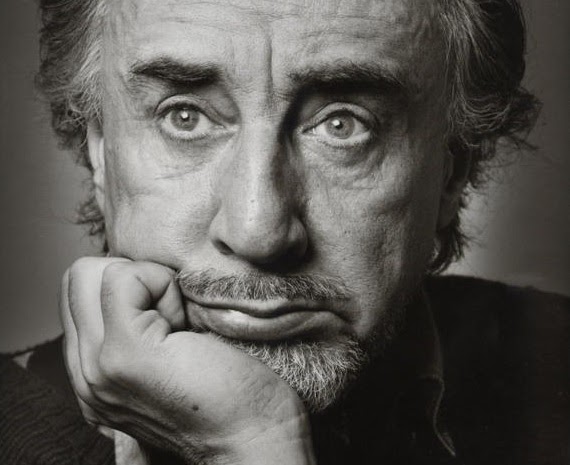
Son avant-dernier livre s’intitule justement Pseudo (Mercure de France, 1976) et raconte les avatars d’un « neveu » prête-nom avec son Tonton Macoute. Voilà les cartes qui ont fasciné Delphine Horvilleur et la conduisent à publier cet énigmatique « monologue contre l’identité » qu’elle intitule Il n’y a pas de Ajar.
Celle qui s’y entend pour Vivre avec nos morts (Grasset, 2021) s’empare de la personne de Romain Gary affublé de son masque de Ajar pour se livrer à une piquante et ludique variation sur le thème fuyant et évasif de l’identité. Qui êtes-vous ? La seule réponse satisfaisante est la ruse inventée par Ulysse pour échapper au Cyclope : « Personne » (Outis). Gary, lui, parlait de « certificat de non-existence », ce que reprend ici l’auteure.
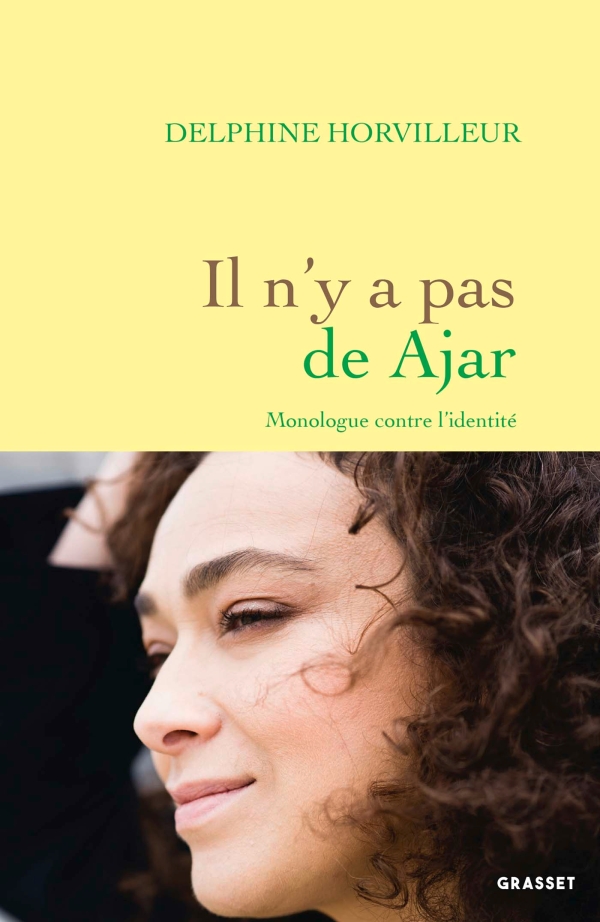
Une substantielle préface joue du thème du dibbouk, vieux mythe yiddish de l’être qui hante une personne, parle et agit en elle. Ce thème de la « possession » avait inspiré une pièce de théâtre de Shalom Anski, créée précisément à Vilnius, en 1917, trois ans après la naissance de Romain Gary ; et ce dernier avait saisi cette balle au bond pour brosser, dans le délire et la rage, un nazi d’après-guerre possédé du dibbouk du Juif qu’il a assassiné : il est des remords qui torturent et qui tuent (La danse de Gengis Cohn, 1967).
Et Delphine Horvilleur, à son tour, s’empare de ce mythe et prétend être habitée du dibbouk de Gary, dont elle nous donne sa propre interprétation : Gary, nom inventé (à partir du russe) par Roman signifie pour elle, férue d’hébreu, « l’étranger en moi », ce qui correspond, certes, à la racine hébraïque ger / gar = étranger. Ainsi dans la Bible, le fils aîné de Moïse, conçu en terre étrangère au pays de Madian, est-il appelé Gershom à partir de l’hébreu « ger sham », « étranger en ces lieux ».
De même, en tirant un peu sur l’écheveau, Ajar, selon elle, viendrait de l’hébreu Ah’er / Ah’ar = Autre. La préface de l’autrice est, de ce fait, une leçon talmudique, avec référence biblique, et l’on peut dire, en nous amusant avec celle qui est toujours pince-sans-rire, que madame le rabbin, dans ce domaine, a des références.

Mais le morceau de bravoure qui lui vaut, sans conteste, les rires du public, est le monologue qui suit, et qui est véritablement théâtral. Il a été créé, avec succès, le 19 septembre 2022 au théâtre Les Plateaux Sauvages, mise en scène par Johanna Nizard et Arnaud Aldigé, avec Johanna Nizard, et une tournée dans toute la France (et peut-être, un jour, à Vilnius, son port d’attache). L’interlocuteur supposé n’est autre que Bernard Pivot, dont on reproduit la présentation, le 3 juillet 1981, sur le plateau d’« Apostrophes », du véritable Émile Ajar, qui est proprement le « neveu » de Romain Gary et son pseudo. Le personnage, seul en scène, se présente à lui et à nous : Abraham Ajar, autrement dit A.A., deux fois A, soit l’origine de tout ─ pas assez incarné et charnu pour être « l’origine du monde ». Or Abraham, dans la Bible, nous dit-il, est fils de Terakh, que la tradition occidentale a orthographié Tharé, et voilà le premier envol comique :
« Le fait de savoir que tous les fils d’Abraham sont des petits-fils de taré, ça permet de mieux comprendre l’Histoire : ses millénaires de fraternité humaine, et tout cet amour dont on a fait des guerres et des génocides, c’est d’abord un problème congénital ».
Et nous avons là l’immanquable impression que Romain Gary a écrit ces lignes et qu’on entend sa voix, c’est son style, celui de La Danse de Gengis Cohn, avec son sens aigu de la dérision, son pessimisme radical et un désabusement tous azimuts. Mais qu’en est-il, vraiment, de l’identité ? Cet Abraham Ajar est fils d’un père qui n’est que le fils fictionnel de Romain Gary qui a laissé le mystère planer jusqu’à sa mort, six ans après la naissance d’Émile Ajar, incarné fictivement dans la personne du fils de sa cousine germaine Dinah, Paul Pavlowitch.
(Ici une parenthèse, pour bien montrer la force de la fiction et jusqu’où peut aller ce vecteur de l’absurde : Paul Pavlowitch, en endossant l’habit de paternité des quatre romans de Gary publiés sous le pseudo d’Émile Ajar aux éditions du Mercure de France, fut par Simone Gallimard, la patronne, engagé comme directeur littéraire. Et il se trouve quelqu’un dont le manuscrit fut refusé par le comité de rédaction de ces éditions : et voilà, Émile Ajar ─ un être de fiction, ne l’oublions pas ─ était au regret de ne pouvoir publier son texte, et la signature « Ajar » était bel et bien au bas de la lettre. Une pièce à verser au dossier du procès identitaire intenté par Delphine Horvilleur dans ce livre.)
Mais qui peut s’étonner des coïncidences ? Nous sommes soumis à la magie du théâtre et au talent de la dramaturge qui, ouvrant grand les yeux sur ce monde actuel qui présente toutes les vertus de la détestation, met les pieds dans le plat. L’antisémitisme est forcément dans son collimateur, elle qui a publié précédemment ses Réflexions sur la question antisémite (2019) et qui revient sur le roman La Vie devant soi, du fait que cet Émile Ajar est supposé vivre dans la cave de l’immeuble, le « trou juif », de la vieille rescapée de la Shoah, ayant remplacé le personnage de Momo :
« Bon, tu te souviens de l’histoire ? Ça raconte une amitié improbable entre un petit Arabe de Belleville, Momo, et une vieille juive. À l’époque, c’était presque réaliste. Aujourd’hui, plus personne ne goberait cette histoire. Ces dernières années à Belleville, on trouve encore beaucoup de vieilles juives mais elles ne seraient pas nombreuses à prendre le risque d’accueillir le gamin arabe de l’immeuble. Elles se méfieraient sans doute de Momo, au cas où il aurait l’idée soudaine de les défénestrer, un jour d’abolition de son discernement. »
Bien sûr, l’actualité fait irruption avec le tragique destin de Sarah Halimi défénestrée par son voisin qui aurait eu, selon l’expression d’alors, une « bouffée délirante ». Mais la cible véritable est celle de l’identité forcenée à laquelle se livrent nos contemporains, test ADN à la clé. Delphine prend alors la voix de Romain ─ ou d’Émile ─ pour souligner « cette idée morbide qu’il y aurait une possibilité d’être vraiment soi ». Et elle enfonce le clou : « Merde à l’identité. Merde à tout ce qui te fait croire que tu n’es rien d’autre que ce que tu es ». Et elle prend plaisir à faire défiler les nombreux visages de l’humain dans la société d’aujourd’hui :
« Avant, on rencontrait des gens qui étaient plein de choses à la fois : pied-noir, fils d’immigrés et homosexuel, communiste et gymnaste…, ou alors juif-athée-joueur d’échecs et goyophile ; eh ben là, c’est fini. Chacun n’est plus qu’un seul truc, catho, gay, vegan, qu’importe, mais exclusivement l’un ou l’autre […], tu ne joues plus que dans une seule catégorie et tu es donc sans rapport avec qui que ce soit d’autre. Bien sûr, ça oblige à un certain niveau d’entre-soi pour préserver la pureté de l’édifice. »
À partir de là, adoptant une fois de plus le masque de ce Roman qui traversa tant de pays et changea tant de fois de noms et parlait aussi tant de langues, l’auteure fait l’éloge du métissage :
« Je suis pour polluer toutes les ‘’identités’’. Pour que puisse à nouveau circuler la conscience claire de tout ce que l’existence doit au mélange. »
Reste la « transidentité », en somme un cocktail de ses divers sois. Peut-on rappeler à ce sujet, à madame le rabbin qu’en hébreu le mot visage se dit et n’existe qu’au pluriel : panim ? On n’est jamais seul avec soi, on est toujours plusieurs. Le fameux caméléon dont a parlé Romain Gary, qui est lui et qui est autre selon la couleur du contexte, Woody Allen en a fait le personnage de son film Zelig, qui change de peau au fil des rencontres, the Chameleon Man. Alors cet Abraham Ajar est un autre zeligman (« le bienheureux », en allemand) : « Je crois qu’au fond, aucun de nous n’est uniquement ce qu’on dit qu’il est. Qu’est-ce qui t’empêche, toi, par exemple, d’engager une transition de genre, de sexe, de couleur ou de religion ? On est tous en chemin vers ce qu’on peut encore être, et cela implique forcément de quitter ce qu’on était. »
Voilà pour l’essentiel de ce monologue qui fait du délire son moteur et son atmosphère. En définitive, et au terme d’une heure quinze (durée de la pièce… et de la lecture), Delphine Horvilleur, elle qui a tant de titres, nous démontre qu’elle est aussi dramaturge et que, dans la lignée d’Ionesco ou de Beckett, dans la drôlerie et dans la profondeur, elle nous sert là un magnifique acte de théâtre de l’absurde, qui est, peut-être, la seule façon de démontrer la vérité.
