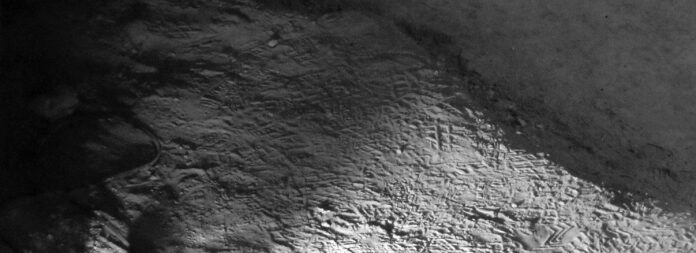La Marche brisée est une série work in progress créée à quatre mains par Anna-Maria Le Bris et Francesco Ditaranto. Elle fait partie des deux projets retenus par Unidivers au titre de l’Appel à projets artistiques 2015.
Cher Professeur,
Je viens de passer la journée entière avec Pascal. Nous avions rendez-vous dans mon bureau pour la séance de thérapie par la parole. Comme d’habitude désormais, mon adjoint est entré pour nous interrompre. Il a prétendu devoir me rappeler l’arrivée des inspecteurs du Ministère de la Santé, demain, pour nous interroger sur le suicide de ma patiente. Pascal s’est refermé.
Je n’allais pas laisser Mr Neuille gagner à ses manigances ; j’ai invité mon patient au restaurant. Il a refusé : nous étions mardi et il fallait qu’il mange sa soupe aux cardons, chez lui. Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes. Naïvement, j’ai attendu qu’il m’invite à sa table ; sans résultat. J’ai insisté en suggérant de le rejoindre après son repas, mais il a encore repoussé le rendez-vous : il devait faire sa sieste. De manière inattendue, il a fini par me proposer de le raccompagner.
Son appartement était décidément propre, au moins le séjour, la seule pièce où nous sommes restés durant ma visite. L’air sentait les clémentines. Il y en avait un plein panier sur la table. Son logement était équipé d’un balcon. Il m’a poussé à sortir avec lui, afin de me montrer son nouveau hamac, qu’il avait installé le matin même. «Il est beau, hein ? Après je vous le dis, il est confortable aussi. Après je vous le dis, il est confortable aussi. Après je vous le dis, il est confortable aussi. » Il a répété sa phrase trois fois, méthodiquement.
Je ne sais pas s’il était content de ma présence, mais il semblait tranquille. J’en ai profité. D’emblée, je lui demandé s’il se rappelait la première fois où il avait été interné.
Je vous rapporte ses propos :
« Oui, je me rappelle très bien. Ma mère venait de mourir, mais personne ne m’avait prévenu. Même pas ma tante, avec qui je vivais depuis mon enfance. Cela faisait assez longtemps que je n’avais pas rendu visite à ma mère, un mois environ. J’ai appris son décès trois jours après l’enterrement. Un mec que je connaissais, qui ne passait au village qu’une fois par semaine, m’avait présenté ses condoléances. Alors, je suis rentré chez ma tante, et je lui ai crié dessus. Elle n’a pas répondu, elle pleurait et demandait au bon Dieu pourquoi elle était si malheureuse. »
Il n’arrêtait pas de peler les clémentines et de réduire les écorces en petits morceaux, tous identiques. Après, chaque fois, il reniflait ses doigts.
« Au bout d’un moment, elle s’est mise à hurler que je voulais la tuer, en demandant de l’aide. Je vous jure, docteur, moi j’étais fou de rage, mais je ne l’ai jamais touchée, à aucun instant. Elle a appelé le curé. Quand il est arrivé chez nous, je me suis enfui. Vous avez compris, docteur ? Jamais touchée, jamais. Jamais. »
Je lui ai répondu que je comprenais, que je le croyais. J’espérais qu’il poursuive son récit.
« Alors je suis parti au cimetière et j’ai gueulé contre le gardien, pour savoir où était ma mère, mais il m’a dit qu’elle n’était pas là. J’ai cherché sa tombe mais je ne l’ai pas trouvée. J’ai même fouillé une partie de terre qui semblait avoir été retournée récemment. Après un certain temps, j’ai décidé de rentrer chez moi pour parler avec le prêtre. J’étais convaincu qu’il savait forcément où elle avait était enterrée. ».
Pascal était de plus en plus nerveux, il n’arrivait pas à contrôler ses mains.
« Quand je suis arrivé, a-t-il continué, le curé était encore là. Il n’a pas voulu me répondre. Il disait qu’il fallait prier et remercier ma tante. J’ai commencé à crier et le menacer. Il a appelé la gendarmerie. Je me suis encore enfui, mais une demi-heure après deux gendarmes m’ont bloqué dans la rue. J’ai essayé de m’échapper, en donnant un coup de poing à l’un d’eux. Je n’ai pas réussi, par contre eux m’ont cassé la gueule. Ils m’ont ramené dans leur bureau puis tout de suite à l’asile. Là, les infirmiers m’ont tabassé à nouveau parce que je ne restais pas tranquille. Ils m’ont lié au lit et ils m’ont seringué. Quand je me suis réveillé, je ne sais pas combien de temps après, je me sentais très faible. J’ai mis beaucoup de temps à me rappeler ce qui s’était passé. La mort de ma mère, les disputes, l’arrestation et les médicaments m’avaient détruit. J’étais très faible et triste. Au cours des jours suivants, ma condition ne s’est pas améliorée. Je ne bougeais pas de mon lit, même quand je n’étais pas lié. Une fois, je me rappelle bien, deux docteurs discutaient pas loin de moi et j’ai seulement entendu : « Comme ses parents, d’ailleurs »… Quelques jours après, les thérapies ont commencé. Mais moi j’étais triste. Je n’étais pas fou, comme eux. »
Nous, psychiatres, ne pensons pas à la détresse de nos patients. Nous décidons qu’ils n’ont pas le droit d’être triste. Qu’ils n’ont aucun droit.
Je vous écris très prochainement,
Mes meilleurs sentiments,
Joseph Calvez