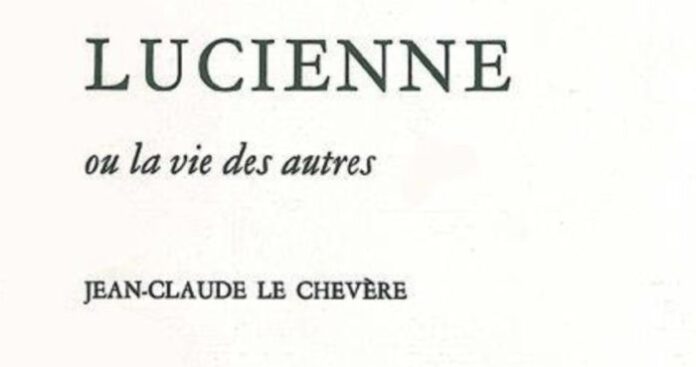Belle incursion de la prose dans le catalogue des éditions Folle Avoine, le romancier Jean-Claude Le Chevère a publié en 1988 son premier texte, « Lucienne », véritable découverte littéraire, magnifiquement écrit, qui allait être suivi de nombreux autres textes, publiés très fidèlement par Folle Avoine mais aussi par les éditions Apogée.
« Lucienne ou la vie des autres » est un récit de « vies minuscules » pour reprendre le titre du roman de Pierre Michon. Lucienne, femme résolue et courageuse, est l’aînée, de quelques années, de son mari Georges Moreau, homme doux et rêveur, tombé amoureux de celle qui deviendra sa femme, un jour qu’elle travaillait aux champs à ses côtés, et qu’elle avait tombé la jupe, sous la chaleur de l’été, laissant apparaître un short sur des jambes magnifiques !
Lucienne, à peine passé le cap de soixante ans, n’en peut mais, épuisée par le labeur de toute une vie de ménages et d’employée de maison, au service des autres, de « la vie des autres ». Sur consigne stricte de son médecin, la malheureuse est condamnée au repos, clouée dans sa maison, puis dans son lit. Se succèdent alors les visites, inquiètes, de ses voisines, les unes ses employeurs, les autres ses amies.
Et ces visites font défiler le film de sa vie. Une vie de domestique qui la conduira à Paris, tout d’abord, chez un couple qui cherchait une « jeune bonne pour le ménage, logée, nourrie » avait-elle lu dans les annonces de « Ouest-Eclair ». C’est alors la découverte de la capitale et de ces couples qui l’emploient, à qui l’argent ne fait pas défaut, la découverte aussi de leurs manières de vivre qui ne laissent pas de la surprendre, de la révolter surtout, par leur futilité, leur hypocrisie, leur avarice, leur complaisance morale et leur mépris de classe. Heureusement, la solidarité et l’amitié entre copines de travail la sauveront de ces épreuves parisiennes.
Autant de travers et défauts sociaux et moraux qu’elle retrouvera, une fois revenue dans son petit village de Sourville, et qui alimenteront une amertume grandissante au fil des ans. « Les sentiments, c’est pour les gens distingués qui ont de l’éducation. Nous, ils doivent se dire que nous vivons presque comme des bêtes. Il n’y a que dans les films que les pauvres ont du sentiment. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la télévision mais les pauvres pleurent mieux que les autres, surtout quand ils sont vieux, ça suit toutes les rigoles sur leur tête fripée comme une pomme flétrie ».
Changer de docteur ? dira-t-elle un jour à Madame Lefort, élégante et hautaine bourgeoise de Sourville qui lui recommande son propre médecin, le Dr Haillant : « Il me dirait que je me porte mieux que lui et il m’embaucherait pour éplucher ses patates ».
Son amertume va aussi vers son propre et unique fils, le faible Marcel, sous la coupe d’une épouse cupide, méprisante et humiliante bru, âpre au gain de l’héritage. Marcel « devenu un petit bourgeois. […] Tes parents sont restés des moins que rien […]. On n’est pas assez bien pour toi » ressasse-t-elle dans sa tête.
Le malheureux Georges sera encore un peu plus désemparé quand Lucienne sombrera dans un mutisme définitif, lui qui aura vécu abreuvé quotidiennement des mots inépuisables de sa femme qui parlait pour deux et « commentait tout ».
La mort qui approche rendra Lucienne tristement consciente de l’amour qu’elle aurait dû mieux donner à son mari : « Je jacassais toujours et lui, discret, attendais que j’aie fini. J’aurais dû me taire cent fois pour entendre un mot de lui mais c’est un humble et il ne lui viendrait jamais à l’idée de taper du poing sur la table pour se faire une place dans le brouhaha ».
Le temps du deuil et au-delà, « Georges aura toute sa vie pour se souvenir de Lucienne, pour être surpris de son absence derrière la porte de la cuisine ou dans le jardin. Au fond personne ne supporte l’idée que tout ce qu’on fait, dit, pense s’arrêtera définitivement un jour. L’homme est trop orgueilleux pour admettre qu’il est limité dans le temps. Alors il a inventé l’âme ».
Toute notre vie, nous les pauvres, nous économisons pour plus tard, nous ne vivons pas et quand nous pensons pouvoir en profiter, nous sommes surpris par la mort. La vie se comporte avec nous comme une véritable saloperie ». On n’est pas loin du noir pessimisme d’un Céline qui écrivait dans le « Voyage au bout de la nuit » : « La plupart des gens ne meurent qu’au dernier moment, d’autres commencent et s’y prennent vingt ans d’avance et parfois davantage. Ce sont les malheureux de la terre ».
Après les obsèques, le pauvre Georges regardera repartir son fils, ce fils sans caractère accablé de son indélicate épouse. Il restera seul avec sa douleur, « souhaitant qu’on le laisse en paix s’abandonner à son chagrin, qu’il puisse en toute tranquillité sentir couler le long de ses joues ridées les larmes qui attendent depuis des jours, qui se pressent derrière ses paupières et qui, libérées, descendent maintenant lentement et viennent se perdre dans le col de sa chemise mal fermée ». Ce sont les derniers mots, bouleversants, de cet admirable récit.