Wang Chunyu, 45 ans, nous reçoit dans son lumineux appartement-atelier, envahi de plantes et de tableaux, tout en haut d’une tour, en plein ciel breton. Ses œuvres sont entassées partout et accrochées aux murs. Paysages intérieurs davantage que lieux réels. Portrait d’un artiste en perpétuel dépassement de soi, formé aux Beaux-Arts chinois et français.
Un chercheur de beauté
« Pour un Chinois, mon œuvre est contemporaine ; pour un Français, elle est classique », explique Wang Chunyu devant une toile que l’on hésite à qualifier soit d’abstraite, soit de figurative. Elle figure l’élan et la beauté du monde intérieur et extérieur, tout ensemble. Ainsi, selon le regard, le polyptyque reproduit ci-dessous représente aussi bien des sommets de montagne que de hautes vagues. Si l’on regarde davantage le vide, le blanc, ce fameux « vide médian » essentiel à l’esthétique classique chinoise, c’est la neige des montagnes qui apparaît. Si l’on se concentre sur le plein de l’encre, les noirs et les gris, c’est une masse d’eau tumultueuse qui surgit.

La nature dans sa force est toute présente, mais elle est célébrée pour le mouvement qui l’anime davantage que pour la beauté de tel ou tel paysage particulier. Et après tout, les montagnes ne sont-elles pas des vagues de terre qui avancent, juste beaucoup plus lentement que les vagues d’eau ? Et la beauté, dans la pensée chinoise, c’est surtout de s’émerveiller que le mouvement, la vie, le souffle, existent, plutôt que de n’être pas.

La peinture de Wang Chunyu est certes « chinoise » par l’art du pinceau, l’encre, le papier de riz, mais il ne pense pas qu’elle trouverait sa place dans les galeries de la Chine actuelle. Il précise que ce qui marche en Chine, auprès des milieux (fortunés) d’acheteurs d’art, en l’absence d’une classe moyenne amatrice d’art, c’est l’art conceptuel, politique, provocateur. Un artiste comme Ai Weiwei en est l’emblème dans le monde. Dans ce pays de paradoxes, auxquels s’ajoutent ceux de la spéculation du milieu de l’art, c’est l’art dissident, sévèrement opprimé, qui a la cote financière. Au contraire, le grand peintre Zao Wou-Ki (1920-2013), Chinois naturalisé Français en 1964, qui utilisait lui aussi la technique traditionnelle de manière semi-abstraite et contemplative a « toujours eu du mal à trouver des galeristes pour l’exposer en Chine ».
« C’est très intéressant et c’est très bien », l’art d’un Ai Weiwei et de ses semblables, sourit Wang Chunyu, mais c’est un art « avec une mission presque journalistique. C’est de la dénonciation politique ». Il n’en conteste pas le courage, au contraire, « mais ce n’est pas moi ». Il voit sa peinture « plutôt comme la littérature », ou surtout « la musique ». « Quand je dessine, je suis dans la joie. Eux, je pense qu’ils sont fâchés. Ça, ça ne me plaît pas trop », explique-t-il dans son français précis et sensible, appris sur le tas, durant ses seize années de travail en France.

L’œuvre la plus connue d’Ai Weiwei, rappelle-t-il, c’est une photo de majeur tendu sur la place Tian’anmen, geste reproduit aussi en France devant la Tour Eiffel – pas de jaloux. « C’est une simple violence pour moi », réagit-il. Wang Chunyu se veut, en ce sens « dans la tradition ». « Je veux que la vie soit belle », et partager cette beauté par l’art. Il s’inscrit, modestement, dans une continuité avec la grande peinture chinoise : celle de Zhu Da, Shitao, Zhang Daqian, les classiques anciens, et pour la peinture contemporaine, Zao Wou-Ki, qui le touche.

Comment Wang Chunyu en est-il venu à cette approche, contemplative, faite de tradition figurative et d’abstraction conceptuelle mêlées ? Sa peinture, sourit-il, est le fruit de la rencontre à la fois « sympathique et violente » de ses deux pays, Chine et France, ainsi que de son « réapprentissage de ce que c’est d’être humain » dans un nouveau pays. Son histoire et les extrêmes qu’il tient toujours liés, beauté et douleur, dans le souffle et l’énergie du geste pictural, en font l’unicité. Récit.
Une histoire dans l’Histoire
Wang Chunyu est né le 9 avril 1976 dans une province excentrée de la Chine, la plus septentrionale et la plus orientale, le Heilongjiang, dans l’ancienne Mandchourie. « Heilongjiang » c’est la « rivière du dragon noir » : le fleuve Amour, qui sépare la province de la Sibérie russe. Il grandit dans une famille modeste, dans le village (au sens chinois du terme, équivalent à six fois la population de Rennes) de Yi’an.

Ses parents ont su saisir leur chance, juste après les atrocités de la Révolution Culturelle (1966-1976). Son père fut « garde rouge » comme tous les adolescents de son âge, durant cette période terrible, et sa mère, l’équivalent féminin. Ils sont pris dans la folie et la propagande de l’époque, le père entreprenant le pèlerinage obligé des jeunes gens vers Beijing (Pékin), à pied, pour voir de ses yeux le Président Mao et la capitale. Plus de 2000 km, avec quelques tronçons en train, à la merci de la bonne volonté des concitoyens qui nourrissent ces adolescents – à la fois par hospitalité traditionnelle et par crainte de cette juvénile milice, érigée par le régime en tyrans et parfois bourreaux de leurs aînés. Cette même milice de jeunes « innocents et sauvages », tour à tour, selon les mots de Wang Chunyu, a ensuite été réprimée rudement par l’armée. À la fin de cette période chaotique, les futurs parents de Wang Chunyu retournent à l’école avec une conscience aiguë qu’apprendre, c’est se déprendre de cette « sauvagerie ».
Un père ancien Garde Rouge devenu peintre lettré
Savoir, savoir-faire, maîtrise et retour à la tradition : son père devient un peintre lettré, maniant l’encre et le pinceau – l’ancien garde rouge comme une rémanence de la Chine ancienne. Sa mère, elle, devient la « voix de la « radio » des Beaux-Arts de Yi’an ». Fonction essentielle et typiquement chinoise, où « chaque institution, depuis la Révolution Culturelle, possède une voix qui accompagne ses membres dans des haut-parleurs accrochés partout ; instrument de contrôle et d’encouragement », explique Wang Chunyu : « quelque chose d’évident et de quotidien ». « C’est tellement normal que quelqu’un parle dans l’air, quand on court sur un terrain ou quand on marche dans la rue. »
Wang Chunyu appartient alors à la seule famille lettrée de son quartier, modeste, mais avec ce qu’il fallait pour vivre. Il connaît sa chance d’échapper à une misère très répandue en ce temps. Cet homme sensible garde le souvenir, dans son enfance, d’un homme agonisant de faim plusieurs jours durant dans les champs, que personne n’a pu secourir, faute de nourriture.
Il sourit de notre question de savoir s’il a des frères et sœurs : fils unique bien entendu, pas le choix. En Chine, on utilise une expression fataliste et ironique, dit-il : « c’est simple et violent », pour qualifier les nécessités politiques.

Départ vers la France et Rennes…
Dans les pas de son père, il étudie aux Beaux-Arts : d’abord à Harbin, ensuite à Shenyang, puis à Beijing, toujours plus loin de chez lui. Il devient jeune professeur de peinture et artiste reconnu. L’État, reconnaissant, lui paie un appartement. Mais le rêve naît, fou pour un jeune homme de famille modeste, de partir étudier loin. Apprendre, progresser, devenir soi : il poursuit l’entreprise amorcée par l’ancien garde rouge devenu peintre lettré et la « voix » des Beaux-Arts. Un de ses amis est allé faire de l’informatique en Irlande : l’exemple lui ouvre la perspective de l’Occident, de l’aventure et de l’ailleurs.
Il rassemble des informations, vend son bien, l’appartement financé par l’État, pour tout reprendre en France. L’agence qu’il paie, c’est indispensable, pour organiser les formalités et trouver un lieu d’études, lui propose l’Université de Rennes, en Arts Plastiques. Il y restera un an et demi, avant de rejoindre l’école des Beaux-Arts (EESAB). Désir de France, pays des arts (« Tous les grands mouvements artistiques modernes de l’histoire s’étaient passés en France. L’impressionnisme est né en France. On avait le sentiment que van Gogh et Picasso étaient français ! C’est le pays réputé le plus libre pour l’art… ») et, vu de Beijing, pourquoi pas Rennes ?

Sa vision idéale de la France des arts est heureusement relayée par la réalité de l’accueil que lui réservent les administrations, pour lesquellles il témoigne d’une reconnaissance pleine et entière. « La France, sourit-il, c’est le seul pays « gentil » pour les étudiants aux petits moyens. Il y a une éducation publique, à laquelle on n’accède pas aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Heureusement que je suis venu en France. C’est pour moi le pays le plus humain dans le monde : on te prend comme quelqu’un ici, pas comme un chèque. Ton talent, ça compte, ta pensée, ta présence ; tout ça compte. » Il ajoute : « Il y avait un statut « jeune talent » pour les cartes de séjour ; c’est ce qui est inscrit sur la mienne. » Cela signifie beaucoup pour lui. « Ce n’est pas juste l’argent qui compte. C’est très beau. »
Complémentarité des formations chinoise et française : la virtuosité et l’abstraction intellectuelle
Il passe cinq années aux Beaux-Arts de Rennes. Ce que les études chinoises lui avaient offert comme formation extrêmement solide sur le plan technique du dessin et de la peinture, il la complète par la vision plus contemporaine, conceptuelle, des études artistiques en France. « Les études en Chine sont très techniques ; en France pas du tout, elles sont plus intellectuelles. » Il se réjouit de cette complémentarité qu’il a pu acquérir dans ces deux façons de faire opposées, souvent à l’extrême. Elle transparaît dans ses œuvres à la fois figuratives et abstraites, libres de l’un ou l’autre modèle.

Les années de vaches maigres
Ces années aux Beaux-Arts furent « un combat très dur. J’avais besoin de me loger, de dormir quelque part, et de pouvoir suivre les cours de cette école qui était le paradis de mon rêve. J’ai connu la plus grande douleur : j’ai eu beaucoup de mal à me nourrir. J’ai été très connu par la pauvreté, rit-il avec pudeur. J’ai déménagé sept fois. Une année, j’ai vécu les deux mois d’été dans ma voiture. »
Il a fait tous les boulots pour subsister : découper des cochons à Landivisiau, charger des canards et des dindes sur la ligne d’une usine près de La Rochelle, ramasser des tomates. Mais « en tant que jeune Chinois pauvre, on trouve toujours des solutions », plaisante-t-il, et avec un ami, Wei, il part faire le portraitiste pour touristes à Saint-Malo, place Chateaubriand, sept étés durant. Il frémit à ce souvenir, chargé d’émotions. La concurrence est « sauvage » à Saint-Malo, comme sur la place du Tertre à Montmartre ; l’ambiance est mafieuse, avec beaucoup de violence bien que les emplacements soient réservés et payés à la ville. Wang Chunyu et son ami Wei sont parfois repoussés par les peintres malouins. « Ils n’étaient pas tous méchants », et il y a eu aussi de la fraternité, « des douches chez eux, des cafés ». Mais aussi une « vie de la rue », avec sa rudesse et ses bagarres, et « de la solitude. Énormément »
Cela a été à la fois « un grand bonheur et une grande sauvagerie ». C’était important de tenir : « le résultat, si tu ne t’es pas fait virer par les restaurants, les gens de la rue, c’est que j’arrivais à gagner assez pour étudier. Je me fixais à l’époque 5000 euros pour survivre toute l’année. » Pas gourmand.

Un projet de court-métrage animé
Ces souvenirs mêlés, celui d’un collègue peintre décédé un été : trop de misère, pas la possibilité de s’arrêter malgré le cancer qui le rongeait, la violence qui fait encore frémir cet artiste sensible, la joie des enfants émerveillés d’être portraiturés, la fraternité aussi, la beauté, il veut en faire un film d’animation. « Peut-être une petite série de courts-métrages. » Le projet est en cours d’élaboration, d’écriture et de dessins préliminaires. Un renouvellement, encore, mais toujours en tenant ensemble ce qui fait le souffle de la vie, ses plus grandes douleurs et ses plus belles joies.

Il sourit. « Je garde beaucoup pour moi, car je ne suis pas fait pour tout raconter. Ces douleurs et ces bonheurs font partie de moi mais j’ai besoin de garder. C’est une nourriture pour mon art. »
Wang Chunyu parvient à demeurer artiste et ne pas rester dans la seule survie, pendant ces mêmes années : ses œuvres sont sélectionnées trois fois dans cette période pour des salons au Grand Palais et au Salon d’automne, à Paris. Il se souvient de jeter à la poubelle les vêtements crasseux et fichus de la rue malouine, pour enfiler une chemise neuve et prendre le train pour les salons parisiens.
Un enseignant prolifique : de l’encre de Chine à la tablette
Depuis les Beaux-Arts, Wang Chunyu a pu subsister uniquement grâce à son art, « toucher le pinceau plutôt que le couteau à découper les bestiaux pour vivre » rit-il, menant sa barque grâce à l’enseignement et à la vente de ses tableaux.
Il enseigne aussi bien à l’ancienne, en montrant geste après geste un modèle à reproduire, selon la tradition orientale, ou dans des cours libres, notamment avec des modèles vivants que chacun dessine à sa façon, le professeur venant commenter chaque travail. Ses cours vont du plus ancien au plus contemporain : peinture chinoise avec l’association « Encres de Chine », une association qui existe depuis plus de 20 ans à Rennes et partenaire de l’Institut Confucius de Bretagne, mais aussi peinture occidentale classique à l’acrylique, aquarelle, crayons de couleur, modèle vivant, notamment à l’atelier du Thabor ou à l’atelier Sfumato 1519.
Il donne aussi des stages plébiscités d’art numérique sur tablette graphique, qui se déroulent à distance, chacun chez soi avec une tablette, pour apprendre en groupe à utiliser les logiciels et à dessiner un modèle.
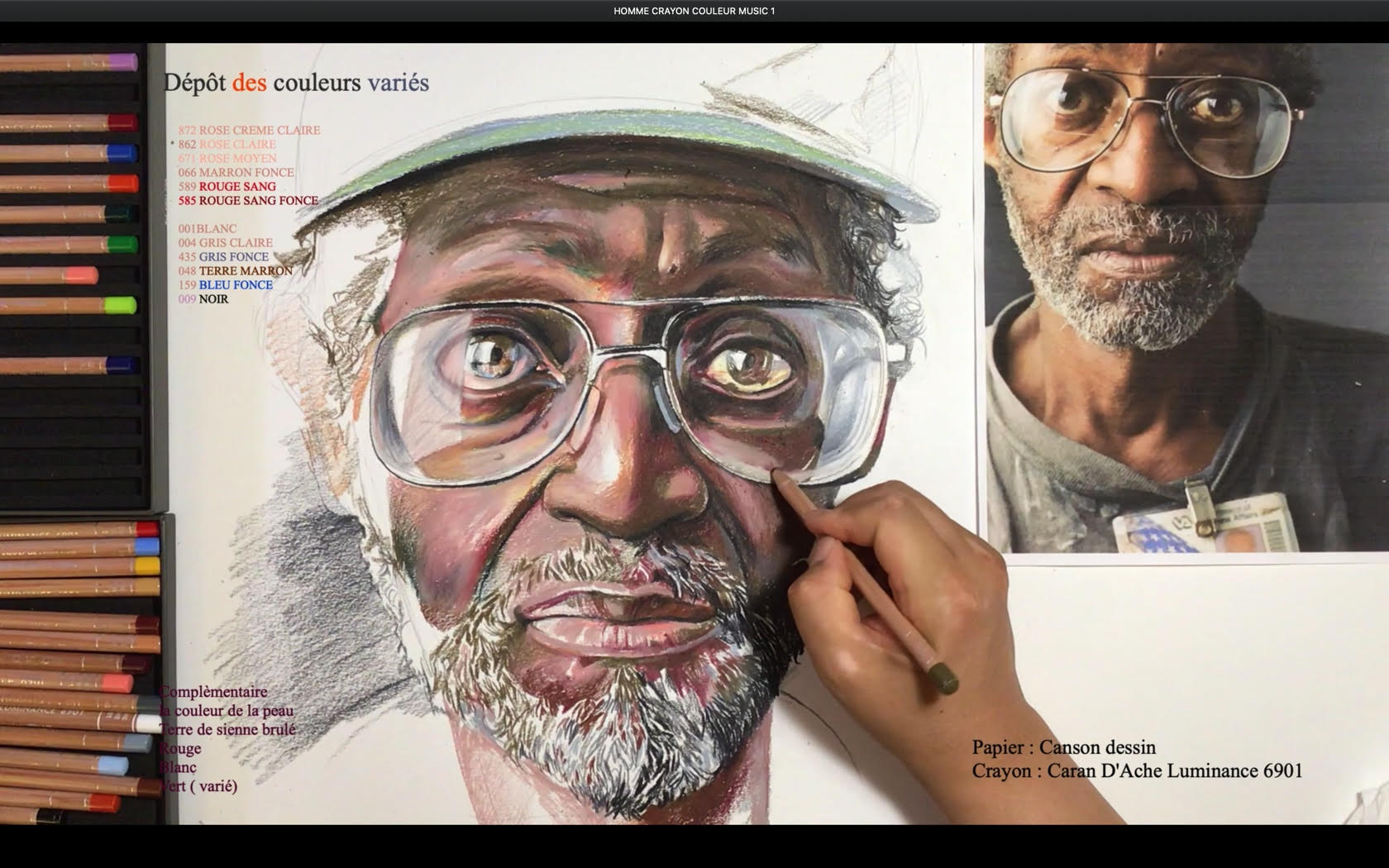
Dès le confinement, il a mis en ligne une chaîne Youtube où il poste des dizaines de tutoriels de toutes ces disciplines qu’il enseigne. Un travail pédagogique de titan qu’il alimente plusieurs heures par jour et qu’on peut « récompenser » par le biais de « tips ». On peut apprendre à peindre des renards blottis sous les feuilles en faisant fuser l’encre pour créer leur fourrure, des portraits « classiques », des paysages marins : tout un imagier où puiser pour exercer ses mains sur du papier ou une tablette.
Selon les mots de l’académicien François Cheng, qu’admire aussi Wang Chunyu, « la peinture chinoise se donne l’air de montrer le monde ; en fait, elle cherche simplement à aider ceux qui l’habitent à y vivre. » Un art qui n’est figuratif qu’accidentellement, pour nous aider à exister, et à trouver notre souffle.
