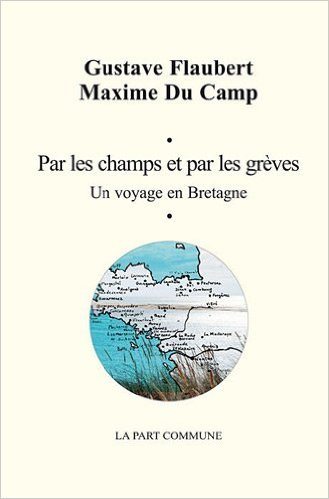Phoque ! Pour ce troisième épisode consacré à Rennes et les écrivains, on pouvait attendre de ce célèbre moustachu qu’il aime notre ville, au moins qu’il la décrive longuement. L’auteur de L’Éducation sentimentale et de Madame Bovary a tout de même écrit, dans une lettre adressée à Louise Colet en 1853 : « Il n’y a pas en littérature de beaux sujets d’art, et […] Yvetot donc vaut Constantinople ». Pour ceux qui ne connaissent pas, Yvetot est une commune de Haute-Normandie d’un peu plus de 10 000 habitants. Il a aussi précisé, dans son Dictionnaire des idées reçues, « voir Yvetot et mourir ». Preuve s’il en est que Flaubert reste avant tout le maître incontesté de l’ironie en littérature.
Mais Rennes ? Qu’est-ce à dire de cette histoire de phoque ? Je n’ai jamais vu ni entendu parler d’un tel mammifère dans la capitale bretonne. Que Rennes, pour ce troisième épisode, soit réduit, après avoir été traité de « chien policier », à son célèbre phoque, voilà qui nous enlève les applaudissements des mains. Les comparaisons animalières vont bon train, mais une anthologie littéraire de notre ville risque fort à ce rythme de tourner au ridicule. Chateaubriand voyait dans Rennes une Babylone : mais Rennes ne vaut-elle pas elle aussi Constantinople ? Apparemment, non. Il faut dire que la Bretagne, au XIXe, n’est pas une destination touristique de premier ordre. Mieux vaut partir avec Maupassant, Pierre et Jean au Havre, qu’en Bretagne avec Hugo. Par sa mère Sophie Trébuchet, l’auteur des Misérables ou de Notre-Dame de Paris avait du sang breton. Cela ne l’empêche pas, dans ses Correspondances, de parler d’un « pays stupide, peuple stupide, gouvernement stupide », et comme d’autres à cette époque, de critiquer la misère et la saleté de la Bretagne :
Du reste j’avais besoin d’eau. Depuis que je suis en Bretagne, je suis dans l’ordure. Pour se laver de la Bretagne, il faut bien l’océan. Cette grande cuvette n’est qu’à la mesure de cette grande saleté.
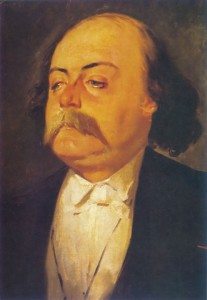
Rennes, qui possède une rue à son nom, perpendiculairement à la place du Parlement, est relativement absente de son œuvre. Dans son roman, Quatre-vingt-treize, il raconte l’affrontement révolutionnaire et contre-révolutionnaire lors de l’année 1793. Si Rennes n’a pas le privilège d’une description, comme Dol par exemple, elle est citée dans un dialogue imaginaire entre Marat, Danton et Robespierre. Bref, si les romanciers du XIXe parlent de Rennes et de la Bretagne avec toute la méchanceté rhétorique qu’ils possèdent, Flaubert, lui, s’avère beaucoup plus mordant.
Au XIXe, ne désespérons pas : nous avons tout de même Villiers de L’Isle-Adam, Briochin de naissance, étudiant à Rennes, auteur des Contes Cruels ou de L’Ève future ou encore Tristan Corbière et ses Amours jaunes. Avouons-le : cela n’a pas le rayonnement d’un Maupassant ou d’un Flaubert. Et pourtant l’ermite de Croisset a effectué, avec Maxime du Camp, un voyage en Bretagne, écrit et publié par la suite sous le nom de « Par les champs et les grèves ». Toute l’ironie flaubertienne s’y déploie, particulièrement dans son évocation des champs de Carnac :
Si l’on me demande, après tant d’opinions, quelle est la mienne, j’en émettrai une irréfutable, irréfragable, irrésistible… Cette opinion, la voici : les pierres de Carnac sont de grosses pierres !
Imaginez Flaubert râlant dans sa grosse moustache. Leur guide est un vieillard qui ne cesse pas de « vouloir retourner à Rennes ». Il semble ennuyer terriblement Gustave, lequel écrit dans son journal :
Des choux, des navets, beaucoup de betteraves et démesurément de pommes de terre, tous, régulièrement enclos dans des fossés, couvrent la campagne, depuis Saint-Pol-de-Léon jusqu’à Roscoff. On en expédie à Brest, à Rennes, jusqu’au Havre ; c’est l’industrie du pays ; il s’en fait un commerce considérable. Mais qu’est-ce que cela me fait à moi ? croyez-vous que ça m’amuse ?
On sait que Maxime et lui lisent le Génie du Christianisme, de Chateaubriand, sur la route de Rennes. Son commentaire sur Rennes est lapidaire et incompréhensible en dehors de son contexte :
Rennes. — Rien, rien que le phoque ; ses narines ont l’air de deux coupures sur son museau ; baquet vert avec des tentures peintes en dedans ; quinquet d’en haut ; orgue de Barbarie. Quand le phoque sera parti de Rennes il n’y aura plus rien à y voir.
Qu’est-ce que cette histoire de phoque ? Flaubert nous l’explique :
En nous promenant le soir sur le bord de la Vilaine, du côté des ponts, nous avons vu une sorte de long fourgon où l’on entrait par un escalier à double rampe et qui avait, le long de sa caisse, de petites fenêtres carrées à rideaux de coton rouge. La lumière de l’intérieur passant à travers, empourprait les têtes de la foule qui se tenait alentour ; sur le seuil de la voiture, une femme encore jeune, maigre, salement mise, et le front rétréci par des tresses noires relevées sur les oreilles, tenant une baguette à la main et, glapissant dans son accent provençal, racontait l’horrible combat qui avait eu lieu sur les côtes de Barbarie entre un marin intrépide et un phoque furieux : on était, cependant parvenu à s’emparer du phoque, on l’avait dompté, éduqué ; il était là, on pouvait le voir.
Nous entrâmes et prîmes rang autour d’un grand baquet oblong dont le dedans peint en gris était relevé par des bandes grenat simulant une tenture. Au-dessus du baquet, un quinquet muni d’un abat-jour en tôle renvoyait sa lumière sur l’eau jaunâtre dans laquelle quelque chose de noir et de long gisait sans bouger. La femme s’en est approchée, l’a frappé d’un petit coup de baguette ; il a sorti sa tête humide, ses narines ressemblant à deux coupures symétriques se dilataient et se contractaient avec bruit, et il vous regardait tristement de ses deux gros jeux noirs ; il a voulu faire un mouvement, mais sa queue s’est heurtée contre les planches ; il s’est tourné sur le dos et nous a montré son ventre blanc, gras encore des viscosités de la mer ; il s’est levé tout droit, a appuyé ses nageoires sur le bord de la cuve, a donné un coup de son museau contre la joue de sa maîtresse, puis il est retombé au fond, en poussant un grand soufflement. Il n’a plus ces bons flots où il vivait à son aise ni les larges grèves où il s’étendait au soleil sur les goémons verts !Comme il avait bien travaillé, on l’a gratifié de deux ou trois anguilles qu’il avalait lentement en les mangeant par le milieu, et les deux bouts lui sortant de la bouche faisaient de chaque côté de son museau comme deux longues moustaches blanches. Un orgue de Barbarie qui était dans un coin s’est mis aussitôt à tourner une polka, le quinquet filait, sur l’escalier la femme appelait la foule, la représentation était terminée. Voilà ce que nous vîmes à Rennes. Quand le phoque n’y sera plus, qu’y aura-t-il à y voir ?

Nous, on sait désormais que ce phoque s’en est allé depuis longtemps. Alors, est-ce à dire qu’il n’y a plus rien à voir, à Rennes, plus rien à dire ? Pas de panique. Le XXe siècle promet quelques perles littéraires. Et cela commencera pour nous, la semaine prochaine, avec un irrévérent roi de Pologne… Merde !
Gustave Flaubert, Maxime Du Camp, Par les champs et par les grèves, La Part Commune, 2010, 608 pages, 19 euros.
Maxime du Camp était Officier de la Légion d’honneur, Académicien, essayiste et romancier
Né à Paris, le 8 février 1822, décédé 8 février 1894
Il voyagea beaucoup, fut un des fondateurs de la Revue de Paris qui publia Mme Bovary et collabora à la Revue des Deux Mondes ; il a publié un certain nombre d’ouvrages, dont les meilleurs sont Paris, ses organes, ses fonctions, sa vie, en six volumes, et les Convulsions de Paris, en quatre volumes.
Il fut élu à l’Académie française le 26 février 1880 en remplacement de Saint-René Taillandier, et reçu le 23 décembre 1880 par Elme-Marie Caro. Maxime Du Camp fut l’ami des romantiques, de Gautier et de Flaubert. En 1860 il fit partie de l’expédition des Mille. Il attaqua l’Académie et demanda sa division en sections.
J’ai dit, écrit-il, que l’Académie n’était plus de nos jours un corps littéraire. J’ai eu tort. J’aurais dû dire qu’elle est un corps essentiellement antilittéraire ; elle corrompt ou elle tue.