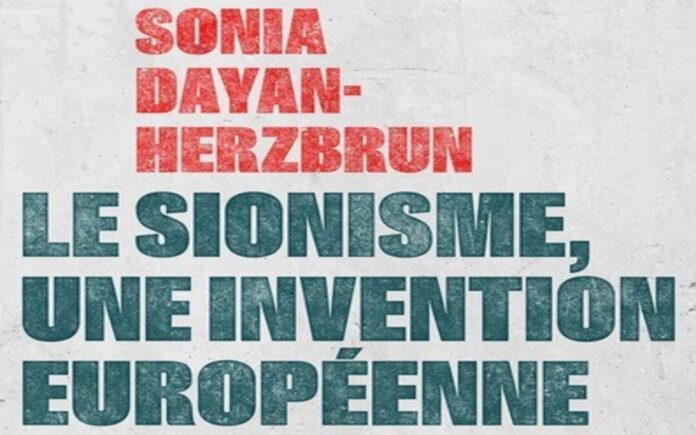Un livre de généalogie politique n’est pas un verdict, c’est une épreuve. Il ne réfute pas d’emblée, il reconstruit les conditions de possibilité d’une idée, avant de demander au lecteur ce qu’il convient de faire de cette reconstruction. Dans Le sionisme, une invention européenne. Genèse d’une idéologie, Sonia Dayan-Herzbrun propose une thèse forte, quasi programmatique.
Le sionisme moderne (projet d’État, de territoire, de souveraineté) s’est formé dans une matrice européenne au croisement d’un héritage chrétien (en particulier protestant), d’une rationalité impériale et d’une époque nationalitaire. Ce geste n’implique ni que le judaïsme serait “européen” ni que la relation juive à Sion serait une fiction. Il impliquerait autre chose. La forme politique moderne prise par ce “retour” (État-nation, colonisation de peuplement, légitimation biblico-historique, administration de populations) relèverait d’un outillage d’origine européenne et que cet outillage produirait des effets structuraux — au premier chef… l’effacement et la dépossession des Palestiniens, qu’ils soient chrétiens et musulmans.
Pour se donner les moyens de cette démonstration, l’autrice suit un parcours en six chapitres : Protestantisme et désir d’empire ; Une terre pour les schnorrers ; L’ère des nationalismes ; La Bible comme arme et les armes comme bible ; Une utopie coloniale ; Désorientaliser les Juifs. La question directrice est simple à formuler, difficile à soutenir. Comment une idéologie coloniale a-t-elle pu se délester de son histoire au point de se présenter, dans l’espace public occidental, comme une évidence morale (un “refuge”, une “réparation”, une “démocratie assiégée”) ?
Il s’agit de prendre cette thèse au sérieux. Donc de la soumettre à des points de vue contraires. L’objectif n’est pas la joute, mais la précision dialectique germinative. Toute thèse qui résiste à ses meilleurs adversaires gagne en netteté. Sinon elle révèle a minima où se situent ses points d’aveuglement.
Ce que la thèse éclaire puissamment
Premier apport : déplacer le point de départ. Le livre refuse de faire du sionisme la simple conséquence mécanique de l’antisémitisme (comme si la persécution produisait d’elle-même une forme d’État). Il replace l’émergence du projet dans un long continuum où l’Europe, travaillée par l’anti-judaïsme chrétien puis par ses versions modernes, cherche aussi à gérer la présence juive, autrement dit l’externaliser, la reterritorialiser, l’administrer.
Deuxième apport : rendre visible le sionisme chrétien et impérial. Avant même le sionisme juif organisé, une partie du monde protestant anglais (puis états-unien) élabore une politique de la Palestine liée à une théologie de l’histoire et à des intérêts d’empire. Ce n’est pas un détail car cela installe une grammaire où “terre promise” et “raison d’État” deviennent compatibles puis mutuellement renforçantes.
Troisième apport : la critique de la sacralisation. Dans La Bible comme arme…, l’autrice décrit une opération centrale qui est de transformer un texte religieux en carte, puis la carte en droit. Quand le récit d’origine devient instrument de souveraineté, il facilite un effacement très concret, celui des habitants présents, réinterprétés en obstacles, en “populations”, en non-sujets.
Quatrième apport : la mise au jour d’une technologie d’occidentalisation. Dans Désorientaliser les Juifs, Dayan-Herzbrun insiste sur un double mouvement qui est d’européaniser un sujet politique juif pour l’inscrire au sein de l’Occident et de réutiliser l’orientalisme occidental pour renvoyer les Palestiniens (et plus largement le monde arabe) du côté du déficit, de la menace, de l’arriération. Autrement dit, l’invention européenne n’est pas une origine, c’est un mode opératoire.
Ce que la thèse gagne, ce qu’elle doit encore prouver
La force la plus immédiatement convaincante de l’essai tient à une série de distinctions qui clarifient un débat souvent saturé de slogans. D’abord, dissocier l’attachement religieux, culturel ou mémoriel à Sion — multiforme, diasporique, ancien — du sionisme comme projet politique moderne de souveraineté territoriale. Ensuite, refuser la téléologie. Considérer que 1948 ne fut pas un destin, mais l’issue d’une chaîne de bifurcations, de conflits internes, d’alliances et de rapports de force. Enfin, décrire un “cadre de pensabilité” majoritairement européen où se stabilisent les catégories opératoires du projet : nation, peuple, frontière, retour, sécurité, administration. À ce niveau, le livre fait œuvre utile, il rend lisible la fabrication de l’évidence.
Mais l’affirmation « invention européenne », précisément parce qu’elle est percutante, appelle un contrôle de méthode. Le risque est celui du monisme explicatif avec trop d’unité, trop de matrice, pas assez de dissensions. L’histoire du sionisme est un champ de fractures (courants travaillistes, révisionnistes, religieux, binationalistes, antisionismes juifs, tensions entre conceptions concurrentes de l’État et du territoire). Si la généalogie tend à homogénéiser, elle peut écraser des lignes de division cruciales, donc affaiblir ce qu’elle veut démontrer, autrement dit que rien n’était inévitable. La question devient alors une exigence de rigueur. A quel moment, et par quels mécanismes précis, passe-t-on d’une influence (par exemple, un sionisme chrétien et impérial) à une structuration (un programme d’État porté par des acteurs juifs, avec ses institutions, ses stratégies, ses doctrines) ? La démonstration est d’autant plus solide qu’elle sait distinguer la matrice, la traduction politique et l’autonomie des agents.
Une seconde ligne de controverse touche à la hiérarchie des causes. Contre la lecture “coloniale” du sionisme, on oppose souvent un argument de survie. L’antisémitisme européen, les pogroms, l’exclusion civique, puis la catastrophe génocidaire auraient donné au projet une nécessité historique. D’où une objection majeure qui est de qualifier le sionisme d’idéologie coloniale risquerait de méconnaître la logique du refuge, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le lien historique et symbolique à la terre ainsi que les guerres subies. À l’inverse, l’essai répond par un point difficile à évacuer, comprendre la détresse historique ne dispense pas d’évaluer les moyens. Une cause tragiquement compréhensible peut produire un ordre injuste; et la question n’est pas de nier un lien juif à la terre, mais d’interroger la forme prise par ce lien lorsqu’elle se traduit en État-nation exclusif, expansion territoriale, sacralisation du droit et différenciation des statuts. La discussion se cristallise alors sur un point technique et décisif qui est la pertinence — ou non — de la catégorie de « colonialisme de peuplement ». Ici, la demande la plus honnête consiste à exiger des comparaisons contrôlées. Qu’est-ce qui rapproche structurellement le cas israélo-palestinien de configurations coloniales connues (logique d’implantation, production d’un “vide”, régime de droits différenciés, gestion des populations) ? qu’est-ce qui l’en distingue (absence de métropole, histoire spécifique de persécution, construction d’une souveraineté dans un ordre international particulier) ? C’est à cette condition que la critique échappe à l’analogie paresseuse.
Une troisième controverse, plus morale que descriptive, porte sur le passage du diagnostic à la normativité. Une généalogie peut être une radiographie brillante tout en laissant le lecteur sans boussole éthique ou en ouvrant la voie à des usages politiques ambigus. D’où une double exigence. D’un côté, ne pas réduire l’agentivité juive ; si l’on insiste trop sur l’Europe inventrice, on risque de transformer les acteurs juifs en simples objets de stratégies impériales, alors que le sionisme fut aussi un champ de choix, de conflits, de décisions. De l’autre, prévenir les effets d’essentialisation : la critique du sionisme ne peut être recevable que si elle dissocie explicitement “Juifs” et “sionisme”, et si elle se formule en termes d’institutions, de droits, de politiques, non d’identités. Cette précaution est le garde-fou minimal contre la dérive antijuive qui parasite et disqualifie toute critique légitime.
Dans le même mouvement, l’essai est sommé de produire — ou au moins d’esquisser — une théorie du droit compatible avec son diagnostic : égalité civique, interdiction de la domination institutionnelle, principes de propriété et de réparation, garanties de sécurité, critères universalisables. Sans cela, la déconstruction peut flotter, car elle dévoile des récits, mais ne tranche pas la question centrale, qui est politique au sens fort – quel régime de droits rend possible une vie commune sans dépossession ?
Une dernière tension traverse la réception contemporaine, la suspicion envers les grands récits eux-mêmes. On peut applaudir la démystification de signifiants lourds (“retour”, “sécurité”, “civilisation”) et, simultanément, reprocher au livre de rester trop “moderne”, trop confiant dans l’idée qu’une vérité historique partagée suffira à désarmer la violence. À l’inverse, pousser trop loin cette suspicion conduit à un relativisme stérile où tout discours n’est que pouvoir et où la responsabilité se dissout. Sur ce point, la réplique la plus consistante consiste à rappeler que déconstruire ne suffit pas. Il convient aussi d’imputer, décrire des institutions, nommer des mécanismes de domination, et reconstruire un universel à partir des existences qui subissent concrètement l’injustice — non comme un masque occidental, mais comme un outil de protection.
Au total, la controverse ne disqualifie pas la thèse, mais la rend plus exigeante. Le livre gagne lorsqu’on le lit comme un geste de désenvoûtement — rendre à l’idéologie son histoire, donc sa contestabilité. Il s’affaiblit si son titre est reçu comme une explication totale ou s’il ne fournit pas assez de critères permettant de distinguer la généalogie (d’où vient une forme politique) de la norme (à quelles conditions une forme politique devient juste). C’est dans cet écart, précisément, que peut se loger une lecture de haut niveau : tenir ensemble la puissance de la généalogie et la rigueur d’une éthique politique qui refuse à la fois le chantage à la souffrance, l’analogie facile et l’essentialisation.
Points à préciser
1) Généalogie n’est pas disqualification automatique. Dire “européen” ne signifie pas “illégitime” par essence. Cela signifie : attention au cadre conceptuel qui a rendu une entreprise possible et aux effets qu’il produit. La critique tient si elle passe de l’origine aux mécanismes : administration, droit différencié, territorialisation exclusive, expansion.
2) Tenir ensemble deux tragédies sans chantage. Une lecture de haut niveau doit refuser l’addition et la concurrence des souffrances. L’histoire juive européenne (antisémitisme, génocide, exils) et l’histoire palestinienne (dépossession, occupation, fragmentation des droits) ne s’annulent pas. Elles se rencontrent dans une configuration politique qui a fait de la réparation d’un crime européen le point de départ d’un autre ordre violent.
3) Passer du diagnostic à des exigences minimales. Sans transformer l’essai en programme, on peut extraire des critères comme l’égalité des droits, la fin de la domination institutionnelle, la sécurité non fondée sur la dépossession d’autrui, la justice réparatrice, le refus des sacralisations politiques, etc. L’intérêt du livre est d’indiquer que, tant que l’idéologie se présente comme hors-histoire, ces critères restent imprononçables.
Politiquement sensible et intellectuellement nécessaire
Le livre est politiquement “dangereux” au sens où il retire au débat ses anesthésies habituelles. Il dérange l’Europe contemporaine, celle qui voudrait expier sans comprendre, soutenir sans regarder, invoquer la mémoire sans assumer l’histoire longue des empires et des classifications. Il dérange aussi les récits identitaires, tous ceux qui transforment une construction d’État en essence intemporelle et une domination en destin.
Au plan intellectuel, il est nécessaire précisément parce qu’il ne permet pas de rester dans la morale facile. Il ne dit pas : “qui a souffert a raison”. Il oblige à demander quel ordre politique crée-t-on, au nom de la souffrance. Sur qui retombe le prix de cette création ? Comment une idéologie peut-elle se rendre invisible à elle-même au point que sa propre histoire devienne indicible ?
Si l’on accepte cette exigence, le débat ne peut plus être réduit à des mots-clés (sécurité, terrorisme, droit, civilisation). Il revient à sa question la plus nue : comment rendre possible une vie commune qui ne soit ni domination, ni vengeance, ni sacralisation, mais égalité des droits et dignité partagée ? C’est peut-être la seule question qui mérite, aujourd’hui, d’être appelée politique.
Fiche technique
- Titre Le sionisme, une invention européenne. Genèse d’une idéologie
- Autrice Sonia Dayan-Herzbrun
- Genre Essai, généalogie politique, histoire intellectuelle
- Problématique Reconstituer les conditions européennes, théologiques, impériales et nationalitaires de formation du sionisme moderne, et interroger la manière dont cette histoire se trouve effacée dans les récits de légitimation contemporains
- Structure Six chapitres
- Protestantisme et désir d’empire
- Une terre pour les schnorrers
- L’ère des nationalismes
- La Bible comme arme et les armes comme bible
- Une utopie coloniale
- Désorientaliser les Juifs