Les romans de Grégoire Delacourt touchent toujours au cœur de notre société. Souvent sous la forme d’un conte, comme dans La femme qui ne vieillissait pas qui défait le mythe de la jeunesse éternelle ou Mon père abordant avec force et âpreté le sujet de la pédophilie dans l’Église catholique. Son dernier livre, Un jour viendra couleur d’orange, titre emprunté à un poème de Louis Aragon, est dans cette même lignée. Roman magnifique d’humanité et d’amour, écrit sans emphase ni sécheresse, dans la justesse, la délicatesse et la sobriété qui sied à un sujet tout autant intime qu’universel : la fragilité et l’innocence de l’enfance perdue dans une vie adulte brutale et impitoyable. Grégoire Delacourt nous offre là un texte comme une fable de la vie contemporaine, un conte pour adultes.
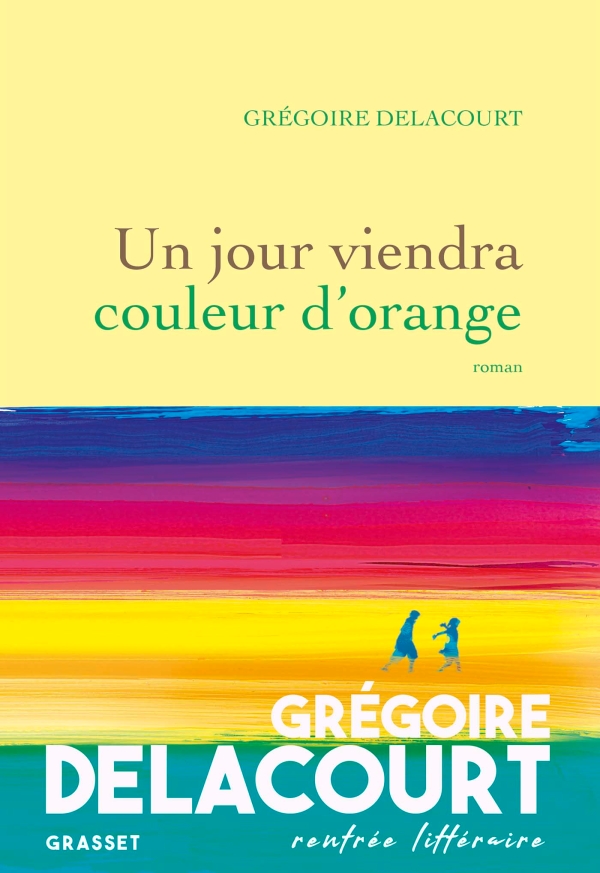
Le roman met en scène Pierre, un père qui n’en peut plus de son pauvre métier d’agent de sécurité dans une grande surface qui le fait à peine vivre et que sa hiérarchie méprise – « Je suis un chien là-bas et encore les chiens on les caresse » -, et Louise, une mère passionnée, mais épuisée par une activité d’infirmière hospitalière dans un service de soins palliatifs. Ils élèvent tous les deux Geoffroy, un enfant « différent », un enfant « comme sans personne dedans », autiste Asperger, un de ces enfants à la sensibilité exacerbée, à la capacité hors norme pour compter, classer, ordonner et mémoriser, mais un de ces enfants enfermés dans un monde qui les éloigne des apparents et coutumiers équilibres et signes affectifs. Geoffroy « comprenait, mais ne ressentait rien. […] La joie de vivre ne le faisait pas gambader. Ni s’envoler les rires. Il était une pierre. » Il ne supportait pas non plus d’être pris dans les bras ni caressé. Un enfant longtemps muet qui rapidement a effrayé son père incapable d’échanger avec lui, une incommunicabilité qui l’amènera même à quitter Louise. Une femme, elle, bouleversée par les rares et pauvres mots d’un enfant qui s’est mis à parler à quatre ans seulement : « Je sais que tu as des milliers de mots en toi, Geoffroy, que tu les a gardés jusqu’ici comme des trésors, des osselets au fond d’une poche, chacun de tes mots est un cadeau et si les autres ne les comprennent pas toujours, ce n’est pas grave, car moi je les sais. »
Quand s’ouvre le roman, Pierre, engagé dans la naissante et brutale aventure des « Gilets jaunes », est au milieu de ses camarades en route vers un rond-point, tous « unis dans un entrelacs de corps perclus de colère et de peurs, une même chair prête au combat et parée aux blessures puisqu’il n’est de vie qui ne s’abreuve de sang. » Des hommes et des femmes envahis du sentiment d’abandon, révoltés de « voir chaque jour à la télévision des nababs qui pérorent, des politiciens qui donnent des leçons de vertu et filoutent à qui mieux mieux, […] des types à Paris qui ne savent pas ce que c’est une fin de mois le quinze », désespérés « parce que les hommes ça ne compte pas, des chiffres sur un bilan, la même chair à canon qu’en 39 mais dans une guerre mondiale feutrée cette fois. » Tous portés par un slogan, tout aussi simple et évident que furieux et catégorique, que Pierre et ses copains de lutte répéteront à l’envi : « On veut juste une vie juste. » Le mouvement des « Gilets jaunes » s’essoufflera. Pierre aussi, qui s’en éloignera ou plutôt trouvera une autre raison et façon de corriger la misère autour de lui en laissant de faméliques familles dérober de la nourriture dans la grande surface de son employeur : Robin des Bois au secours des pauvres, voilà sa nouvelle vie, désormais, qui lui fera retrouver, peut-être, Louise et Geoffroy…
Femme forte et fragile, Louise, l’infirmière, tient seule à bout de bras l’éducation de son fils Geoffroy et son foyer, et ne comprend pas que Pierre, son mari, veuille changer le monde alors qu’il y a tant à faire pour sa petite famille. Une famille qu’elle fait vivre avec son travail à l’hôpital, où elle accompagne au cinquième et dernier étage les malades en fin de vie, après avoir assisté des années auparavant les jeunes mamans en néonatologie et « veillé à garder hors de l’eau les visages violacés, les petits corps prématurés, jusqu’à les rendre un jour aux parents, leur dire ces deux mots qui font toujours pleurer parce qu’ils parlent d’un miracle : il vivra. » À présent, les vies crépusculaires qu’elle assistait et aidait à rendre moins souffrantes se comptaient en jours, en semaines, tout au plus, « quand la maladie n’était plus un combat, mais le temps qui restait, une grâce. » Une grâce qu’Aurélien, malade en fin de vie et Louise elle-même connaîtront dans d’ultimes et intenses moments, comme une histoire d’amour désespérée.
Cette grâce aussi va illuminer l’aube d’une vie, et c’est Djamila, toute jeune fille de quinze ans, qui la portera et éblouira l’existence de Geoffroy, le garçon « différent », treize ans désormais, petit prince plein de candeur, reclus et solitaire, dans sa prison scolaire où les camarades de classe lui mènent la vie dure, avec bagarres, coups et blessures. Djamila, « fille et petite-fille de migrants berbères », « irradiante de beauté », au « rire clair comme l’eau d’une cascatelle », est une enfant orpheline de mère, fille unique du vieil et tendre Ahmed Zeroual et sœur de deux frères rigoristes qui veulent lui imposer le port du djilbab : « C’est Allah qui est ta patrie et Allah qui est juste et sage ne veut pas te voir jambes nues dans la rue ».
Djamila, « parce qu’elle adorait comme Geoffroy les arbres, comme lui le nom des vents, la solitude, les mêmes films, les mêmes chansons », pose sur lui ce regard de bienveillance et d’amour. Elle ne quittera plus Geoffroy, fasciné lui-même par la beauté de cette jeune fille et « la nuance du noir de ses cheveux, le sable de sa peau, […] son regard vert véronèse ». Geoffroy « aimait mille, dix mille morceaux d’elle. Le tout c’était impossible puisqu’il ne percevait pas la beauté d’un ensemble. Djamila adorait être comme un puzzle à ses yeux. Cela rendait chaque millimètre d’elle infiniment plus précieux. » Et sa voix s’était brisée « lorsqu’elle avait dit au garçon qu’elle aimerait qu’il n’y ait que lui sur terre. » Grâce à elle, Geoffroy « surmontait ses craintes. Il découvrait la confiance. Djamila l’avait rassuré, sa voix contre sa peau, tel le dzhari chaud et doux du Sahara, des mots qui enveloppent, presque une litanie […] et quand on s’aime, le corps de l’autre n’est plus une île lointaine, une impossibilité, au contraire, il devient un port où s’accrocher, poser son cœur, se dire c’est là que je vais vivre.»
La rage de Pierre, le don de soi de Louise, la tendresse native de Geoffroy, la beauté singulière et l’amour pur de Djamila prise dans les chaînes familiales, raciales et religieuses, la bonté de l’ermite Hagop Haytayan, émigré arménien, « héritier d’un peuple sans cesse massacré », vieil homme des bois qui abritera dans sa cabane les amours du couple juvénile, traversent ce livre en autant de luttes et d’aventures qui finissent par se rejoindre dans ce roman noué de douleurs et tissé de bonheurs. Car selon les mots d’Aragon :
« Un jour pourtant un jour viendra couleur d’orange, Un jour de palme un jour de feuillages au front, Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront… »
Poignant, poétique et lumineux.
