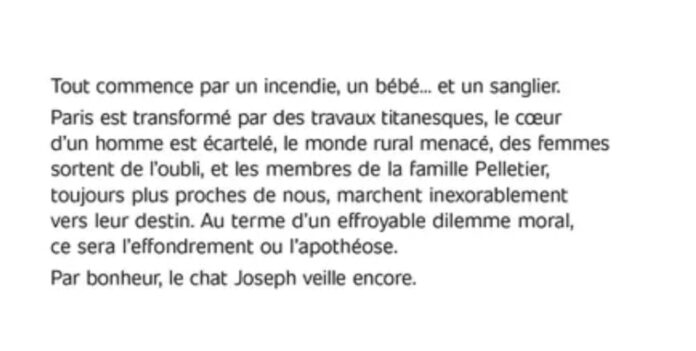Avec Les Belles Promesses, Pierre Lemaitre referme la tétralogie des Années glorieuses et, plus largement, pousse d’un cran supplémentaire son grand geste narratif qui consiste à feuilleter le XXᵉ siècle en faisant de la grande Histoire une matière de roman populaire qui n’abdique ni la complexité ni la cruauté ni l’ambivalence morale.
Ici, tout commence par un incendie, un bébé… et un sanglier. Un trio d’images qui dit déjà la logique du livre. Le feu pour la catastrophe et la révélation ; l’enfant pour l’innocence instrumentalisable ; l’animal pour l’irruption du réel, du sauvage, du non-domestiqué ; ce qui résiste aux beaux discours. Sur les pentes de Montmartre, à l’heure où la ville se transforme à marche forcée, un membre de la famille Pelletier accomplit un geste qui le propulse au centre d’une “belle histoire” ; et donc au centre d’une machine sociale qui récupère, monétise, déforme. Paris se modernise ; les réputations se fabriquent ; les ruraux s’inquiètent ; des femmes sortent de l’ombre. Et pendant que le pays célèbre ses lendemains radieux, les Pelletier, eux, marchent vers un dilemme qui mettra à l’épreuve ce qu’on doit aux autres, ce qu’on se doit à soi-même, et ce qu’on appelle, un peu trop vite, une promesse…
Les Belles Promesses se situe en 1963. Paris est en chantier, le périphérique se construit, l’idéal de progrès s’incarne en béton, en marteaux-piqueurs, en bretelles d’accès, en expropriations. Une époque se raconte souvent comme une promesse tenue — croissance, confort, avenir. Pierre Lemaitre choisit l’angle inverse. La promesse est d’abord une phrase qu’on prononce pour se convaincre soi-même, un récit qu’on fabrique pour supporter ce qu’on fait aux autres et parfois un mensonge collectif dont on hérite comme d’un mobilier trop lourd. Le livre regarde ce moment où l’avenir est présenté comme une évidence alors même qu’il se paie au prix d’existences déplacées, de paysages abîmés, de vies « recadrées » au nom de la modernité.
La réussite la plus nette tient à sa tension interne. Les Belles Promesses n’est pas seulement un dernier tome « de conclusion ». Il a le cran d’être un roman à part entière qui recharge le lecteur en énergie narrative plutôt que de le reconduire poliment vers la sortie. Pierre Lemaitre redonne au feuilleton sa pulsation d’origine, autrement dit l’inquiétude, le soupçon, l’enquête comme forme morale. Là où la saga familiale pourrait s’amollir en chronique, Les Belles Promesses remet du risque dans les liens.
Au cœur, un dilemme : que doit-on à un frère quand la vérité que l’on devine pourrait le détruire et détruire avec lui tout un fragile édifice familial ? C’est ici que l’ouvrage prend une allure de tragédie classique sous costume de roman populaire, car il organise une mécanique de choix impossibles. La tragédie, chez Pierre Lemaitre, n’est jamais un grand concept, plutôt une addition de petits arrangements, de lâchetés, de calculs, d’instants où l’on se dit… « ça passera ». Jusqu’au moment où cela ne passe plus.
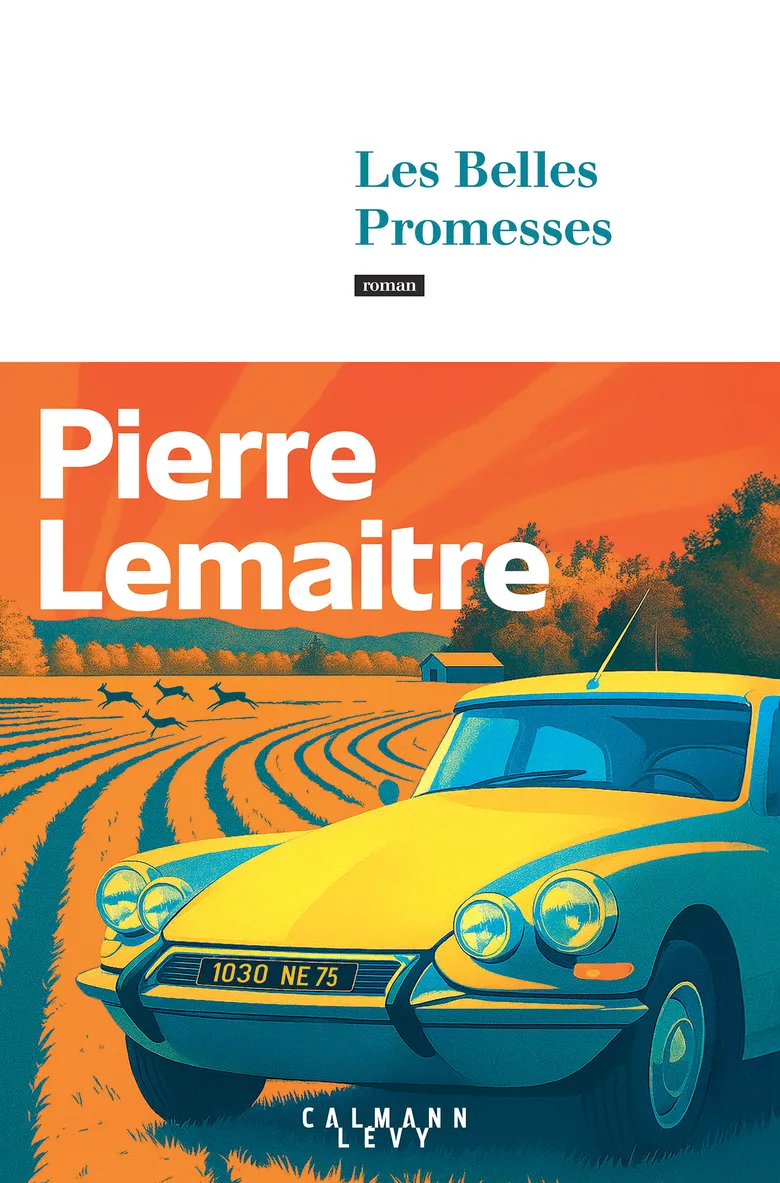
Le point de départ des Belles Promesses (lncendie, bébé sauvé) est d’une intelligence romanesque redoutable. Pierre Lemaitre sait que l’héroïsme est l’un des meilleurs pièges narratifs qui soient. Un homme devient héros. Aussitôt, la société fabrique autour de lui une statue provisoire, un récit de presse, une légende commode. Mais l’homme, lui, sait ce qu’il y avait réellement dans son geste une part d’ombre, une intention trouble, une minute intérieure que la version officielle ne peut pas accueillir.
Le roman exploite cette dissonance avec cruauté. Etre célébré pour ce qu’on n’est pas (ou pas tout à fait), voilà une forme moderne de supplice. Et c’est là que la question des « promesses » devient intime, car promettre, c’est aussi promettre une image de soi. On s’engage à ressembler à la fable qu’on a déclenchée. On signe, sans l’avoir voulu, un contrat avec le regard des autres. Voilà le héros comme “être-pour-autrui” et la promesse comme récit collectif.
Dans cette perspective, l’héroïsme n’est donc pas un sommet moral mais une contrainte sociale. L’héroïsme n’est pas une essence, mais un rôle. Et Pierre Lemaitre, feuilletoniste trop expérimenté pour ne pas aimer les renversements, s’en sert comme d’un levier. Et comme le garçon de café de Sartre, le “héros” risque de se perdre à force de coïncider avec son personnage. Plus la « belle histoire » prend, plus le mensonge-initial-vérité-inavouable devient explosif.
En paralèlle, le personnage de Geneviève cristallise la violence froide de l’ascension sociale, l’exploitation des symboles, la manière dont une époque transforme tout en opportunité, même un sauvetage, même un drame. Elle n’est pas seulement horrible, elle est parfaitement adaptée à un environnement où la réussite est un théâtre permanent.
Jusqu’où la caricature est-elle un défaut, et jusqu’où est-elle un choix esthétique ? Chez Pierre Lemaitre, l’excès a une fonction. Il met à nu les ressorts et accélère le dévoilement. Au plan littéraire, cela produit une jubilation noire. Au plan moral, cela oblige aussi le lecteur. On rit parfois de ce qu’on devrait trouver insupportable et l’on découvre – étonné – que le roman nous a pris de vitesse.
La limite possible, évidemment, est celle de la partition trop bien régléd. Quand une figure négative devient un moteur trop efficace, le risque est de réduire la complexité psychologique au profit de l’efficacité dramatique. Mais Les Belles Promesses évite généralement l’écueil par une stratégie simple, la méchanceté n’est jamais seule, elle s’inscrit dans une chaîne d’intérêts, de lâchetés et de besoins. Geneviève ne flotte pas hors-sol, elle est le produit d’un monde qui récompense la prédation élégante.
Côté rythme, Pierre Lemaitre a une science qui relève presque du montage cinématographique. Scènes courtes, relances, retournements, alternance des tons ; l’ironie protège l’émotion, et l’émotion donne un poids réel à l’ironie. On rit, puis on se surprend à avoir la gorge serrée. Cette instabilité est une signature.
La réserve, si l’on en cherche une, tiendrait à la nature même de ce talent. La machine romanesque est si efficace qu’elle peut parfois donner l’impression d’une réalité scénarisée. Comme si l’existence, pour être digne du roman, devait sans cesse produire de l’événement. Le réel, lui, est plus plat, plus sournois. Mais il serait injuste de reprocher à Pierre Lemaitre ce que, somme toute, il revendique.
Car la question n’est pas celle de la vraisemblance, mais celle de la justesse. Et Les Belles Promesses s’avère juste dans ce que la panorama raconte des années 1960 avec leur optimisme affiché, leurs violences sous la moquette, leur passion pour l’avenir qui autorise tant de brutalités au présent. Et Pierre Lemaitre les raconte avec la propulsion de Dumas (père), une armature balzacienne moirée d’Eugène Sue dans le traitement social du feuilleton ; le tout avec une teinte noire moderne – cruauté du rythme et rythme cruel – qui le rapproche de loin en loin de Simenon.
Clore une saga, c’est toujours risquer la solution décorative. Pierre Lemaitre choisit plutôt de faire de la fin une épreuve : que vaut une promesse quand elle est confrontée au prix payé par d’autres ? A quoi avons-nous cru et qu’avons-nous laissé faire pour continuer d’y croire ? Le roman populaire devient alors autre chose qu’un confort, quelque chose d’une expérience morale.
Les Belles Promesses — Pierre Lemaitre
Éditeur : Calmann-Lévy
Parution : 6 janvier 2026
512 pages — Grand format (env. 145 × 220 mm)
ISBN/EAN papier : 9782702191477
EAN numérique : 9782702191965
Prix indicatif : 23,90 € (papier) ; 16,99 € (numérique)