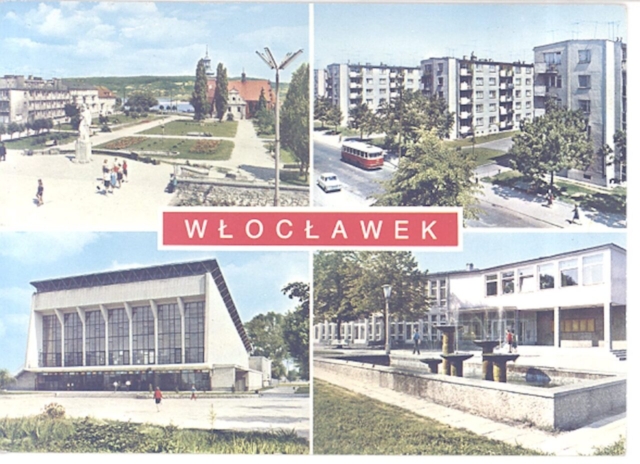Et si l’Europe se racontait d’abord par ses images avant de parler politique, frontières ou croissance ? Du 21 mars au 17 mai 2026, le festival Circulation(s), consacré à la jeune photographie européenne, investit à nouveau les 2 000 m² du CentQuatre-Paris, dans le 19e arrondissement.
Pour sa 16e édition, le rendez-vous imaginé par le collectif Fetart convoque 26 artistes de quinze nationalités et un focus dédié à l’Irlande, dans une scénographie pensée avec le studio Bigtime. Un lieu d’exposition, certes, mais surtout un laboratoire où se rejouent les fractures de notre continent : guerres, extractivisme, frontières, identités queer, mémoire familiale, données numériques et dérèglement écologique.
Depuis 2011, Circulation(s) s’est imposé comme l’un des rares festivals à se consacrer exclusivement aux émergent·es, à rebours de la tendance à capitaliser sur quelques grands noms. Sa particularité, une direction artistique collégiale, assurée par sept spécialistes de la photographie émergente, qui revendiquent la pluralité des écritures plutôt qu’une ligne homogène. En 2026, le collectif se renouvelle en partie en accueillant trois nouvelles commissaires (Caroline Benichou, Ioana Mello et Lucille Vivier-Calicat), signe qu’ici la gouvernance elle-même se pense comme un terrain d’expérimentation.
Ce choix est tout sauf neutre. Dans une époque saturée d’images mais toujours dominée par quelques plateformes, quelques agences et quelques regards, Circulation(s) fait le pari d’un écosystème horizontal, où la découverte passe par la confrontation des subjectivités. Il ne s’agit pas de chercher « la » voix de la jeunesse européenne, mais d’entendre comment se tressent, parfois se contredisent, des expériences venues d’Ukraine, de Lettonie, de Slovénie, de Guyane, d’Irlande ou du Frioul italien.

Mémoires trouées, histoires recomposées – l’Europe comme palimpseste
Une des forces de cette édition est d’aborder la question de la mémoire non pas comme un devoir abstrait, mais comme une matière fragile, trouée, parfois toxique. La Tchèque Alžběta Drcmánková brode patiemment ses photographies de paysages-refuges jusqu’à les faire littéralement se dissoudre ; perle après perle, l’image disparaît et ne subsiste qu’une texture, comme si le souvenir, saturé de gestes, perdait sa lisibilité. À l’inverse, l’Italien Davide Degano, dans « Do-li-na », remonte le fil d’une identité slovène dissimulée par les politiques fascistes d’italianisation, en mêlant paysages frontaliers, archives et mythes locaux. La frontière n’est plus une ligne claire, c’est un feuilleté de récits, de reniements et de résistances.
La démence, elle, vient fissurer de l’intérieur l’idée de continuité biographique dans « In the Mountains, the Sun is Shining » du Slovène Matevž Čebašek. En suivant sa grand-mère et en convoquant les souvenirs de son grand-père lui-même atteint de démence, l’artiste confronte la grande histoire slovène à une mémoire familiale qui se délite. L’Europe n’est plus le récit solide des institutions, c’est un ensemble de voix hésitantes, d’archives imparfaites, de boîtes à chaussures pleines de photos bancales.
La Française Manon Tagand en fait l’expérience dans « Boîte Noire », enquête visuelle et sonore qui part de l’expulsion et de la mort de son père pour remonter jusqu’au Cameroun colonisé. Sauver appareils, négatifs et vinyles ne suffit pas ; il faut inventer une forme, entre road-trip et généalogie politique, pour que ces fragments recomposent autre chose qu’une simple nostalgie. La photographie apparaît ici comme un outil de réparation autant que de confrontation.
Corps, genres, queerness : écrire d’autres récits de l’intime
Autre fil rouge de l’édition, la manière dont les corps – féminins, queer, racisés – négocient leur place dans des structures sociales persistantes. La Polonaise Joanna Szproch construit, avec « Alltagsfantasie », un sanctuaire domestique où se mêlent photographie de sa muse, dessins de sa fille et mises en scène performatives. C’est un espace liminal, affranchi des normes catholiques, où la sensualité devient acte de résistance et la joie féminine, une politique.
Le Letton Konstantin Zhukov, dans « Black Carnation Part Three », s’attaque à un autre angle mort que sont les histoires queer effacées par les systèmes hétéronormatifs d’archivage. Sur une ancienne plage de cruising près de Riga, il photographie des hommes et imprime ses images sur papier journal jauni ou supports thermiques destinés à disparaître, comme si la matérialité même des tirages portait la vulnérabilité de ces existences clandestines.
Plus à l’ouest, le focus Irlande prolonge cette réflexion. Avec « Homemade Undercuts », Ellen Blair célèbre la coupe de cheveux comme geste queer accessible, acte de fraternité et de soin autant que signal identitaire. « Becoming » de Donal Talbot envisage la queeritude comme une manière de regarder le monde au-delà du conditionnement : fuites de lumière, accidents chimiques sur ses négatifs deviennent autant de preuves que l’identité n’est jamais un état stable, mais un processus.
On pourrait multiplier les exemples : « Everything I Want to Tell You » de Sadie Cook & Jo Pawlowska, installation d’images, selfies et vidéos glitchées à la frontière du rêve, ou « Reliées » de la Française Marine Billet, ode aux jeunes femmes de la génération Z saisies dans ces instants de flottement où l’adolescence bascule vers l’âge adulte. Ensemble, ces œuvres posent une question simple et radicale : de quel droit une société dicte-t-elle la forme que doivent prendre nos corps et nos récits ?

Guerres, extractivisme, post-vérité, la photographie face à la violence du monde
Circulation(s) 2026 n’édulcore pas les tensions géopolitiques qui fissurent l’Europe et au-delà. Avec « Eruption », l’Ukrainienne Olia Koval envahit un espace domestique de 40 000 punaises rouges faites main, métaphore inquiétante de l’occupation russe : un salon intime devient zone occupée, la chambre un décor de cauchemar. Le pseudo-documentaire se nourrit de témoignages, de descriptions minutieuses d’insectes, comme si le réel ne pouvait plus être décrit qu’à travers des figures d’invasion.
Plus au sud, « El Rey Blanco » de l’Argentino-Italien Maximiliano Tineo tisse un lien entre la légende coloniale d’un roi régnant sur une montagne d’argent et l’actuel triangle du lithium (Bolivie, Argentine, Chili), où se concentrent plus de 65 % des réserves mondiales de ce métal blanc. De la montagne de Potosí vidée pendant l’occupation espagnole aux déserts salins convoités par l’industrie des batteries, la série montre que l’extractivisme n’a jamais cessé : il a simplement changé de métal, de langage, de logos.
La violence n’est pas seulement physique ou économique : elle est aussi médiatique et algorithmique. Le Brésilien Rafael Roncato, avec « Tropical Trauma Misery Tour », décortique la mythologie grotesque qui s’est construite autour de l’agression au couteau de Jair Bolsonaro en 2018. Mèmes, images truquées et archives recomposées forment un théâtre politique où la frontière entre fiction et information s’effondre, révélant l’architecture globale de la désinformation.
Face à cette machine à produire du faux, le Belge Marcel Top invente une forme de sabotage discret dans « Poison Data, Kill Algorithms ». En créant sa propre base d’images dont 10 % sont volontairement « empoisonnées », il vise à dérégler les systèmes de reconnaissance développés par les entreprises de surveillance. La photographie, ici, n’est plus seulement un témoin ou un médium artistique : elle devient arme défensive contre l’industrialisation de nos visages.
Mythes, rituels et écologies – habiter autrement le monde
Une autre constellation d’œuvres interroge notre rapport au vivant et aux récits mythologiques. La Suisse Nathalie Bissig, avec « Thunder », explore la vallée d’Uri de son enfance en mêlant masques, figures archaïques et paysages montagneux. Que faisaient les communautés avant la météorologie moderne pour expliquer le tonnerre, l’inattendu, l’incontrôlable ? Ses images, proches du conte, rappellent que la peur de la nature est aussi une peur de nos propres limites.
En Guyane, le duo T2i & NouN réinventent la figure de manman dilo, mère des eaux mi-femme mi-poisson, dans une iconographie afro-futuriste flamboyante. Dans une dystopie environnementale où les eaux se vengent des dégradations humaines, cette divinité amazonienne devient gardienne des mémoires afrodescendantes et force féminine souveraine. Là encore, mythologie et politique se superposent : la légende sert à penser les ravages écologiques et l’héritage colonial.
Le Brésilien d’origine okinawaïenne Ricardo Tokugawa, avec « Utaki », questionne quant à lui la notion de lieu sacré à travers son identité triple (Brésil, Okinawa, Japon). Traditions, rituels familiaux et gestes ordinaires y apparaissent comme des structures mouvantes plutôt que des essences figées. À l’heure où les discours identitaires se durcissent, sa série rappelle que l’appartenance est d’abord un mouvement.

Un festival comme écosystème : studios photo, week-end pro, scènes numériques
Circulation(s) n’est pas qu’un parcours d’images à contempler : le festival se vit aussi comme une plateforme de rencontres et de professionnalisation. Le week-end professionnel propose lectures de portfolios, masterclasses consacrées à l’édition, à la scénographie ou au tirage, ainsi que des conseils juridiques et techniques avec les partenaires présents. Pour de jeunes artistes souvent précaires, ce moment tient autant du séminaire que du sas d’entrée dans le monde de l’art.
Les studios photo, ouverts tous les week-ends, invitent quant à eux le public à passer devant l’objectif : en solo, en famille ou entre ami·es, chacun peut expérimenter une prise de vue professionnelle et repartir avec un tirage signé. Loin d’être un gadget, ce dispositif rappelle que la photographie est aussi une expérience incarnée, une rencontre, un jeu – et pas seulement un flux d’images consommées sur écran.
Enfin, la présence renforcée du festival sur les réseaux (Instagram, TikTok, etc.) prolonge dans l’espace numérique ce travail de médiation. Là encore, la question demeure : comment montrer sans se laisser confisquer ? Le pari de Circulation(s) est d’utiliser les plateformes pour ouvrir les regards, tout en donnant à voir des œuvres qui interrogent précisément la façon dont ces mêmes plateformes modèlent nos vies.

Voir l’Europe autrement, voire l’inventer
En réunissant mémoire familiale et archives coloniales, mythes montagnards et datas sabotées, plages de cruising lettones et jardins irlandais hantés par la migration, Circulation(s) 2026 dessine une Europe inquiète mais inventive. Rien n’y est lisse : ni les identités, ni les frontières, ni les récits nationaux. Mais de cette inquiétude surgit peut-être une autre manière d’habiter le monde : plus consciente des blessures, plus attentive aux marges, plus méfiante envers les grands récits, plus confiante dans la puissance des histoires singulières.
Aller au CENTQUATRE-PARIS ce printemps, ce ne sera donc pas seulement « voir des photos ». Ce sera accepter de se laisser traverser par des images qui, souvent, mettent au travail : que faisons-nous de nos mémoires ? que faisons-nous de nos corps ? que faisons-nous des images qui nous gouvernent ? Autant de questions auxquelles on ne répond pas en sortant du festival, mais avec lesquelles on repart – et qui, comme le veut le titre même de Circulation(s), continueront de circuler.