Poussière d’homme fait partie de ces livres qui désappointent les éditeurs avant de les combler. Succès d’estime à sa parution en 2006, il n’a depuis cessé de se vendre, promu par un bouche à oreille louangeur mais jamais flagorneur. La différence entre les deux adjectifs délimite la qualité objective d’un bon texte. Poussière d’homme réconcilie une certaine idée des belles phrases, et de l’amour dans ce qu’il représente de plus ultime. Rencontre avec son auteur, David Lelait-Helo.
Jérôme Enez-Vriad : Vos biographies traitent en majeur partie de femmes disparues : Edith Piaf, Dalida, Maria Callas, Romy Schneider, Barbara… C’est aussi le cas de votre dernier roman dont l’histoire évolue autour d’un décès, et dans le récit Poussière d’homme il est également question de quelqu’un qui n’est plus là. Comment expliquez-vous autant de choix tournés vers le passé ?
David Lelait-Helo : Le dénominateur commun est davantage la mort que le passé. Depuis l’enfance, la mort m’intrigue, m’inquiète et me surprend. Je ne parviens pas à croire à son existence bien qu’elle m’ait rattrapé à plusieurs reprises. Je suis pourtant dans la vie, dans le rire, dans la joie, mais l’exploration de la perte, de l’absence est profondément ancrée dans mon imaginaire, ce qui ne m’empêche pas de regarder loin devant. La nostalgie et la mélancolie ne m’effraient pas, je les cultive volontiers, les souvenirs me réchauffent et l’évocation d’un temps échoué, que je n’ai pas connu, me berce. Par ailleurs, n’y a-t-il pas thème plus romanesque en littérature ? Dire la mort, c’est chanter la vie.
Poussière d’homme tient à une construction grammaticale différente de vos autres livres. Elle est moins angulaire, les phrases sont plus courtes et les subordonnées n’affluent pas. Avez-vous eu conscience d’une plus grande sobriété au moment de l’écrire ?
Non, absolument pas. Je n’ai pas de regard technique sur ce texte. Pas de regard tout court, d’ailleurs. Il m’échappe et n’a cessé de m’échapper. Les retours des lecteurs, leurs émotions m’échappent également. Tout comme sa réédition et son succès six ans après la première parution. Ce texte semble voleter, flotter au-dessus de moi. Comme si je n’avais pas décidé de lui.
Si votre livre était une couleur, ce serait le bleu. Bleu mer, bleu des yeux du protagoniste, il évoque aussi la peur bleue de la maladie et de la mort. S’il était une odeur, on pense bien entendu à Habit-Rouge évoqué dans un passage. Êtes-vous d’accord avec ces choix et pourriez-vous y ajouter une musique ?
C’est amusant votre remarque… En poche comme en grand format, Poussière d’homme a toujours été bleu, je le voulais bleu, je le voyais bleu, il était impensable qu’il soit autrement. Couleur de paix, de liberté et d’immensité, des profondeurs et du ciel, couleur de ses yeux aussi… S’il était une musique, elle serait devenue douce. Au commencement, il n’y avait que de la colère, c’eût été une furieuse Carmina Burana. Aujourd’hui ce serait une balade grecque, la chanson Hartino to Fengaraki chantée par Nana Mouskouri sur une musqiue de Manos Hadjidakis. Douce, nostalgique, déchirante. Le texte, un poème de Nikos Gatsos dit que l’amour permet que tout devienne possible…
Le passage évoquant la manière de vider la penderie du défunt, de se défaire des vêtements lorsque tout doit disparaître pour mieux se reconstruire, ce passage et quelques autres sont d’une douceur exquise malgré la violence psychologique qu’ils décrivent. J’aimerais avoir votre sentiment sur ces faits concrets qui marquent l’absence davantage que la disparition elle-même, et que vous décrivez à merveille.
A l’instant où vous sombrez dans la douleur, dans des pensées métaphysiques, philosophiques, vous vous retrouvez englué dans les infimes et infâmes jeux du quotidien. Vider, ranger, nettoyer, organiser, donner, jeter… Ce « faire » vous ancre dans la vie au moment où elle vous échappe le plus. Vous êtes mort au-dedans, pourtant vous devez agir très vite, faire de la paperasse, régler des problèmes bassement matériels. Je n’ai à aucun moment perdu le sens du réel, c’est indispensable. Je n’ai rien négligé, il fallait tout faire et le faire bien. Quand tout est jeté, vidé, net, le pire commence. Vous êtes vide et prêt à mourir à votre tour.
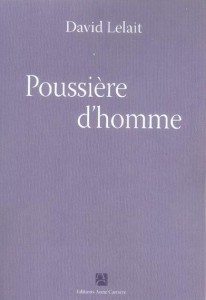
Ce refus par esthétisme est une pirouette, une façon de faire de l’humour. Mais cette pirouette me ressemble assez finalement… J’ai le sens du théâtre et le geste m’importe. Aucun détail dans tout ce que je fais n’est jamais vraiment abandonné au hasard. Je ne serais pas parti n’importe comment. Soit que ma douleur n’était pas encore assez grande, soit que je suis orgueilleux, soit que j’aime trop la vie. Je ne suis pas mort de chagrin car je sentais encore battre la vie en moi, la percevais par intermittence, elle me faisait mal aussi, me faisait culpabiliser, grignotait ma conscience. Le chagrin me torturait infiniment et pourtant je riais, je mangeais, je dormais, je sortais. Mon corps avait besoin de nourriture, de sucreries, de sexe… de vie en somme. J’ai vécu cette période entre abattement et survivance.
Une confession aussi intime s’écrit-elle à flot continu ou, à l’inverse, s’agit-il d’un élan quotidien plus proche du soin homéopathique ?
J’ai écrit ce texte en apnée avec la sensation de n’avoir pas décidé de sa forme, de ses courbes. Il s’est écrit jour après jour à compter des obsèques, le 8 avril 2005, comme un journal de bord, comme un cri dont mes lèvres n’étaient pas capables. Toutefois, je savais que ce genre de récit peut très vite devenir dégoulinant, il devait donc être sobre pour éviter le pathos. Je devais rester droit, d’un seul bloc, pudique et décent. Parce que c’est ma nature, et parce que c’est l’image que je me fais de la littérature. Ca ne devait pas être un témoignage, je voulais que ce soit un roman, une épitaphe.
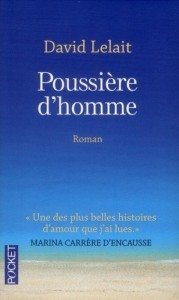
Je suis touché quand des mères me parlent de la perte de leur enfant ou de leur mari, des enfants de la perte d’un parent, quand un homme évoque l’absence d’un ami. J’ai alors la preuve que je leur ai parlé d’eux et non de moi. Là aussi se tient la différence entre la littérature et le journal intime. Si j’avais dû accoucher d’un journal intime, je n’aurais pas publié mon texte. Par exemple, jamais personne ne saura le nom de l’homme, ne verra son visage. Cela m’appartient.
Ecrit-on une telle histoire par amour ou par nécessité de nettoyer la nostalgie que l’on en a ?
Par amour. Pour repousser les limites de la mort, et surtout pour ancrer l’absent dans la vie. Tant que je serai là, il sera là. Et quand je ne serai plus là, il restera un brin de lui dans Poussière d’homme. Tous mes livres pourront disparaître, je m’en moque, je ne vis pas pour la postérité. En revanche, je sais que celui-là restera. Mes lecteurs le portent en eux.
Avoir fait de ce drame un livre à joli succès permet-il enfin à la plaie de respirer à l’air libre, et de guérir ?
On ne guérit pas mais on vit à nouveau et autrement. Et avec bonheur, et heureux, oui vraiment heureux. Cette douleur s’inscrit malgré tout dans la chair pour toujours. C’est une empreinte, une cicatrice. Mais je peux dire que l’amour est sans fin, sans limite, il se régénère, il pousse entre les pierres, surgit des eaux profondes au moment où l’on s’y attend le moins.
Si vous aviez le dernier mot, David Lelait-Helo ?
Le dernier, non… Trop de livres attendent que je les écrive. J’aime tant les mots que je n’imagine pas qu’il y en ait un dernier… Lequel écrirai-je donc en dernier ? « Merci » peut-être ou « j’arrive » ou « Enfin… Je vais savoir… » ou « Enfin je vais te revoir ».
# # #
Poussière d’homme de David Lelait
Eds Anne Carrière, 160 pages – 15,70 € // et en poche chez Pocket, 127 pages – 5,70 €
# # #
Entretien réalisé par Jérôme Enez-Vriad, Illustration bandeau : Jean-Philippe Raibaud
.


